Ernst Haas : One, USA - 1968
La photographie couleur, aujourd’hui omniprésente, n’a pas toujours été considérée du même œil que la photographie noir & blanc. Il aura fallu le talent de plusieurs photographes, les pionniers de la couleur, pour qu’elle obtienne ses lettres de noblesse. Tout comme William Eggleston ou Saul Leiter, Ernst Haas, a très largement contribué à sa reconnaissance. Cette image « One, USA - 1968 », me semble assez emblématique de la sensibilité d’Ernst Haas quant à la couleur, et de la façon dont il l’a utilisée pour montrer bien plus que la simple représentation d’un sujet à l’intérieur d’un cadre. Son travail de la couleur, ici associé au flou, réforme l’idée que l’on se fait de la street photography et nous amène à apprécier cette dernière dans une forme d’esthétisme plus pictural, qui semble badiner avec l’art contemporain, voir l’abstraction.
Ernst Haas, est né en 1921, il est autrichien... Il a vécu sa jeunesse en temps de guerre et sera le témoin de ses conséquences dramatiques. Après des études littéraires, il se tourne dès 1940 vers un cursus de médecine, la gravité des évènements ayant très probablement développé en lui le sentiment qu’il fallait se rendre utile dans cette époque plongée au cœur d’un conflit d’une rare violence. Parallèlement il nourrit une affection particulière pour l’art et il est curieux du monde qu’il aimerait découvrir. En 1942, il entre alors à l’Institut des Arts Graphiques de Vienne, mais il se verra contraint de quitter l’école en raison de ses origines juives. Et c’est en 1945 qu’il découvre la photographie se révélant à lui comme une réponse, celle d’une discipline ayant le pouvoir de concilier sa sensibilité artistique et son appétit de voyages.
Comme beaucoup d’autres, Haas a commencé par la photographie en noir & blanc. Il est donc photographe à la fin de la 2ème guerre mondiale et c’est avec ses images du retour des prisonniers de guerre à Vienne, publiées en 1947 par l’hebdomadaire Suisse DU, qu’il se fera remarquer par le magazine américain Life. S’ensuit l’invitation que lui fait Robert Capa d’intégrer l’agence Magnum où, il retrouvera son ami Werner Bishop qu’il avait connu lorsqu’il travaillait pour DU, et où il se liera d’amitié avec Henri Cartier-Bresson. Nous sommes en 1949 et Haas est l’un des premiers photographes à être invité, par ses fondateurs même, à rejoindre la première agence indépendante de photographes, devenue aujourd’hui une référence incontournable. Comme le souhaitait Robert Capa, les photographes de Magnum sont libres, ils choisissent les thèmes qu’ils veulent traiter, suivent leurs idées autant que leur instinct, développent leur propre style, ils partent à l’aventure pour couvrir leurs sujets... C’est en s’inscrivant dans cette dynamique, ce sentiment de liberté, qu’Ernst Haas choisira de venir s’installer aux Etats-Unis en 1951, et qu’il y fera ses premières images en couleur avec le film Kodak I, d’une sensibilité estimée à 12 asa/iso. Le succès ne se fera pas attendre et en 1953 il est le premier photographe à avoir un portfolio de 24 pages exclusivement en couleur, des photographies de New York, publié dans le magazine Life : « Images of a magic city ».
La couleur comme une évidence, en lien avec son histoire et celle du monde. Ernst Haas dira : « Avec le recul, je pense que mon passage à la couleur s'est fait de manière plutôt psychologique. Je me souviendrai toujours des années de guerre, y compris au moins cinq années amères d'après-guerre, comme des années en noir & blanc, ou mieux encore, des années grises. Les années grises étaient révolues. Comme au début d'un nouveau printemps, je voulais célébrer en couleur les temps nouveaux, remplis d'un nouvel espoir [...]. Tout était lié à ce nouveau courage de la couleur. Mode, gastronomie, voyages, voitures, avion, tout changeait et prenait un nouvel éclat. L'âge des ténèbres était révolu. Faut-il alors s'étonner qu'un jeune photographe ait rêvé d'un film couleur avec lequel il pourrait capturer toutes ces nouvelles couleurs de l'environnement ? ». C’est ainsi, et à l’opposé d’Eggleston et de nombreux photographes dont les images servent parfois un propos critique sur les Etats-Unis, qu’Ernst Haas, car il a connu « les années grises » de la guerre dans son épicentre, aura pris un chemin contraire et célèbrera les couleurs, la liberté, et son pays d’accueil.
La couleur et le flou, une démarche esthétique à part entière. La couleur est le point d’orgue de la photographie d’Ernst Haas. Mais pas seulement, l’utilisation du flou sous ses diverses formes, occupe également une place particulière, et sert bien souvent à révéler plus intensément la couleur, l’un et l’autre se soutiennent. Avec le flou la couleur est en vibration, elle glisse, fuse, oscille, coule, s’étire, elle est énergie, elle s’anime. Ernst Haas jouera aussi des reflets et des transparences, de la même façon qu’avec le flou, pour donner vie à la couleur. Ses photographies sont une célébration, celle de voir, de laisser le regard se remplir et s’émerveiller par tout ce que la couleur peut produire d’émotions. La couleur a son identité et son caractère, elle est presque tangible, elle peut se montrer mystérieuse autant qu’elle peut être joie, elle vous absorbe et vous emporte comme dans des rêves dont les teintes ouvrent les portes de l’imaginaire.
La photographie d’Ernst Haas en écho à la peinture, un regard et une pratique de plasticien. Je crois en une révolution photographique amenée par Ernst Haas et qui est très certainement le produit de sa passion pour l’art et des études de peinture auxquelles il s’est consacré durant sa jeunesse. Ernst Haas a expérimenté la peinture, il a peint et je le vois dans ses photographies. A mes yeux, il travaille la lumière, la couleur, le contraste, le flou, de la même façon qu’on travaille la matière. Comme la main du peintre fait danser les couleurs avec son pinceau, le regard d’Ernst Haas fait danser les couleurs avec son appareil photo. Il y a dans sa photographie un positionnement artistique, comme un postulat dont la couleur serait tout à la fois le point de départ, le voyage, et le point d’arrivée, le matériau à explorer jusqu’à l’exalter. Dans cette image, « One, USA - 1968 », je retrouve les vibrations que peuvent m’apporter les couleurs et leurs contrastes dans l’œuvre de Mark Rothko. Alors qu’avec « Lights of New York City, NY - 1972 » et ses foisonnements de lumières polychromes, je ressens une énergie similaire à celle qui jaillit des bouillonnements de couleurs d’un Jackson Pollock. Dans « NY, 1952 » c’est le rythme des larges et généreux coups de brosse de Pierre Soulages qui me vient à l’esprit. Et lorsqu’Ernst Haas joue avec le flou de mouvement, je vois « Forces d’une rue - 1911 » d’Umberto Boccioni, ou le « Nu descendant l’escalier n°2 - 1913 » de Duchamp. Et puis, à parcourir l’ensemble de sa production, j’entrevois la musicalité des toiles de Vassily Kandinsky, le rythme des compositions de Paul Klee, ce sont aussi des œuvres Robert Delaunay, ou encore de Zao Wou Ki, pour ne citer qu’eux, qui m’apparaissent et me reviennent en mémoire... Pour autant je ne pense pas qu’Ernst Haas eut l’abstraction pour objectif, en ce sens que son travail reste ancré au réel et a pour point de départ ce qui se présente devant lui. Il ne s’agit donc pas d’une création abstraite telle que le serait une production conçue en dehors d’un regard direct sur son environnement. C’est je crois plutôt une immersion, c’est ce qu’il voyait et la puissance des couleurs, des lignes et des formes qu’il y décelait, que ses images révèlent avec lyrisme. La photographie d’Ernst Haas est une vision, et cette vision là s’était libérée de la représentation, nous emmenant avec lui un peu plus loin dans notre façon de regarder autour de nous, de nous ouvrir aux émotions que peuvent engendrer les couleurs sur nos esprits, de considérer les choses plus en profondeur. Comme ses photographies où il saisissait une image dans une image, deux images se superposant, et ne faisant qu’une, changeant ainsi la vision et la lecture de chacune d’entre elles. Ernst Haas, avec ce regard si particulier nous apprend à découvrir la couleur qui prend vie, à envisager les lignes comme des chorégraphies, il nous apprend à voir à la manière des poètes.
Selon Ernst Haas : « L'appareil photo ne fait que faciliter la prise de vue. Le photographe doit donner afin de transformer et transcender la réalité ordinaire. Le problème est de transformer sans déformer. Il doit gagner en intensité dans la forme et dans le contenu en faisant entrer un ordre subjectif dans un chaos objectif. Vivant à une époque de lutte croissante de la mécanisation de l'homme, la photographie est devenue un autre exemple de ce problème paradoxal de comment humaniser, comment vaincre une machine dont nous sommes totalement dépendants : l'appareil photo […]. Dans chaque artiste il y a de la poésie. Dans chaque être humain, il y a l'élément poétique. Nous savons, nous ressentons, nous croyons […]. L'artiste doit exprimer la somme de son sentiment, de sa connaissance et de sa croyance à travers l'unité de sa vie et de son œuvre. On ne peut pas photographier l'art. On ne peut le vivre que dans l'unité de sa vision, ainsi que dans l'ampleur de son humanité, de sa vitalité et de sa compréhension […]. » Ainsi, et c’est peut-être justement parce qu’il s’est consacré à la photographie de cette façon, où ce qui permet de constituer une image photographique importe tout autant et parfois plus que la simple figuration de ce qui y est représenté, Ernst Haas a été le premier photographe travaillant en couleur à avoir une exposition monographique au MoMa, en 1962, soit 14 ans avant celle de William Eggleston.
« One, USA - 1968 », la nuit, le flou d’un mouvement, trois couleurs, ce bleu. La composition est simple et linéaire, le point de vue frontal, il n’y a rien d’extraordinaire dans la construction de cette photographie si ce n’est justement ce choix de la simplicité pour mieux révéler ce qui importe ici, les couleurs d’une rue animée de New York, peut-être autour de minuit. Le bleu s’installe, en premier plan et horizontalement sur les deux tiers inférieurs de la photographie, il entre et sort de l’image depuis le bord droit vers le gauche. Il flotte et prend la forme d’une trace, rappelant le mouvement de travelling d’une caméra au cinéma, à la différence qu’ici, la caméra ne se déplace pas, le mouvement est devant l’objectif. C’est celui de la vie d’une rue, et plus particulièrement celui du passage d’une voiture traversant le cadre de droite à gauche. Le bleu dans cette photographie est mouvement, il est flou au point de devenir multiple. C’est un bleu qui vibre de toutes ses nuances, il se décline en différentes tonalités allant du Bleu de Prusse et de l’Indigo, au Cyan en passant par le Bleu Cérulé. Il se manifeste en quatre rubans, où s’alternent ses variations, de la plus dense à la plus légère selon les plans qui se succèdent derrière lui, selon la vitesse d’un véhicule qui passe ou l’immobilité d’un autre stationné là, et selon les lumières des phares et des néons. Sur le bord inférieur de l’image, il s’habille de ces lumières et de ces néons, qui, en rythme et par une multitude de reflets transversaux, répondent aux couleurs du tiers supérieur de la photographie. Il ferme l’image en bas comme il la ferme en haut en un profond bleu nuit. Entre ces vagues de bleu et au niveau du trois quart supérieur de l’image, viennent le blanc, le rouge, et le jaune, éclatants, qui créent un contraste tant par leurs teintes, que par leur netteté. Ces couleurs, sont celles d’une fresque murale représentant des nuages sur fond rouge. Il s’agit certainement d’un club, en attestent les fenêtres occultées et couvertes du même motif nuageux que les murs, ainsi que l’entrée qui, quant à elle, se détache dans une lumière jaune, sous la protection d’un auvent marquise en demi-lune et où est inscrit : « One ». Là, dans cette lumière, se distinguent trois silhouettes. La première, celle le plus à droite, se détache derrière la voiture aux phares allumés et devant le mur peint, c’est peut-être un passant, à moins que ce ne soit un noctambule arrivant au club. Il a le corps dirigé vers la gauche de l’image et son visage paraît tourné vers le photographe. Le second est dos à la porte et regarde vers la droite, sa position pourrait laisser penser qu’il s’agirait là du physionomiste ou du portier. Le dernier, qui est dans le club et en arrière-plan, est de face et regarde dans la même direction que le premier. La position du corps du passant s’oriente dans la même direction que la trace laissée par la voiture qui passe, ainsi que celle, plus nette, des véhicules stationnés de l’autre côté de la rue, devant le « One ». L’entrée du club, avec sa couleur jaune attire l‘œil immanquablement sur le tiers gauche du cadre. Ainsi, et dans cette composition, la lecture de l’image, avec sa dynamique où on entre par la gauche, est définitivement installée et vient arrêter le regard sur le bord droit. Toute la construction de la photographie repose sur des tiers, horizontalement et verticalement, avec pour point de force l’entrée du « One » et les trois personnages aux visages tournés vers la rue, retenant ainsi le regard sur le tiers supérieur gauche de la photographie.
Que nous raconte alors Ernst Haas avec cette image ? Finalement nous ne pourrions deviner que peu de chose si nous devions nous poser la question de savoir ce qu’il se passe ici, ce que nous raconte cette scène de vie. Et c’est peut-être là aussi tout l’intérêt de cette image, elle n’est qu’une scène de vie, elle ne nous révèle que quelques indices sur un moment de vie nocturne à New York. Mais surtout elle nous montre ce qu’Ernst Haas voyait et souhaitait nous donner à voir. Elle nous montre la nuit, mais pas n’importe laquelle, celle de New York, où le temps ne s’arrête pas, où l’on continue de vivre. Elle nous montre les couleurs de cette nuit New Yorkaise, vibrantes, éclatantes et chaleureuses même dans la profondeur de la nuit. Elle nous montre la vie et la richesse de ses couleurs. Déjà, le premier reportage couleur qu’avait publié Ernst Haas dans Life en 1953, réunissait des clichés de New York, il l’avait intitulé : « Images of a magic city ». Nous sommes en 1968 au moment de la captation de cette image, soit plus de vingt ans après son expérience de la guerre et ses années grises, et 15 ans après sa publication dans Life. Avec cette photographie Ernst Haas nous montre que la magie des couleurs de la ville n’a rien perdu de sa superbe à ses yeux. Il nous emmène avec lui, à la rencontre des couleurs, de leur influence et de leur énergie, nous invitant à les embrasser pour mieux ressentir ce qu’elles nous apportent, et nous laisser nous émerveiller de peut-être simplement pouvoir les voir. Cette dernière citation du photographe me semble pouvoir illustrer ce que je comprends de son œuvre et ce pour quoi elle me touche tant : « Le style n'a pas de formule, mais il a une clé secrète. C'est le prolongement de votre personnalité. la somme de ce réseau indéfinissable de vos sentiments, connaissances et expériences. Prendre la couleur comme un ensemble de relations à l'intérieur d'un cadre […]. On ne cherche pas à attraper des bulles de savon. On les apprécie en vol et on est reconnaissant de leur existence fluide. Plus elles sont fines, plus leur palette de couleurs est exubérante. La couleur est joie. On ne pense pas à la joie. ». Voilà pourquoi, la photographie d’Ernst Haas est si précieuse à mes yeux car au-delà de ces indéniables qualités esthétiques, elle véhicule des émotions et des valeurs essentielles, des rappels à la vie dont chacun d’entre nous devrait pouvoir bénéficier. Ernst Haas nous a offert une photographie libre, curieuse, vivante et enthousiaste, à l’image de l’homme qu’il a toujours été.
Le site d’Ernst Haas :
https://ernst-haas.com/
Un beau catalogue des œuvres d’Ernst Haas en grand format :
https://www.atlasgallery.com/artists/ernst-haas
(cliquer sur les titres d’exposition à gauche)
Chris Killip : Youth on wall, Jarrow Tyneside - 1976
Lorsque je choisis le photographe dont je souhaite vous parler, j’ai souvent tendance à aller chercher, parmi ses images, celle qui me parle le plus, celle que je pense être l’une des plus révélatrice de son œuvre et son regard, et aussi, celle que vous ne connaissez peut-être pas. Mais pas cette fois, pas avec Chris Killip, qui nous a quitté en octobre 2020, car à la nouvelle de son décès, le monde de la photographie a ressenti un profond désarroi. Or, c’est particulièrement sur la condition humaine son désarroi et son dénuement face à une société qui se délite que se portait le regard du photographe. C’est donc sur cette image emblématique et particulièrement émouvante de Chris Killip : Youth on wall, Jarrow Tyneside, 1976, que je vais poser mes mots pour vous emmener à la découverte de ce grand monsieur de la photographie qui n’a eu cesse de témoigner des maux de ceux laissés pour compte.
Une histoire presque ordinaire dans des circonstances qui s’avèreront l’être beaucoup moins. Chris Killip est né en 1946 sur l’île de Man, un petit bout de terre qui se situe entre l’Angleterre et l’Irlande, il va à l’école jusqu’à ses 16 ans, puis rejoint son père pour travailler avec lui dans l’hôtellerie. Le parcours classique d’un adolescent que rien ne destinait finalement à la photographie. Mais c’était là sans compter sur le souvenir prégnant d’une photo d’Henri Cartier-Bresson sur le Tour de France qu’il avait découverte dans Paris-Match. Il n’avait alors que 8 ans et avait été marqué par cette image qui montrait « un garçon en culotte courte, une bouteille dans chaque main, rue Mouffetard », il déclarera : « cette photo a changé ma vie... j'ai commencé comme photographe de plage, et le soir je shootais des couples sur la piste de danse des hôtels ». Nous sommes en 1964, Chris Killip est désormais photographe. Il va assister plusieurs photographes à Londres, tout en revenant régulièrement sur son île natale. Il y réalisera entre 1970 et 1973 sa première série : Isle of Man. Et c’est aussi à cette époque que tout ce qui avait semblé être un temps immuable, que ce soit sur son île, en Angleterre ou en Irlande, commença à véritablement changer de visage. L’aviation civile s’est développée et, en devenant plus accessible, de nouvelles destinations telles que l’Espagne ont supplanté l’attrait touristique qu’exerçait auparavant l’île de Man auprès des britanniques. Pendant ce temps aussi, les attentats dus aux conflits nord-irlandais s’intensifient. L’empire britannique poursuit son déclin amorcé à l’issue de la seconde guerre mondiale, avec la décolonisation, la suprématie naissante des deux superpuissances américaines et soviétiques, et en réaction la création de l’Europe. Cet enchainement d’évènements aura pour conséquence la désindustrialisation du pays, entrainant dans sa course le bouleversement des sociétés organisées autour de l’industrie et par elle, les déclassements, les drames sociaux... Chris Killip se trouve là, au centre de ce tournant économique dont les effets sont tout autant visibles sur le visage des villes agonisantes que sur celui de leurs populations.
L’esthétisme d’une photographie qui témoigne de façon réaliste et objective de ce qu’elle capture. Chris Killip se positionne dans la mouvance de la photographie pure (« straight photography »), il se reconnait dans le langage plastique et stylistique de Walker Evans, Bill Brandt, Robert Frank, August Sander, et il va y faire écho avec son propre travail. Loin du pictorialisme, la photographie pure se veut instantanée, sans manipulation, ce qui compte, au niveau de la forme c’est la netteté, la composition et le cadrage qui permettront, dans le rapport de lignes et dans l’équilibre des noirs et blancs de concentrer l’attention sur le sujet. Dans le fond, son objet est le plus souvent de l’ordre du social, de l’humain ou lorsqu’il s’agit de paysages, qu’ils soient naturels ou urbains alors c’est purement sur une restitution signifiante, voire poétique, de la géométrie et la lumière que se concentre le « straight photographer ». Ainsi, Chris Killip ne déroge pas à la règle, et produira tout au long de sa vie des images à la chambre photographique où la puissance des noirs et blancs sera équilibrée de riches nuances de gris, des prises de vues où tous les plans seront nets, servis par des cadrages et des compositions parfaitement maîtrisés, signifiants.
« C’est ce que je fais, l’histoire s’écrit après les faits, mais mes photographies par contre vous montrent ce qui s’est passé ». Chris Killip n’est pas un journaliste, il ne se contente pas de documenter, il est bien plus qu’un témoin. Le photographe travaille de l’intérieur, il se familiarise avec les lieux, les gens, leur histoire et leurs histoires, partage leurs vies. Il travaille sur le long terme, passe des années auprès de ceux qu’il va photographier, il les appelle par leurs prénoms, il intègre une communauté, il devient un des leurs, et c’est alors, à partir de ce moment seulement qu’il va commencer à fixer ce qu’il sait d’eux sur les plaques de sa chambre photographique. Son regard n’est pas celui d’un étranger, et, il ne photographie pas des personnes qui lui sont étrangères. Avec cette confiance instaurée, ces liens qui se sont installés au fil du temps, la distance entre le photographe et son sujet s’en trouve réduite lui offrant une plus grande liberté d’approche. Chris Killip est dans l’intime, il est une figure familière qui immortalise ses semblables, tout en gardant une forme de réserve, de pudeur. Les personnes qu’il photographie ne posent pas, elles regardent rarement l’objectif, elles sont simplement là, saisies dans l’instant qu’elles vivent, au cœur de leur environnement, d’un paysage qui est aussi un élément de lecture essentiel, à la façon d’un second rôle, sans lequel l’histoire qui se tisse dans le cadre serait incomplète. Sa photographie est circonstancielle et empathique, c’est un moment arrêté certes, mais au cœur d’un récit qu’il connaît, l’image s’inscrit dans un continuum, elle montre ce qu’il s’est passé car elle en montre aussi et surtout les conséquences. Pour autant ses clichés ne tombent pas dans l’écueil du pathos, ils retranscrivent une tragédie mais sans emphase, et c’est là je crois que se situe aussi la plus belle part de respect et d’estime que le photographe puisse offrir autant à ces sujets qu’à son public. Il n’est pas question de manipuler et mettre en scène ce qu’il photographie pour ouvrir les vannes des bons sentiments et en faire un objet de commisération, d’apitoiement ou de complaisance. Il importe seulement d’offrir un moment de reconnaissance à ces êtres qui traversent une vie qui peut prendre des airs de tragédie, de les regarder pleinement et de voir leur entière dignité. Ils sont les témoignages des différents visages que peut prendre l’humanité lorsqu’elle est ballottée par des évènements qu’elle ne peut contrôler.
La dense gravité des hommes face à une existence qui se vide de sens. La photographie de Chris Killip montre ceux qui survivent tant bien que mal et tous les autres. Il y a ceux qui survivent, comme en résilience, qui subsistent en tirant ce qu’ils peuvent des stigmates d’une activité minière agonisante tels les « pêcheurs de charbon » ou « charbonniers de l’océan ». Ceux-là, quel que soit le temps, récoltent de leurs mains le charbon rejeté à la mer par des mines locales qui bientôt allaient ne plus exister. Il y a aussi les ouvriers, ils ont travaillé ensemble, avec les mêmes personnes, voisins ou amis, pendant des années et parfois depuis plusieurs générations, répétant les mêmes gestes, sur les mêmes lieux. Et puis les usines et les industries sidérurgiques ont cessé leurs activités parce que la main d’œuvre et le foncier sont encore moins chers ailleurs, les commandes n’arrivaient plus aux chantiers navals, tout ce qui faisait tourner l’économie s’est arrêté, là, chez eux, laissant l’immense majorité de ces hommes et ces femmes qui se rendaient au travail chaque jour, sans emploi, sans revenus, sans reconnaissance sociale, comme exclus de la société, et absolument démunis. La plénitude, parfois rude de leur travail, a cédé sa place au vide qu’engendre la perte d’emploi, et tous les maux qui l’accompagne. Que nous reste t-il lorsque tout ce que l’on a connu quotidiennement et qui nous faisait vivre disparaît ? Que reste t-il de nous ? Il y a dans les images de Chris Killip un étrange équilibre où la présence des hommes interroge le vide qui les entoure, un vide qui flotte dans l’air, comme une menace, celle de les atteindre dans leur âme et leur chair. Ils sont démunis mais ils existent, ils sont réels, authentiques, leurs regards et leurs postures, face à l’inanité, attestent au contraire d’une véritable présence.
Le corps d’un très jeune homme, recroquevillé sur un muret de briques jusqu’à presque s’y confondre. On y voit ses membres en tension, aussi rudes et saillants que les pierres sur lequel il se niche. L’image est une construction d’angles, ceux des arêtes des briques, ceux du corps plié du jeune homme, ceux de ses coudes et ceux de ses genoux. La composition elle-même repose sur un rectangle dessiné par le muret et le pilier contre lequel est adossé l’adolescent, au point qu’on a l’impression que lui-même prend cette forme. Le regard est enfermé dans un ensemble de rectangles qui viennent organiser l’image, comme une mise en abîme façonnée par la géométrie d’un jeu de cadres se succédant les uns aux autres. Il y a d’abord celui du cadrage, du format de la photographie, puis celui du pilier qui ferme l’image à gauche et son muret qui la ferme en bas. Au centre il y a celui du corps du jeune homme, ramassé au point qu’il semblerait pouvoir tenir dans une boîte. Et enfin, en arrière-plan, le rectangle d’un bout de mur lui-même encadré sur sa gauche par un autre pilier et fermé en haut par une fenêtre. Chacun de ces rectangles résonne comme un enfermement, il n’y a pas d’issue dans cette image, pas plus pour le regard que pour le garçon, coincé là avec tout le poids de la peine qui l’opprime. Et puis il y a les membres de l’adolescent, ses bras et ses jambes, composés d’angles et d’obliques réunis au cœur de l’image qui pourraient peut-être briser la rigueur des rectangles, si le contexte était autre. Car en ce qui l’en est de ces diagonales, bien qu’elles apportent une dynamique à l’image, pour autant elles ne créent pas de rupture quant à la perception que nous nous faisons de l’ensemble. Au contraire, et dans cette construction, elles se dessinent comme autant d’éléments d’intensification du sentiment qui se dégage de la photographie, elles disent l’émotion, elles figurent l’affliction ressentie par le garçon. Aucune d’elles ne permet de sortir du cadre, elles canalisent le regard et le mène inexorablement vers la tête du jeune homme elle-même encadrée par le triangle que dessine ses épaules, ses coudes et ses poings. Chacune de ces lignes exprime la douleur tant la tension qu’elles révèlent est palpable, jusqu’à la position presque fœtale de l’adolescent qui pourrait suggérer l’anxiété ou le repli et le besoin de protection qui l’accompagne. Ces lignes, qu’elles se matérialisent sur les plis des vêtements élimés de l’adolescent ou dans ses membres ramenés sur eux-mêmes, participent toutes à indiquer la désolation, l’usure, la misère. Chris Killip racontera plus tard que cette photographie n'avait pas pour objet de devenir un symbole de rage et d’impuissance et qu’elle montre avant tout un jeune homme qui « porte sa veste du dimanche, car il n’en a pas d’autre, et il grelotte de froid, pas de colère… ». Pourtant, ce froid qui tétanise le jeune homme exprime à lui seul tout le dénuement et toute la misère de sa condition. Il est alors légitime de se demander comment il se peut qu’il n’ait qu’une seule veste pour se couvrir quel que soit le temps et les circonstances. Et, comment il se peut qu’il se soit retrouvé là, transi, ne trouvant d’autre refuge que des pierres pour s’abriter peut-être de la morsure de l’air.
Une photographie avec pour point d’orgue, un profil d’adolescent. C’est parce qu’elle est en noir et blanc et parce que les gris déclinés dans les différents plans de la scène se situent tous dans des valeurs très proches, que cette image peu contrastée dans l’ensemble révèle avec encore plus de force l’émotion qui y est véhiculée. Et c’est dans les points de lumières, les gris plus clairs du visage et des mains, que vient alors se loger le contraste de l’image et toute la détresse du garçon, condensée dans sa chair, marquée dans les plis tracés par la souffrance sur son visage. Sa tête, de profil, est à la fois lumière et désolation, et c’est là chose peu commune en sémantique que d’associer ainsi la clarté dans la forme à ce qui relève de l’ombre dans le fond. Usuellement, la lumière est associée au bonheur, à la liberté, la délivrance, mais Chris Killip, dans cette image, l’utilise de manière diamétralement opposée et parvient cependant à assoir plus encore son propos, affirmer plus intensément ce qu’il a vu lorsqu’il a photographié le jeune homme. Cette lumière qui révèle avec force la figure désespérée de l’adolescent déchire l’image, elle est au regard ce que le cri est à la voix. C’est au travers de ce visage que s’incarnent alors les tourments qu’éprouvent ceux qu’une économie vacillante aura laissé dans la nécessité. C’est un éclairage, une lumière aussi vive que le désespoir ressenti par l’adolescent, que Chris Killip pose sur une population dont le mode de vie aura été sacrifié, voué à disparaître à l’aune de la mondialisation.
Voir les photographies de Chris Killip :
http://www.artnet.fr/artistes/chris-killip/
https://artscouncilcollection.org.uk/explore/artist/killip-chris
Chris Killip raconte Chris Killip, vidéo en anglais :
Weegee : “ Their First Murder " , 1941
Octobre 1941, le PM Daily publie cette photographie que Weegee a intitulée : “Their First Murder”.
Mais déjà à cette époque, le photographe quant à lui n’en est plus à son premier meurtre. Photographier le bouillonnement d’une ville au cœur de la nuit, ses fêtes, galas et autres divertissements, mais aussi et surtout les drames qui y surgissent, des accidents de voitures aux scènes de crimes en passant par les incendies, c’est là son fond de commerce, sa vie, son œuvre. C’est le regard qu’il a porté sur ces scènes qui a fait de lui un photographe unique et qui a fait de ses images une référence photographique dépassant de loin tout ce que l’on pouvait attendre du photojournalisme en ces temps, à tel point que ses photographies ont été exposées, de son vivant, au MOMA.
Weegee, en voilà un drôle de nom. Sans la photographie il n’y aurait eu qu’Arthur (Ascher) Fellig. Mais c’est parce que l’homme n’était pas commun, ni dans la trajectoire qu’il a empruntée, ni dans sa façon d’opérer, que la figure de Weegee est née. Issu d’une famille juive d’origine Ukrainienne, il a rejoint son père, rabbin, avec sa mère et ses trois frères aux Etats-Unis dans sa petite enfance. Très tôt, il a rejeté le strict judaïsme prêché par son père, et, a décidé de suivre son instinct, de donner chair à son rêve américain. Il y a deux histoires derrière le nom de Weegee celle que ses pairs rapportent, et celle plus fabuleuse que le photographe lui-même aimait raconter. Cependant l’une comme l’autre, témoignent de son histoire, sa vérité, et en quoi Arthur Fellig a embrassé son destin, l’a façonné jusqu’à devenir l’incroyable personnage qu’il était, Weegee The Famous. Il faut savoir que sa passion pour la photographie s’est révélée à lui très tôt, lorsqu’il avait été photographié au ferrotype dans la rue, il devait avoir entre 13 et 14 ans. A cette époque il avait déjà quitté l’école pour aider financièrement sa famille, et il enchaînait les petits boulots. Mais, ce portrait au ferrotype a été son déclencheur, son révélateur, Weegee était photographe, il le savait, il ira jusqu’à dire plus tard : « Je pense que j'étais ce qu'on pourrait appeler un photographe né, avec l'hypo dans le sang." (Hypo : les produits chimiques utilisés dans la chambre noire). C’est alors que le jeune Arthur achète un appareil photo et un poney sur lequel il fait poser les enfants qu’il photographie pour vendre les tirages aux parents. Il se fera aussi embaucher par différentes compagnies d’assurance ayant besoin d’images pour leurs catalogues. La première explication à son surnom vient de son parcours et en particulier de son expérience au sein de Acme News Pictures où il s’était fait remarquer par son habileté à pouvoir développer des tirages en toutes circonstances et situations (dans une rame de métro par exemple), au point que ses collaborateurs l’avaient rebaptisé Mr Squeegee. L’autre version de la naissance du nom de Weegee vient de son extraordinaire talent à se trouver exactement là où se déroulait l’action et bien souvent avant tout le monde. A tel point qu’on lui a prêté des dons médiumniques par lesquels il aurait été capable de deviner ce qui allait se passer et où. Ainsi, l’idée que l’homme était tel une planche de Ouija est née. Le photographe s’amusait à laisser croire qu’il avait de tels dons, voir même encourageait cette légende, et c’est ainsi que Ouija serait devenu Weegee.
Les embrasements de la cité résonnant dans une cloche, ses tressaillements dans des ondes radios. Voilà comment Weegee parvenait à toujours se trouver au cœur de l’action. L’homme, déterminé, débrouillard et inventif, avait conçu son propre système d’alertes lui conférant une indéniable longueur d’avance sur ses confrères. Cette réactivité a participé de façon incontestable à faire de lui le chasseur d’image le plus prolifique de sa génération. Weegee s’est créé son emploi, et avant même d’avoir da carte de presse, il s’est positionné comme photographe indépendant. A ses débuts, et pour trouver ses sujets, il avait relié les alarmes des pompiers à une cloche qu’il avait installée dans sa chambre. Il se rendait aussi dans les postes de police de New York et de Manhattan en particulier. Là, à l’affût des messages qui arrivaient sur les transcripteurs du commissariat, il ne lui restait plus qu’à choisir l’histoire qui l’intéressait plus particulièrement avant de foncer sur les scènes de crimes. Mais cela ne lui suffisait pas, il avait quand même le sentiment de ne pas arriver assez vite sur les lieux. Son tour de force a été d’acheter un Coupé Chevy 1938 dont il transforma le coffre en laboratoire photo, et, d’obtenir de la police que la radio de sa voiture soit branchée sur les mêmes ondes, lui conférant cette fois l’avantage de ne plus jamais arriver trop tard. Sa Chevy est devenu son studio, son « photomobile », avec dans le coffre tout son matériel, des pellicules aux flashs, plusieurs boîtiers, sa machine à écrire, des vêtements pour toutes circonstances et même des déguisements, de quoi se nourrir et bien sûr ses cigares !
Weegee the famous une revendication, une signature. Aujourd’hui, il est un fait acquis que les photographes possèdent des droits : « perpétuels, inaliénables, imprescriptibles, insaisissables, absolus » sur leurs créations, leurs œuvres. Et pourtant ce droit subit encore de nombreuses entorses. C’est une lutte constante que de faire reconnaître, et surtout faire valoir ces droits par nombre de supports qui choisissent d’utiliser le travail des photographes sans rémunération, ni même autorisation... Mais le droit est dorénavant du côté des photographes, ce qui n’a pas toujours été le cas. Pour avoir été spolié de ses droits durant tout le début de sa carrière Weegee a rapidement pris conscience de cette aberration, et est certainement l’un des premiers à avoir combattu pour la reconnaissance de sa propriété intellectuelle. Avant d’être indépendant, Weegee avait été mandaté par Acme News Pictures afin de constituer une photothèque destinée à la presse quotidienne, mais ses images une fois livrées ne lui appartenaient plus, elles étaient devenues la propriété d’Acme. Le photographe au caractère bien trempé, et conscient de sa valeur autant que de la valeur de son travail, n’allait pas accepter plus longtemps que ses photos soient publiées sans sa signature, sans cette reconnaissance à laquelle il aspirait et dont il savait qu’elle devait lui revenir. Ainsi, plus tard lorsqu’il commença à vendre ses photographies au World-Telegram, ce fût cette fois selon ses conditions : obtenir son crédit photo avec la publication de son image. Et pour s’assurer que plus jamais aucun journal ne s’autoriserait à ne pas le créditer, là encore, Weegee à été aussi inventif qu’astucieux en trouvant une solution aussi simple qu’efficace pour régler le problème. Il a fait réaliser un tampon sur lequel était inscrit en lettres capitales : « Crédit photo by Weegee the Famous » afin d’estampiller le dos de ses tirages de son nom. Cette signature a été déclinée en diverses versions au cours des années, parfois indiquant aussi son adresse. Une autre des idées visionnaire du photographe a été de commencer à légender lui-même ses images, et il s’est donc tout simplement doté d’une machine à écrire. Ainsi, une fois la photo prise, le photographe la développait immédiatement dans le coffre de sa voiture, la tamponnait de son crédit photo, et dans la lancée, l’insérait dans sa machine à écrire pour inscrire sans plus attendre sa légende : « Ce que je vois et ressens profondément, je le photographie, puis j'écris ce que j'ai remarqué et ressenti ». Ainsi, il photographiait essentiellement la nuit, développait et signait son travail avant que le jour ne se lève, pour, à l’aube, se rendre dans les journaux, et y vendre ses clichés marqués de son nom et de ses légendes, afin qu’ils soient publiés dès la première édition du matin.
Mettre la nuit au grand jour, faire la lumière sur l’obscurité. Tout semble plus dramatique la nuit, plus mystérieux, intense, et c’est peut-être cela qui opérait sur Weegee une telle fascination qu’il ne pouvait s’en lasser. Il aimait la nuit, ce moment où la rue devient le théâtre de scènes de crimes, de débauche et d’incidents en tous genres, où les masques tombent révélant les gens, qu’il aimait, dans toute leur humanité. Et puis la nuit, ce qui est au loin disparait, englouti dans le noir, seul ce qui est dans la lumière reste visible. L’obscurité était donc un précieux atout pour Weegee car après tout, le métier de photographe, n’est-il pas celui d’écrire avec la lumière, de dévoiler par la lumière. Et, la lumière de Weegee, puissante, précise c’était son flash-gun. A coup d’éclairs, il ne révélait que ce qu’il visait, ni plus, ni moins, limitant la scène et l’image à ce qu’il illuminait un peu moins d’une seconde. Il n’y a pas plus efficace, voir radical, pour ne montrer que ce que l’on veut montrer, éclairer son sujet comme un acteur sous un projecteur, choisir et souligner les détails qui viendront soutenir le propos de l’image, tout en faisant disparaitre dans une noirceur absolue tout ce que l’on peut estimer comme superflu. Car c’est aussi cela la puissance du flash, plonger ce qu’il y autour dans un noir plus sombre encore que la nuit elle-même, une obscurité si dense que ce qui n’est pas dans le cercle de lumière est purement et simplement éclipsé, créant ainsi une atmosphère particulièrement dramatique, où l’ombre, souvent énigmatique, devient présence. Le photographe s’attachait à représenter ce qu’il considérait comme la réalité, et pour cela il estimait qu’il fallait l’exposer nue et dépouillée. C’est en ce sens que photographier la nuit, au flash présentait pour lui les conditions idéales de prises de vues. La réalité dans les images de Weegee, c’est ce qui est dans la lumière se détachant très distinctement de l’arrière-plan, assombri. Pour autant, le noir de ses photographies n’est pas anodin, il n’est pas la fin ou la limite de l’image et du discours, sa présence est telle que l’on en vient à se demander ce qu’il s’y cache. Weegee excellait dans cette technique, et c’est en cela que ses photographies sont non seulement incroyablement efficaces, autant que parfaitement reconnaissables entre mille. Les images de Weegee c’est du noir et blanc pur et dur, brutal, donnant à ses sujets une place centrale tant ils sont éclairés, quand le reste disparaît puisqu’occulté par opposition à la lumière en un contraste extrême. On ne voit qu’eux, et quelques autres éléments, précisément choisis, qui viennent s’inscrire là comme autant d’indices d’une enquête à mener. Weegee est vif, malicieux, il saisit tout du drame de l’instant autant que l’ironie qui s’y joue parfois, et il n’hésite pas à intégrer des détails dans ces photographies comme autant de traits d’esprits. Ainsi cette photographie du corps d’un automobiliste ayant périt dans une collusion avec un pilier en feu, où il prendra soin d’intégrer dans le cadre, l’enseigne de cinéma qui se trouvait là et où était inscrit « Joy of living » (Joie de vivre)... C’est aussi en cela que s’est démarquée l’œuvre de Weegee, une vérité crue, souvent teintée d’impertinence et pourtant toujours empreinte d’une forme de tendresse. Comme s’il voyait l’ironie de la vie au-delà de la tragédie, ou peut-être son humour lui rendait la violence de tout cela plus supportable, ou encore était-ce là une forme d’acceptation de notre condition, de notre humanité ? Toujours est-il qu’à ma connaissance et dans l’histoire du photojournalisme, aucun autre photographe ne s’est aventuré à user de l’humour comme élément de lecture dans des images qui révèlent des scènes à l’issue fatale.
New York s’incarnant en Weegee, sa ville comme une seconde peau. Weegee a tout photographié, plus exactement tout le monde, des plus modestes aux plus privilégiés, et il en a immortalisé toutes leurs facettes. Que ce soit dans le désespoir ou l’arrogance, la vanité, la futilité, ou le désir, les hommes et les femmes qu’il a photographiés forment à eux tous un véritable portrait sociologique et psychologique de New York, où personne n’aura été épargné. La relation du photographe à sa ville et ses habitants, est celle d’un couple fusionnel, où l’un en vient à se confondre avec l’autre, Weegee est New York, et New York est Weegee. C’est une vision frontale, intime et impudique, presque charnelle, aussi tendre qu’houleuse et souvent sarcastique que le photographe pose sur sa ville. Il semble inventorier l’effervescence de ses rues comme on étudierait des manifestations de la psyché humaine, il s’amuse de ses débauches, sonde ses tribulations. Il le fait avec une acuité si troublante qu’on ne peut l’expliquer que par une incroyable sensibilité et l’on pourrait en venir à se demander si Weegee ne se retrouvait pas lui-même dans cette profusion de portraits. Ainsi, New York ville de contrastes, haut-lieu du rêve américain où rien n’est impossible, a rendu possible l’existence même du photographe. En embrassant la cité, de son macadam à ses gratte-ciels, il s’est de la même façon hissé du statut de modeste immigrant des quartiers pauvres à celui de star de la photographie, à la fois témoin et acteur, Arthur Fellig est devenu Weegee The Famous !
A la vie, à la mort, des mots qui sonnent comme un serment, comme une déclaration de Weegee à sa ville, ses habitants, la photographie. Des mots qui résument l’œuvre du photographe, dans lesquels on retrouve l’ensemble des sujets qu’il a exploré et figé à coups de flash. C’est précisément parce que la vie et la mort sont les deux faces d’une même pièce que Weegee traitait de l’une et de l’autre indistinctement, et que j’ai choisi cette photographie. Car ici, en un ingénieux choix de point de vue, la vie et la mort se trouvent réunies sur une seule face, celle d’un tirage argentique. Montrer la mort du point de vue des vivants, est tout autant précurseur qu’unique, et témoigne assez bien selon moi du regard de Weegee sur le monde, de son intelligence et son habileté à exposer la nature humaine autant que sa condition. « Their first murder » (leur premier meurtre) présente cette originalité que la photographie donne à voir une scène de crime sans cadavre. Lorsqu’elle a été publiée par le PM Daily, 9 octobre 1941, l’image était accompagnée de l’article suivant : "Des écoliers de Brooklyn voient un joueur assassiné dans la rue. Les élèves quittaient le P.S. 143, [6th Ave. & Roebling St.] dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn, à 15h15 hier lorsque Peter Mancuso, 22 ans, décrit par la police comme un petit joueur, s'est arrêté dans une Ford 1931 à un feu rouge à un bloc de l'école. Un tireur s'est approché de la voiture, a tiré deux fois et s'est enfui à travers la foule d'enfants. Mancuso, touché à la tête et au cœur, a lutté jusqu'à la portière et s'est effondré mort sur le trottoir. Ci-dessus, certains des spectateurs. La femme âgée est la tante de Mancuso, qui vit dans le quartier, et le garçon qui tire les cheveux de la fille devant lui est son fils, qui se dépêche de s'éloigner d'elle. Voici ce qu'ils ont vu lorsqu'un prêtre, flanqué d'un médecin ambulancier et d'un détective, a prononcé les derniers sacrements de l'Église sur le corps." La photographie est en adéquation absolue avec son sujet, frontale et brutale elle nous montre une multitude de visages mêlés les uns aux autres, en une agitation palpable et chaotique. Et pourtant au cœur de ce tumulte, se dessinent deux lignes de construction particulièrement dynamiques positionnées en croix. L’intersection formée par le croisement des deux diagonales est légèrement décentrée vers la droite de l’image, accentuant l’effet de surprise et de panique de la scène, comme si le photographe n’avait lui-même pas eu le temps de bien cadrer et centrer son image, mais, ce serait là mal connaître Weegee dont l’œil et la technique sont aguerries par des années de pratique de la photographie dans des circonstances plus complexes les unes que les autres. Ainsi, la majorité des protagonistes présents se trouvent concentrés sur les deux tiers gauche du cadre, alignés sur une diagonale ascendante qui vient mettre en exergue le visage le plus saisissant d’entre tous à l’emplacement central de la croix : la petite fille au regard inquisiteur. Au-delà de la puissance formelle de la photographie dans la force et le rythme créés par sa composition et ces contrastes, c’est le point de vue abordé qui la rend magistrale.
Montrer la tragédie, l’exhiber sans en montrer son objet, la rendre vivante et tangible, manifeste. La violence n’est plus dans les traces de sang s’échappant de blessures fatales, elle n’est plus dans la forme triste d’un corps auquel on a arraché la vie, Weegee l’a déplacée pour mieux nous la rapporter… Car après tout, que ressentons nous réellement face à l’image d’un cadavre dont nous ne connaissons pas l’identité, la dépouille d’une personne que nous ne connaissions pas ? En choisissant de photographier la foule, Weegee a trouvé le moyen de personnifier l’horreur, la douleur, et tout le panorama des émotions qui peuvent traverser des êtres confrontés à une telle scène, plus encore si la victime est un proche. Sartre disait : « l’enfer c’est les autres », certes, mais dans cette image, c’est dans les yeux des autres que Weegee nous donne un aperçu de l’enfer, celui des sentiments qui se bousculent dans les esprits comme tous ces enfants se bousculent les uns les autres. Et ces émotions que nous voyons sur leurs visages, nous pouvons les lire car nous les connaissons toutes, personnellement. Nous avons tous ressenti la douleur dans la perte d’un être proche, et face à l’injustice et la violence, n’avons-nous pas ressenti la colère, la peur, la fureur, le doute, ou l’incompréhension. Devant un évènement soudain et un attroupement n’avons-nous pas été curieux, ne sommes-nous pas tous un peu voyeurs parfois même ? Et puis de temps à autres il y a l’égo, indifférent à tout ce qui ne le concerne pas, que nous ne savons retenir, surtout face à la caméra, et qui nous fais agir de façon irrationnelle dans l’excitation du moment comme celle de se mettre en scène tout sourire devant l’objectif ? Chaque visage de cette photographie est l’une de ces émotions, vécue par eux et par nous. En déplaçant le point de vue, Weegee nous implique, nous atteint, il a personnifié l’horreur en une multiplicité d’émotions tangibles, dont nous ne pouvons-nous dérober, même face à une photographie !
Weegee : blog consacré au photographe: https://weegeeweegeeweegee.net/
Weegee : photographies: https://www.gettyimages.fr/photos/weegee
Weegee tells how :
James Nachtwey for Time : “opioid addiction America” n°37 – Alcalde, 4 février 2018
“Opioid addiction America” n°37 – Alcalde, 4 février 2018 est une photographie de James Nachtwey, issue d’une série commanditée par Time magazine. James Nachtwey est connu pour avoir photographié des zones de désolation, de crise, de conflits partout dans le monde, et en particulier dans les régions les plus enflammées et dévastées par la guerre. Jusqu’au jour où, en 2018, Time Magazine lui demande de parcourir son propre pays pour documenter les ravages de la toxicomanie.
Photographe de guerre, à quoi ça sert, d’être là, voir tout ça et ne pas intervenir ? Voilà des propos que l’on peut entendre parfois, et même s’il s’agit là d’enfoncer des portes ouvertes, je pense qu’y consacrer un paragraphe n’est pas vain. Je peux comprendre cette réaction, surtout face à des images particulièrement poignantes et tragiques, mais alors, si ces images provoquent ces réactions c’est qu’elles ont atteint leur objectif. Le rôle et le métier du photographe n’est pas celui d’un militaire, ou d’un politique. Il n’en a pas la vocation, ni les compétences, il n’a pas la même puissance d’action. Et s’il pouvait intervenir, ne serait-ce qu’une fois, cela changerait-il la donne ? Il en va de même pour chacun d’entre nous. S’il nous était possible d’intervenir, en serions-nous seulement capables face aux scènes qui se dérouleraient cette fois devant nos yeux plutôt que derrière nos écrans ou dans les pages d’un magazine ? Il faut cesser de penser que nous en aurions le courage, que dans l’action, nous saurions garder notre sang-froid et immédiatement savoir comment réagir... Le photographe de guerre agit, il va jusqu’à mettre sa propre vie en péril pour nous informer du péril des autres. Une autre de ses forces est justement de ne pas se laisser dépasser par ses propres émotions, de ne pas réagir, interférer, lorsqu’il est face aux horreurs qu’il doit cadrer, assez pour que son image, son témoignage, nous atteigne. Le postulat de Nachtwey, tel qu’il l’affirme est le suivant : « J’en ai été témoin, et ces images sont mon témoignage. Les événements que j’ai enregistrés ne doivent pas être oubliés et ne doivent pas se répéter. » James Nachtwey agit, il rend compte de ce qu’il voit, jusqu’à ce que nous ne puissions plus ignorer ces drames qui s’abattent sur d’autres que nous, jusqu’à ce que nous nous sentions tellement horrifiés que nous ne puissions plus regarder sans réagir. Il agit pour que nous réagissions, il est seul, nous sommes nombreux, et c’est sur cette puissance là que reposent ses objectifs et ses espoirs de changer les choses. Nachtwey est devenu photographe de guerre parce qu’il croit au pouvoir des images, leur pouvoir d’émouvoir, d’influencer, de dénoncer, il en a fait sa ligne de conduite, et jamais il n’en a dévié. Il s’est donné une mission, et pour la mener a bien il se sert des outils qu’il a à sa portée, sa photographie et la presse. Voici ses mots lors d’une interview pour Polka magazine : « Le but de mon travail est de documenter notre histoire contemporaine et de la montrer dans les médias de masse [...] afin qu’il soit vu par le public le plus large possible. Celui-ci doit voir et savoir. Plus la société est informée, plus il est possible de mettre la pression pour qu’une situation inacceptable change. Quand un sujet est dans l’œil des médias, cela peut aider à mettre plus de pression sur les politiques. Et parfois, ils peuvent se sentir obligés d’agir. C’est le rôle essentiel de la presse, selon moi. »
Aller au bout du monde et être toujours plus proche. C’est à cela que l’on reconnait les images de Nachtwey, comme si le photographe avait pris au mot Robert Capa lorsque ce dernier affirmait : « Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près ». Nachtwey va là où la vie est mise à mal, par les épidémies, les catastrophes naturelles, les crises sociales. Il va là où plus personne n’ose s’aventurer, des zones tellement instables que seuls quelques combattants les foulent encore de leurs pieds aux côtés de civils anéantis. On reconnait souvent les images de Nachtwey par la sensation de proximité qu’elles suscitent, le sentiment que l’objectif est littéralement au cœur de l’action, à presque toucher les personnes qui se trouvent là, des victimes pour le plus souvent, des résistants aussi, ou parfois leurs bourreaux. Quand j’observe les images de Nachtwey je vois une photographie de contact, une photographie où les tragédies du monde s’incarnent au travers des êtres qui les subissent, des femmes, des hommes, des enfants, dont le visage ne sera plus jamais anonyme. Nachtwey, supprime la distance qui existe entre nos mondes en paix, et ceux emportés par la tourmente. Ces drames, s’ils étaient jusqu’alors loin de nos vies et de nos regards spectateurs, deviennent alors en l’image d’une personne, une réalité qu’on ne pourra plus se contenter de simplement la survoler. Le cadre est trop serré, le sujet est trop proche, si proche qu’on a le sentiment qu’on pourrait, nous aussi le toucher, et presque le connaître. Le sujet est si proche, que l’émotion contenue dans l’image en déborderait presque tant elle est palpable, et tout paradoxal que cela puisse paraître, au point d’en occulter aussi la présence même du photographe. Et c’est bien là la volonté de Nachtwey, nous amener au plus près de ces gens dont il saisit et fige la douleur, le désespoir, ou la colère, nous faire ressentir ce qu’ils vivent, nous impliquer. Il dit : « Je veux que le premier impact, et de loin, l’impact le plus puissant, soit une réaction émotionnelle, intellectuelle et morale sur ce qui arrive à ces personnes. Je veux que ma présence soit transparente. [...] Je veux enregistrer l’histoire à travers le destin d’individus singuliers [...], je ne veux pas montrer la guerre en général, ni l’histoire avec un grand H, mais plutôt la tragédie d’un homme unique, ou d’une famille. »
Et si le bout du monde n’était pas si loin... Si d’autres drames, tout autant dévastateurs qu’un conflit armé, se déroulaient chez nous, sous nos yeux, si proches qu’on en ne mesurerait pas l’ampleur... Si une guerre non déclarée s’abattait sur nos voisins, faisant en moyenne 150 victimes fatales par jour, sans rencontrer de réelle opposition. Imaginons une guerre qui ne serait pas civile, ou, qui n’opposerait pas deux puissances portant des noms de pays ou de religion, un combat qui ne serait pas une crise sociale ou une lutte des classes, une guerre qui aurait un autre visage que celui de la majorité des conflits identifiés comme tels au cours de l’histoire, cette guerre là n’a pas de nom et pourtant elle existe. C’est une guerre presque unilatérale tant il est difficile d’identifier et de localiser les forces en action. Ses principaux acteurs sont d’une part des criminels qui tuent à distance sans utiliser de puissance de feu, et d’autre part, leurs victimes qui les enrichissent. Cette guerre là ne peut pas se régler sur un champ de bataille, ni par des traités de paix, son seul point commun avec tout ce qui définit une guerre est le nombre de ses victimes. Quant à ses objectifs, s’ils sont économiques, ils le sont pour quelques individus et pas au nom d’une nation ou d’une communauté. Je précise que j’entends bien que le plus souvent les guerres sont menées pour des raisons économiques plus ou moins avouées, et enrichissent en particulier une poignée de privilégiés, mais celles-ci visent généralement à conquérir des marchés, des accès aux matières premières et autres sources d’énergie dans le but de développer le commerce extérieur, avec pour conséquence de préserver ou créer des emplois, de contrôler et maintenir les prix des énergies en import, enfin elles offrent une position économique et géopolitique au pays qui en sortira victorieux. La guerre qui se joue ici ne poursuit aucun de ces objectifs, elle étend son voile noir partout sur le monde, elle enrichit des individus, des dirigeants de laboratoires pharmaceutiques aux chefs de cartels, sans autre préoccupation que leur propre fortune, elle tue sans discernement, et ses victimes sont ceux-là mêmes qui la nourrissent.
On lui a donné le nom de « crise des opioïdes ». Ou encore celui « d’épidémie des opioïdes » pourtant, la situation est bien plus grave que ce que laisse entendre le mot « crise », quant à la notion d’épidémie, c’est dans son sens par extension qu’il faut aller chercher une concordance, la consommation d’opioïdes ne relevant pas de la médecine par sa transmissibilité, ni d’un phénomène dont les causes seraient naturelles. Il y a là une guerre qui n’est pas ouvertement déclarée et qui n’a pas trouvé d’opposition suffisamment forte pour mettre un terme à ses ravages. C’est en constatant le nombre croissant et exponentiel des victimes d’overdose que la presse a décidé de s’emparer du sujet, et que, l’hebdomadaire Time a choisit James Nachtwey pour le documenter. Selon le magazine : « Rien qu'en 2016, près de 64 000 Américains sont morts d'une overdose de drogue, soit à peu près autant que les pertes de l'ensemble des guerres du Vietnam, d'Irak et d'Afghanistan réunies. Plus de 122 personnes meurent chaque jour à cause de seringues d'héroïne, de gélules de fentanyl, d'un excès d'oxycodone. » Et ces chiffres n’incluent pas les morts violentes engendrées par le trafic, que ce soit celles des dealers lourdement armés, à la défense de leurs territoires, ou celles des victimes de balles perdues lors de règlements de comptes.
Sur le front avec les victimes, les premiers secours, la police. Au-delà des chiffres il y a la réalité, celle du terrain, qui propose une autre vision sans laquelle il est difficile de prendre conscience des drames qui frappent chaque jour, des êtres et leurs familles. Pour le photographe, la seule façon de sortir de l’abstraction des statistiques a été de voir de ses propres yeux qui sont ces personnes derrière les chiffres, d’aller à la rencontre des femmes et des hommes qui consomment, de ceux qui répondent à leurs appels de détresse, et ceux qui tentent de les sauver dans l’urgence. Nachtwey, fidèle à lui-même, est allé au plus près, au contact, proche de tous et de chacun, avec cette volonté de cerner la situation pour pouvoir la cadrer. Il a photographié des scènes qui se répètent sans fin, partout et au quotidien, les injections, les secours, les arrestations... Il a mis des visages sur les maux qui ravagent la population américaine depuis maintenant une décennie.
Un homme au sol, une femme se penche au dessus de lui. De toutes les images du reportage réalisé par Nachtwey, celle-ci montre à la fois l’impuissance du pouvoir face au fléau qui s’est abattu sur la population qu’il a promis de servir et protéger, et la spirale dans laquelle les toxicomanes sont emportés vers une fin bien trop souvent inéluctable autant que fatale. L’image se détache de la série par la simplicité de sa composition, son dépouillement, elle semble presque minimaliste comparée aux autres. Nous ne sommes plus dans les rues des cités américaines, l’homme et la femme sont seuls au milieu d’un paysage désertique, seule la voiture de l’agent de police nous indique qu’une route passe par là, nous reliant à la civilisation. L’homme est au sol et semble inanimé, ses yeux fermés, la bouche sèche et entrouverte. Il est étendu sur le dos, les bras en croix. La femme, debout, est penchée au dessus de lui, elle le regarde d’un air grave, comme si elle cherchait encore quelque traces de vie sur ce visage qui ne fait plus face qu’au ciel. La composition de la photographie est d’une redoutable efficacité, les lignes qui la construise nous mènent inexorablement vers l’homme tout en nous enfermant dans l’image. La voiture, masse noire coupée par le bord du cadre à gauche nous dirige au cœur de la scène, nous emmenant dans les pas de l’agent de police qui a répondu à l’appel lui indiquant où trouver la victime. On découvre le corps comme elle l’a découvert en suivant le chemin qui se poursuit sous ses pieds. De la voiture dans le tiers supérieur gauche, en passant par les bras de l’homme, et jusqu’à la bordure du chemin qui file vers le tiers inférieur à droite de la photographie, se dessine une diagonale, ligne maitresse, à laquelle notre sens de lecture ne peut se soustraire. Puis la silhouette de la femme placée dans le tiers droit de l’image sur toute sa hauteur vient stopper notre regard pour le ramener vers l’homme. Elle est penchée en avant sur le corps dans une position qui forme presque un angle droit, ses jambes parallèles au bord de la photo ferment l’image à droite tandis que son buste, parallèle au sol finit de former le cadre qui se dessine autour de la victime. C’est là, dans la position du corps en travers du chemin, qu’est inscrite la dernière ligne de force de l’image, une diagonale partant du crâne de l’homme depuis le tiers inférieur gauche de la photographie et se poursuivant au-delà de ses pieds, vers le désert. La dynamique de l’image réside dans l’association de ces lignes qui, réunies, forment un triangle duquel on ne peut sortir, pas plus que l’homme qui gît là, n’a pu échapper aux douloureuses conséquences de sa dépendance. On a le sentiment que cette image nous parle et dit : pour lui, la route s’est arrêtée là, il est parti, seul, au milieu de nulle part. Le choix du noir et blanc renforce aussi la dramaturgie de l’image, nous plaçant en peu au-delà du réel induit par la couleur que l’on a l’habitude de voir dans la plupart des reportages, en particulier ceux des journaux télévisés. La couleur peut parfois desservir la puissance narrative du sujet simplement parce que nous voyons tout en couleur. Le noir et blanc nous sort de nos repères, de notre quotidien. Il permet aussi d’exacerber les contrastes, faisant par là-même ressortir les lignes, les rythmes, les masses, tous les éléments graphiques qui révèlent la construction d’une image, les tensions qui s’y exercent. Comme d’autres photographes et pour les mêmes raisons, Nachtwey privilégie très souvent le noir et blanc, pour lui : « Si on montre le sujet en noir et blanc, on diffuse l’essentiel de ce qu’il se passe, sans compétition avec la couleur. » Dans cette photographie dont le sujet est tragique, et parce qu’elle est parfaitement exposée, il se créé un riche dialogue entre des noirs profonds et une très large gamme de gris. La puissance des noirs en contraste est adoucie par la place donnée aux gris qui couvrent l’image dans son ensemble.
La scène est tragique, l’image est belle. Voilà un constat qui sonne comme un paradoxe, et il y a bien là quelque chose de dérangeant. Pourquoi voyons-nous de la beauté là où nous est montrée la désolation, comment une scène tragique comme celle que nous présente Nachtwey parvient malgré tout à nous toucher par son esthétisme ? Lorsque je me pose la question, me viennent immédiatement à l’esprit les œuvres d’artistes tels qu’Otto Dix ou George Grosz acteurs majeurs de l’Expressionisme allemand et de la Nouvelle objectivité. Je vois aussi des œuvres de Géricault, Delacroix ou encore Goya... Et je me rappelle que la pratique est courante, depuis toujours en art. On ne peut pas ignorer que la peinture n’a pas attendu la photographie pour montrer le désespoir, les souffrances et les horreurs qui traversent l’histoire de l’humanité et brisent les êtres. Toutes ces œuvres ont traversé le temps et nous marquent encore aujourd’hui tant par les sujets qu’elles abordent mais aussi et peut-être surtout par la qualité de leur facture, par les choix esthétiques des artistes qui les ont réalisées. Alors, faut-il que l’image soit belle pour que nous nous arrêtions et prêtions attention au sujet qu’elle traite ? Et aussi terrible que cela puisse paraitre, il semble que oui. Nachtwey va dans ce sens et propose une explication que je rejoins assez pour en faire ma conclusion : « Le but de mes photos n’est pas qu’elles soient belles. Je ne suis pas à la recherche de cette esthétique, mais je sais la remarquer. La réalité est que beauté et tragédie coexistent partout. Ce n’est pas moi qui l’ai inventé. Regardez ce qui se fait en art depuis toujours ! S’il y a des références à des icônes religieuses dans mes photos, c’est tout simplement parce que ces représentations sont elles-mêmes inspirées par la beauté de la vie. Nous devrions plutôt nous demander pourquoi nous avons cette perception de la beauté. C’est peut-être un mécanisme humain nécessaire pour faire face à la tragédie, afin de ne pas lui tourner le dos. »
James Nachtwey : http://www.jamesnachtwey.com/
James Nachtwey - The opioid diaries : https://time.com/james-nachtwey-opioid-addiction-america/
James Nachtwey - War Photographer par Christian Frey (en anglais) :
https://archive.org/details/wphoto
James Nachtwey - War Photographer par Christian Frey (sous-titré/location) :
https://fr.cinefile.ch/movie/21082-war-photographer?streaming#
Diane Arbus : Lady Bartender at Home with Souvenir Dog, New Orleans, 1964
Cette photographie de Diane Arbus : « Lady Bartender at Home with Souvenir Dog » n’est pas de celles qui sortent en premier dans les résultats de recherche sur internet. Mais il n’en demeure pas moins qu’elle est tout à fait représentative du regard particulier de la photographe dans son travail de portraitiste. Diane Arbus est célèbre pour avoir initié une autre façon de pratiquer le portrait. Il y a toujours eu quelque chose de décalé dans son travail, que ce soit dans sa signature photographique ou dans les choix de ses sujets.
A une époque où l’Amérique toute entière affichait sa réussite, la grande majorité des images produites véhiculaient le modèle de société qui s’y était construit, richesse et abondance, intérieurs fonctionnels à souhait pour le confort de la ménagère moderne... L’esthétisme des habitations de banlieues fraichement sorties de terre, autant que celui des codes vestimentaires, et jusqu’à la musique diffusée en radio, correspondant en tous points à celui d’un modèle de société normalisé, célébrant la famille modèle d’une classe moyenne heureuse, épanouie, ayant réussi. Pour autant tous les américains ne rentraient pas dans ce moule. Artistes, marginaux, excentriques, quelles que soient les étiquettes, nombreux sont ceux dont l’existence ne s’accordait pas à ce modèle, que ce soit par manque de moyens, ou simplement par choix. Et c’est vers ceux-là que Diane Arbus a finalement choisi de diriger plus particulièrement son objectif, quelques années après avoir œuvré avec succès dans la photographie de mode et de publicité en compagnie de son mari Allan Arbus.
Diane Arbus a bâti sa carrière de photographe en sens inverse. En effet nombreux sont les photographes de mode ou de publicité qui ont fait leurs armes en commençant par capturer la rue et ses sujets, les personnes de leur entourage ou croisées dans la rue. Ajustant ce faisant leur technique et aiguisant leur regard. Diane Arbus, quant à elle, a débuté la photographie comme elle a débuté sa vie, issue d’une famille aisée, baignée dans un monde où les codes et conventions socio-esthétiques n’avaient rien en commun avec ce que pouvait vivre la grande majorité des américains ayant survécu à la grande dépression. Une éducation modèle, des études en école privée, faisant d’elle une jeune femme brillante et cultivée. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître c’est de cela dont elle souffrait et dont elle a cherché toute sa vie à se délivrer : « Je suis née en haut de l’échelle sociale, dans la bourgeoisie respectable, mais, depuis, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour dégringoler » disait-elle. Et sa carrière de photographe n’aura pas échappé à cette fuite en avant. C’est en épousant Allan Arbus qu’elle débuta avec lui la photographie de publicité et de mode, avec pour premier client la famille de Diane Arbus elle-même, propriétaire d’un grand magasin de luxe de la 5ème avenue. Ont suivi les plus grands magazines de mode comme le fabuleux Vogue du groupe Conde-Nast par exemple. Nourrie de l’esthétisme des magazines, et des photographes stars qui illustraient leurs pages tels que Richard Avedon, Diane Arbus ne pouvait cependant s’en satisfaire pleinement même si cela a probablement participé à construire son sens du cadrage, du travail de la lumière. Sa culture photographique ne se limitant pas aux images sophistiquées de la publicité et de la presse féminine, Diane Arbus s’inspirera aussi de photographes tels que Dorothea Lange, August Sander, Robert Frank, Brassai, Walker Evans ou encore Weegee avec son travail au flash et bien sûr Lisette Model qui sera sa professeure et amie. Ne lui restait plus qu’à trouver l’objet de sa photographie qui finira d’assoir sa signature.
De la mode à la rue, délivrance et révélation. Alors qu’elle est d’ores et déjà reconnue dans la photo commerciale et la presse féminine, Diane Arbus se voit proposer par Alexey Brodovich, alors directeur artistique du célèbre Harper’s Bazaar, de sortir des studios et d’aller dans la rue. C’est le déclic pour la photographe, elle va y trouver une nouvelle liberté, celle de construire son univers, d’aller à la conquête d’un monde dont elle a toujours eu le sentiment qu’il lui était inconnu, ou inaccessible, et pouvoir combler ce qu’elle ressentait comme un vide la dévorant : « Une des choses dont j'ai souffert en tant qu'enfant, c'est que je n'ai jamais ressenti l'adversité. J'étais confortée dans un sentiment d'irréalité que je ne pouvais ressentir que comme une irréalité. Et le sentiment d'être immunisée était, aussi ridicule que cela puisse paraître, douloureux. C'était comme si, pendant longtemps, je n'avais pas hérité de mon propre royaume. Le monde me semblait appartenir au monde. Je pouvais apprendre des choses, mais elles ne semblaient jamais être ma propre expérience ». Lucide et sensible, Diane Arbus pouvait enfin sortir du cadre, de son enfance et de sa jeunesse dorée qu’elle avait très tôt identifié comme une cage, un mur entre elle et la vie. Elle allait pouvoir exister, commencer à prendre possession d’elle-même, ses envies, ses choix, ses inclinations et sympathies.
Comme des aimants, les opposés s’attirent. Et les sympathies de Diane Arbus sont allées immanquablement vers tous ceux qui se trouvaient au-delà des murs à l’intérieur desquels elle avait évolué, où, comme dans un musée qui ne présenterait qu’une œuvre normée et conventionnelle, son regard n’avait jamais trouvé de quoi satisfaire son besoin d’appréhender la réalité toute entière, celle de tout ce qui échappait à la norme. Une réalité qui était peut-être aussi la sienne, dans les fractures qu’elle ressentait. C’est de New York au New Jersey, et dans tous les recoins de l’Amérique que la photographe va explorer, qu’elle pourra enfin voir jusqu’à toucher l’envers du décor, autant qu’elle aura été touchée par chacun de ses modèles, passants, artistes de cabaret, de cirque, monstres étranges des fêtes foraines, marginaux, aliénés, nudistes... A ce titre, on dit souvent de Diane Arbus qu’elle était la photographe des parias, pourtant à mes yeux il y a là quelque chose de réducteur dans la lecture de son travail, qui pourrait sous-tendre qu’elle aurait cherché à se marginaliser, ou se rebeller contre son milieu, ou pire encore verser dans le sensationnel pour marquer les esprits. Et cela peut en conséquence réduire aussi les pistes d’interprétations possibles de sa quête qui je pense est bien plus subtile, profonde et voir même instinctive que tout cela. Diane Arbus n’a pas photographié que des gens extra-ordinaires. Selon moi, elle a juste photographié ceux qui n’étaient pas du monde auquel elle appartenait, ceux qui n’entraient pas dans les normes d’une certaine société ou classe sociale, je crois qu’elle est tout simplement allée à la rencontre d’autres normalités, à la recherche d’un grand tout où chacun pourrait incarner sa propre norme.
Un chignon qui ressemble à une figurine de caniche à moins que ce ne soit l’inverse. Ou peut-être un chignon comme une couronne, comme une réponse au tableau en fil de fer, représentant la carte du roi de cœur, suspendu au mur. Voilà le portrait d’une serveuse, une barmaid à son domicile. Ni monstre de foire, ni artiste, ni aliénée, juste une jeune femme d’une autre classe sociale que celle dont est originaire Diane Arbus, et dont la plus grande originalité demeure dans l’extravagance de sa coiffure, soulignée ici par la figurine décorative d’un caniche en tissu qui vient lui faire écho. Alors même que les années 60 représentent l’apogée du chignon crêpé à souhait, celui qu’arbore la jeune femme flirte manifestement avec la démesure. Ses cheveux blonds peroxydés sont maîtrisés, structurés, sculptés et portés hauts sur la tête tels une coiffe d’apparat. Et c’est alors dans l’exubérance de sa mise en scène capillaire que la jeune femme « normale » devient un personnage remarquable, hors normes, se jouant des codes établis. Son port de tête est altier, elle pose, assise dans un fauteuil aux allures de trône, tandis que la position de ses jambes va à l’encontre des attendus en termes de convenances, si elle avait été issue de la noblesse ou de la haute société. Elle se veut élégante, en témoigne sa main droite avec son petit doigt levé, et son port de tête, autant qu’elle semble sûre d’elle tant son regard est franc et direct. Tout semble se répondre et s’équilibrer dans cette photographie de Diane Arbus. De la force, comme une affirmation, dégagée par la coiffure et l’attitude de la jeune femme à laquelle vient répondre la figurine kitsch du caniche, dont la présence pourrait toutefois et à contrario suggérer une forme de douceur, de besoin d’affection. L’idée qu’elle porte sa coiffure comme une couronne est appuyée par la présence discrète derrière elle de la décoration en fil de fer représentant la carte du roi de cœur. Dans la forme de l’image aussi, nombreux sont les éléments en correspondance plastique. Les finitions en spirale du meuble métallique, sur lequel trône le caniche, renvoient aux boucles placées de part et d’autre de la coiffure. Le sol en damier, comme un plateau de jeu d’échecs où la jeune femme serait reine, est constitué de grands carreaux de granito à l’aspect tout aussi graphique et rythmé que le gilet imprimé de motifs léopard de sa tenue.
Quand une photographie ne peut exister qu’en noir et blanc. Difficile d’imaginer cette photographie de Diane Arbus en couleur, tant elle tire sa force et son sens de ses contrastes. Les gris, bien que présents s’effaceraient presque devant la profondeur des noirs et la luminosité des blancs. Les lignes qui rythment la photographie, qui affirment sa composition sont parfaitement lisibles précisément grâce au noir et blanc employé ici. Les éléments de lecture sont distribués de part et d’autre de l’image, avec à gauche et à mi-hauteur le caniche sur le meuble et à droite sur toute la hauteur, la jeune femme. L’image est frontale bien qu’elle présente une légère plongée ainsi qu’une perspective horizontale dessinée par la ligne de la plainte partant du premier tiers gauche pour se terminer en bas à droite. Les noirs et blancs s’opposent autant que les éléments graphiques constitués de formes sphériques d’une part avec le chignon, le caniche, une coquille Saint-Jacques, les finitions du meuble en acier chromé et avec, d’autre part, des formes particulièrement anguleuses dessinées par les dalles du sol en damier, la position des bras et des jambes de la barmaid. Dans la lecture de l’image, le regard est dirigé avec force et enfermé dans un triangle formé de puissantes lignes de construction. Une première diagonale se dessine entre la figurine du caniche et le chignon de la jeune femme, puis une autre ligne descend le long de son dos jusqu’à sa bottine de cuir, enfin une troisième diagonale suit son mollet jusqu’à son genou pour ramener le regard sur le caniche.
Une reine d’un jour telle une gravure de mode. Bien que cette photographie de Diane Arbus s’inscrive dans la lignée du travail de portrait qu’on lui connaît et qui a fait sa notoriété, elle prend malgré tout des airs de photographie de magazine. Et c’est précisément pour cette raison que je l’ai choisie, pour mieux illustrer en quoi les images de Diane Arbus se situent à la confluence de la photographie de mode et de la photographie de reportage, une image qui pourrait représenter la transition de la photographe passant des studios à la rue. Diane Arbus nous présente ici une jeune femme qui se met en scène, qui pose, au milieu du décor qu’elle a créé pour son intérieur. Pourtant il n’y a pas un élément, que ce soit dans son style vestimentaire, sa coiffure, ou dans son intérieur qui ne semble ne pas être à sa place. Comme dans une photographie de mode, tout semble organisé, composé, scénographié. Il y a une forme d’élégance et de sophistication qui se dégage de cette image, tant dans ce qu’elle présente que dans la façon dont elle est construite. Ce portrait est une belle démonstration de la photographe quant à sa maîtrise de la composition assurément graphique et de la lumière où elle associe une source naturelle à son flash. Diane Arbus a participé à la reconnaissance, si ce n’est à la création, d’un style de photographie à la croisée de la photographie commerciale et de la photographie de presse, ses images n’étant ni l’une ni l’autre, elles sont pourtant un peu de chaque. Reprenant d’une part les codes de mise en valeur des sujets propre à la mode et la publicité dans la composition ou la lumière, et appliquant cela à la photographie documentaire, il en ressort des portraits ou chaque individu revêt le costume du premier rôle d’un film qui n’est autre que celui de sa vie. Pour autant la photographe n’a jamais eu recours aux artifices de la photographie commerciale pour « mettre en beauté » les femmes et les hommes qu’elle choisissait de photographier, il n’y a jamais eu de complaisance esthétique envers ses modèles dans son travail toujours très direct et absolument frontal. Seuls son regard, son empathie et sa profonde sensibilité envers ceux qu’elle immortalisait suffisaient à retranscrire la force et la beauté qu’elle avait su saisir, comme instinctivement, à leur contact. La présence est ce qui ressort magnifiquement de l’œuvre de la photographe comme une réponse à celle qui s’est toujours questionnée sur la représentation et la juste distance ou la proximité idéale entre elle et son modèle, interrogeant et selon ses propres mots : « l'espace entre qui est quelqu'un et ce qu'il pense être ».
La distance devenue intimité, l’essence de la photographie de Diane Arbus. D’un monde à l’autre, Diane Arbus a passé sa vie à se rapprocher, par la photographie, de ceux qui étaient le plus éloignés de tout ce qu’elle avait pu appréhender et connaître depuis son enfance jusqu’à sa vie avec Allan Arbus dans la photographie commerciale et de mode. Elle n’avait jamais complètement été la jeune fille qu’elle était sensée devenir et elle avait le sentiment profond que quelque chose lui manquait, qu’une partie de la vie et d’elle-même lui échappaient. C’est une porte vers une deuxième vie qu’elle a ouverte lorsqu’elle a décidé de rompre avec sa carrière dans la mode pour se destiner à sa quête « des autres ». Décidée à se consacrer à une autre photographie, tournée cette fois vers ceux que l’on ne regarde pas, et dont elle disait : « je crois vraiment qu’il y a des choses que personne ne verrait si je ne les photographiais pas », c’est par eux qu’elle va trouver la reconnaissance de son art, et, en eux qu’elle va d’une certaine façon se reconnaître. Il existait une réelle proximité entre la photographe et ses modèles, tant physique dans ses prises de vue frontales, des portraits, qu’humaine dans les liens qu’elle créait avec eux. Une proximité telle que la ligne la séparant de l’intimité s’effaçait presque. Ils ont été à eux tous, les failles, les manques et les vides dont très tôt elle a eu le sentiment qu’elle devait les trouver, les identifier et les embrasser pour pouvoir enfin vivre dans le monde réel et peut-être trouver sa plénitude. On dit souvent que rien n’est tout blanc ou tout noir, et Diane Arbus le sentait dans ses entrailles. Elle n’a jamais su être la jeune fille modèle qu’on espérait, parfaite dans un monde parfait, et souffrait d’être privée des zones d’ombres qui font qu’un être puisse prendre toute sa dimension, autant que la vie puisse suivre son cycle fait de hauts et de bas sans linéarité aucune. Car après tout, pourrait-on imaginer une photographie entièrement blanche, sans ombres pour dessiner les reliefs du monde ?
Diane Arbus :
Mary Ellen Mark : Tiny blowing a bubble, Seattle, 1983
En 1983 à Seattle, devant l’objectif de Mary Ellen Mark, se tient Erin Blackwell immortalisée sur le désormais célèbre cliché : « Tiny blowing a bubble ». Ce portrait est je pense l’un des portraits clés d’une longue série de photographies nous révélant une œuvre qui a commencé avec une très jeune fille, à qui le destin n’a pas vraiment souri, comme s’il n’avait jamais voulu lui accorder de ressembler ne serait-ce qu’un tout petit peu à ses rêves.
Tout le monde l’appelait Tiny, certainement parce que du haut de ses 13 ans, elle n’était pas bien grande et encore toute fine, à mi-chemin entre son corps d’enfant et son corps de jeune femme. Son vrai nom, c’était Erin Blackwell, et c’est elle qui a inspiré « Streetwise », le reportage photographique de Mary Ellen Mark qui raconte 30 ans de sa vie, mais aussi le documentaire réalisé par Martin Bell, l’époux de la photographe. La vie de Tiny, c’est une histoire qui ne commence, ni ne finit, comme un conte de fées, mais Mary Ellen Mark a immédiatement su qu’il fallait la raconter. Du moment où elle a aperçu pour la première fois la jeune fille, est née son envie de la photographier, puis de l’accompagner un peu plus, au fil des ans, témoigner d’elle et de sa vie, en images. Il est assez rare pour que ce soit remarquable qu’un photographe élabore une série de clichés à la fois sur un personnage et sur une aussi longue période. Et c’est en cela aussi que le travail de Mary Ellen Mark se distingue dans la photographie contemporaine. Et si le récit de la vie d’Erin fait sens au travers d’une lecture chronologique des clichés de Mary Ellen Mark, pour autant chacune des images réalisée par la photographe, chacun de ces portraits peut être apprécié indépendamment tant ils sont riches d’évocation, d’émotion, de discours, et témoignent tous de la personnalité magnétique de Tiny, une enfant-femme.
Une jeune fille charismatique, singulière, étonnante, comme un petit bout de lumière au milieu du clair-obscur de la rue et de la vie que peuvent y mener des enfants livrés à eux-mêmes. Les trottoirs de Seattle vécus comme un terrain de jeu dont ils préféraient ignorer les dangers, où plus exactement peut-être, comme un espace de liberté qu’ils espéraient pouvoir dompter, maîtriser, et y vivre pleinement leur fureur de vivre. Et puis à cet âge comment se méfier de la liberté et de la ville, comment imaginer que la liberté soit autre qu’inoffensive. Il ne peut en être autrement quand on a 13 ou 14 ans, la liberté c’est beau, c’est la clé, et la ville c’est la vie. Abandonnés à leur sort par des parents absents ou démissionnaires ou dépassés, ces enfants là n’avaient, pour certains, pas de meilleure alternative que la rue, pour d’autres, ils avaient choisi d’être libres, d’y vivre, de vivre intensément, plutôt que d’avoir le sentiment de s’éteindre chez eux, au sein d’une famille qui n’en portait possiblement que le nom. C’est avec eux que Tiny partageait ses journées et parfois ses nuits, eux, et les clients... A ces âges là, arpenter les trottoirs de la ville avec les copains ce sont des jeux, parfois des querelles, c’est exaltant, c’est l’impression d’être libre et tout puissant, d’être déjà un adulte qui fait ses choix, qui contrôle sa vie et fait ce qu’il veut. Pour une enfant, c’est se maquiller un peu plus fort et se donner des airs de jeune femme afin de leurrer le videur, passer la porte de la discothèque et aller faire la fête, danser jusqu’à s’oublier. C’est fardée, devant une boîte de nuit, que Mary Ellen Mark a remarqué Erin la première fois, et a tenté de l’approcher, sans succès. L’adolescente intuitive et farouche, s’est échappée redoutant que la photographe soit une policière. Mary Ellen Mark a été marquée par sa présence en une vision pourtant fugace, elle se distinguait des autres enfants, elle avait quelque chose de si particulier que la photographe ne pouvait l’ignorer, au point de devoir la retrouver pour établir le contact, créer un lien assez fort pour que Tiny l’autorise à la prendre en photo.
Des prostituées, des proxénètes, des dealers, des drogués et des vagabonds, c’est ce qu’on dit des sujets que photographiait Mary Ellen Mark, pourtant tout cela est terriblement réducteur, comme si l’on pouvait résumer l’existence d’un être à sa seule activité, plus encore lorsqu’il s’agit de survie. Mary Ellen Mark a pour sa part vu des enfants désireux certes mais de vie, de sensations, d’émotions. Des enfants avec encore des rêves plein la tête. Et ce sont peut-être les rêves d’Erin qui faisaient son aura, une émanation si lumineuse que la photographe l’a immédiatement perçue. Avec le temps, les échanges et rendez-vous informels entre Mary Ellen Mark et Tiny se sont multipliés, assez pour que l’enfant confirme avec ses mots les sentiments que la photographe avait ressenti au premier regard. Tiny avait des rêves de petite fille, des projets, des envies comme celles de porter diamants et fourrures ou d’avoir son propre élevage de chevaux, sa passion. L’enfant aurait aimé être une dame, et c’est ce que Mary Ellen Mark a commencé à photographier en 1983 puis durant 30 ans, des rêves confrontés à une réalité toute autre incarnée en une jolie et captivante jeune fille, son ambivalence, l’écart qui se creusait chaque jour un peu plus entre ce qu’elle espérait et ce que la vie lui rendait. Mary Ellen Mark a photographié l’existence d’Erin comme autant de contrastes, de passages entre ombre et lumière, témoignant sensiblement de l’esprit d’une enfant qui croyait pouvoir maîtriser ses options alors qu’elle savait que finalement la vie en déciderait autrement. Car tout enfant qu’elle était, la demoiselle avait l’esprit vif et aurait pu, si son passé et ses choix ne l’avaient rattrapée, saisir les opportunités que lui apportèrent le succès du travail de Mary Ellen Mark et Martin Bell avec Streetwise. En effet, peu après la sortie du reportage de Mark dans Life magazine ainsi que du documentaire de Bell, Hollywood a proposé le scenario d’un film à la jeune fille devenue muse, mais celle-ci ayant abandonné l’école avant la fin de la 6ème et sachant à peine lire, les producteurs ont dû renoncer au projet. Le couple a aussi proposé à la jeune fille de l’adopter à condition qu’elle accepte de retourner à l’école. Tiny, a refusé et préféré poursuivre sa route, elle a continué de vivre comme elle l’entendait, déterminée, assumant ses choix, elle a connu la drogue et les centres de désintoxication, alterné ses allées et venues entre la rue et le foyer maternel, et est devenue mère de 10 enfants.
Je viens d’avoir 14 ans et je m’habille comme une dame. Ce portrait de Tiny par Mary Ellen Mark résume avec force la personnalité de la jeune-fille, certains évoqueraient une femme-enfant tandis qu’à mes yeux ce serait plutôt l’inverse, l’idée d’une enfant qui joue à être femme. Un jeu pourtant dangereux à cet âge, que seule une aveuglante défiance autorise. Ce jour là lorsque Mary Ellen Mark est venue rendre visite à sa muse, elle était déjà habillée, apprêtée, elle avait soigneusement choisi une robe noire sobre et élégante, des gants noirs, un bibi dont la voilette vient envelopper le visage jusqu’au bas du nez. Quant à la résille de la voilette, ses mailles sont assez larges pour ne pas voiler le regard. Tout est là, le message qu’envoie Erin de sa personnalité tient dans ce qu’elle a choisi de porter et son attitude. La voilette nous laisse entrevoir son visage tout en nous en fermant l’accès. Elle représente une féminité derrière laquelle pourtant transparait encore l’enfant qui continue d’exister dans ce corps fragile. Comme si Tiny était déterminée à se montrer sous son visage de femme tout en essayant de masquer l’enfant qu’elle est toujours. Son regard est franc et pourtant ses yeux semblent encore plein d’une innocence enfantine. La voilette n’est pas assez longue pour occulter le bas du visage de la jeune fille, et de sa bouche sort une belle bulle de chewing-gum. Curieusement l’effet produit par cette bulle est inverse à celui de la voilette, et peut-être révélateur, du moins il témoigne de tout l’antagonisme sur lequel s’est construite la personnalité d’Erin. Car après tout, faire des bulles de chewing-gum est un jeu d’enfant, une femme quant à elle favoriserait le rouge à lèvres pour se mettre en valeur. Mais en ce qui concerne sa bouche, sur cette image, Tiny semble préférer la préserver et lui rendre les quelques moments récréatifs d’une insouciance et d’une innocence qui lui ont échappé du jour où elle a préféré la rue à un quotidien auprès d’une mère alcoolique. L’histoire raconte que cette image a été prise au moment d’Halloween et que la jeune fille souhaitait se donner des airs de prostituée française en arborant sa petite robe noire ce qui n’a rien d’anodin tant celle-ci symbolise un classique de la garde-robe originaire de l’hexagone.
Mary Ellen Mark connaît la jeune fille et comprend chacune de ses postures, elle sait qu’elle est intelligente, sans faux-semblants, de leurs rencontres est né un véritable respect mutuel. La photographe sait que Tiny a délibérément choisi de se montrer de cette façon, et elle honore sa volonté en la photographiant tout aussi directement que la jeune fille se présente. L’image est donc frontale, c’est un portrait, en plan serré ou plan poitrine, avec Erin en son centre, droite, faisant face à l’appareil. La photo est au format paysage, elle est composée d’un arrière-plan flou de part et d’autre de l’adolescente qui, quant à elle, se dessine très nettement en premier plan. Derrière elle sur sa droite, et s’éloignant vers ce qui pourrait être un mur ou un portail, on distingue une route ou un chemin non entretenu sur lequel se succèdent des flaques d’eau reflétant un ciel gris. Toujours derrière elle mais à sa gauche on aperçoit une maison bordée de quelques arbustes. L’endroit semble déserté, abandonné, triste, et la jeune fille semble s’en éloigner, tant elle se détache dans son attitude de ce paysage presque désolant. La photographie est dans un noir et blanc présentant de très fines nuances de gris autant qu’une belle profondeur dans les noirs, et le noir de la robe d’Erin participe à mieux dégager sa frêle silhouette de cette rue qui semble sans issue. La tenue de la jeune fille contraste aussi par son graphisme, les lignes sont franches, nettes, géométriques, composées de courbes qui se répondent les unes aux autres, concaves au niveau du décolleté et convexes à partir de la voilette, suggérant l’idée d’un cercle invisible qui encadrerait le visage de Tiny. Tout comme le cercle que l’on retrouve au centre de l’image avec la bulle de chewing-gum et qui de ce fait devient le point d’accroche du regard sur la photographie.
Cette buIle de chewing-gum est ce qu’il reste de la part enfantine d’Erin et il est aussi une provocation, comme un pied de nez à la vie, à cette réalité désenchantée qu’est devenu son quotidien. Il est un bouclier et une ultime bravade, le témoignage de sa détermination à vivre comme elle l’entend quoi qu’il en coûte, à croire encore qu’elle seule a décidé de son destin et qu’en rien elle ne serait qu’une victime collatérale de la misère sociale, l’échec scolaire ou l’alcool et la drogue, la prostitution... Et surtout continuer à croire que la rue en laquelle elle pensait avoir trouvé refuge, ne la détruirait jamais.
Mary Ellen Mark : https://www.maryellenmark.com/
Tiny le film : https://www.maryellenmark.com/
Tiny : the life of Erin Blackwell, bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=rWbWUHFbICE
Streetwise, bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=MWhExsCeoqI
Tiny Revisited, Interview Mary Ellen Mark et Martin Bell : https://www.youtube.com/watch?v=9l137gN6KaE
Vivian Maier : Self-Portrait, 1954 - VM1954W02936-11-MC
Au détour d’une rue, d’une vitre, d’un reflet, voici qu’apparaissent deux femmes, ou trois, ou encore et finalement, peut-être une seule femme, Vivian Maier. Avec Self-Portrait, cet autoportrait daté de 1954, la photographe brouille les pistes dans une image construite d’une multitude de reflets, mais dans le fond, ne serait-ce pas un peu les mille et une facettes de son art et un morceau de sa mystérieuse personnalité qu’elle révèle ici.
Vivian Maier est une photographe dont on ne sait que très peu de choses, on sait d’elle qu’une partie de sa vie était consacrée à son métier de gouvernante et l’autre, parallèlement, à la « street photography ». Au-delà, cette femme au caractère secret n’a jamais rien révélé d’elle-même, de sa relation à la photographie, autant qu’elle n’a jamais révélé au monde ses clichés. Et, de sa personnalité on ne sait que ce que les rares personnes qui l’ont côtoyée ont délivré : « Elle était excentrique, forte, opiniâtre, intellectuelle et discrète. Elle portait un chapeau souple, une longue robe, un manteau de laine et marchait avec une foulée puissante. Avec un appareil photo autour du cou chaque fois qu'elle quittait la maison, elle prenait des photos de manière obsessionnelle, mais ne les montrait jamais à personne. »
La photographie de rue suppose généralement de se faire discret, de s’effacer, pour mieux capturer les scènes qui se présentent au gré des pérégrinations du photographe et devant son objectif. Que ce soit par sa personnalité, sa profession ou son allure, dont rien ne témoignait de son extraordinaire talent, Vivian Maier remplissait aisément une partie de ce contrat tacite, celui de l’invisibilité du photographe de rue. Et pourtant une grande partie de sa production photographique la représente elle, se rendant délibérément visible au cœur de ses images. On la voit dans des reflets de vitrines, de miroirs, de chromes, elle dessine aussi sa présence dans l’ombre portée de sa silhouette sur les sujets qu’elle saisit, elle ira jusqu’à utiliser son propre reflet pour révéler à travers lui, ce qu’elle photographie. Et c’est de cela en particulier qu’il s’agit dans ce cliché de Vivian Maier : Self-Portrait, 1954.
C’est avec un Rolleiflex et son format carré que Vivian Maier a d’une certaine façon mis en scène cette vue. Et le choix de cet appareil photo n’est pas anodin. Certes il était l’un des appareils les plus utilisés de l’époque, mais il présentait aussi et dans le cadre de la photographie de rue, d’autres avantages. D’abord celui d’assurer une forme de discrétion au photographe, avec sa visée par le dessus, l’appareil se portait au niveau du buste, et une fois les réglages effectués, il était tout à fait possible d’appuyer sur le déclencheur en faisant mine d’être occupé à autre chose. L’autre avantage était qu’avec ce type d’appareil et de visée, c’était le photographe qui décidait d’avoir un contact visuel, ou non, avec son sujet. Sans contact visuel, là encore le sujet ne réalisait pas nécessairement dans l’instant qu’il était photographié, mais plus encore, le photographe se libérait aussi d’un quelconque lien, d’une interaction personnelle, avec ceux et celles qu’il était en train de fixer sur sa pellicule. Cependant avec le Rolleiflex, lorsque le photographe choisissait d’établir un contact visuel avec la personne qu’il photographiait, alors et à l’inverse des appareils reflex, le contact était direct et réel, les yeux dans les yeux. Vivian Maier a toujours judicieusement tiré profit de ce type de visée par le dessus, son œuvre compte autant de prises de vues « à la dérobée » que de prises de vues où il est clair que son sujet se savait photographié échangeant parfois un regard complice ou amusé avec elle, tant elle avait l’art d’approcher, littéralement, ceux et celles qu’elle souhaitait saisir.
« De toute façon, on se photographie soi-même quand on prend une photo » disait Denis Roche, ou encore et selon Nobuyoshi Araki : « Pour moi, la photographie c’est par définition se révéler à soi-même ». Il est un fait acquis, que quel que soit le sujet du photographe, c’est toujours lui-même qui est au centre de l’image, c’est toujours lui-même qu’il prend en photo, que ce soit en toute conscience ou non. Et le photographe de rue, même s’il est naturellement tourné vers l’autre, curieux de l’autre, révélateur de l’autre, n’échappe pas à cette règle. Vivian Maier en est à mes yeux l’un des plus illustres exemples, comme si, toutes ces autos-représentations qu’elle a réalisé visaient à incarner autant qu’affirmer l’omniprésence du photographe dans chacun des regards qu’il porte sur l’autre. Ainsi cet autoportrait de 1954 se présente réellement comme une fusion, celle de l’artiste et de l’objet de son image en symbiose, où la représentation de l’un autorise celle de l’autre et inversement. Comme si Vivian Maier s’autorisait à exister et se révéler en tant qu’être et photographe au travers de l’autre, tout en rendant l’autre tangible et manifeste, par elle, avec elle.
Être par la photographie, entièrement... C’est ce que pourrait avoir été purement et simplement le choix de vie de Vivian Maier. Car rares sont les photographes qui se sont autant incarnés dans leurs propres clichés, et plus rares encore sont ceux qui se sont uniquement consacrés à l’acte de photographier sans jamais chercher à proposer leur vision au regard des autres. Le regard des autres pour Vivian Maier, celui qui importe, est celui qu’elle photographie, celui qu’elle regarde et au travers duquel elle semble aussi se regarder. Son œuvre pourrait être comparée à un puzzle, celui de sa vie, une représentation d’elle-même et de tout son être, construite par fragments de regards croisés.
Je suis ce que je photographie, j’existe avec l’autre et il existe avec moi. Voilà ce que pourrait être le postulat de la photographie de Vivian Maier. Self-Portrait 1954 est une image que l’on pourrait contempler des heures durant, happé et fasciné par toutes les facettes qui la constitue, comme si l’on regardait dans un kaléidoscope. Il y a de la géométrie et des plans qui se multiplient, se répondent, interagissent les uns avec les autres, et pourtant rien ne bouge, plus encore, l’image par sa frontalité inspire le sentiment d’une indéniable stabilité. Vivian Maier maîtrisait incontestablement l’art du cadrage, ses photographies témoignent toutes de son habileté à déterminer exactement ce qui devait entrer dans le carré de son image et comment. Ici, il est question de symétrie dans la composition et d’équilibre des valeurs, et, la photographe en est l’axe central. Sa silhouette devient l’un des trois plans qui construisent l’image en parts égales. A gauche et derrière elle une voiture sombre dont les lignes se dessinent grâce aux reflets de la lumière sur sa surface lisse et brillante. A droite lui répond une camionnette qui se révèle de la même façon, sombre, lisse et brillante. Et puis, tout à fait au bord du cadre et en amorce on aperçoit une passante qui s’éloigne. Ces deux plans sont parfaitement identiques en ce qui concerne l’espace qu’ils occupent dans l’image et témoignent de la vitalité d’une artère New Yorkaise. Là où cette photographie prend tout son sens c’est par l’organisation complexe de ses plans dans la profondeur. En photographiant des reflets, ce qu’il se passe à l’extérieur et l’intérieur à la fois, ainsi qu’elle-même, Vivian Maier installe un décor qui sert un propos qui va bien au-delà d’une simple représentation de la rue, où d’un portrait à la dérobée, et elle donne une toute autre dimension à la « street photography ». Où se situe le premier plan, quel est le second plan, que voit on en premier ou en second, c’est certainement au cœur de ce questionnement que se trouve la clé de lecture de cette image, c’est peut-être même ce questionnement en soit qui détermine ici le propos de Vivian Maier. Dans Self Portrait 1954, l’œil n’a de cesse de faire des va-et-vient entre la silhouette sombre et graphique de la photographe, et les deux femmes qui se révèlent dans son reflet, en elle. Serait-ce alors une aberration que d’affirmer que le premier plan est ici invisible car il n’est autre que la vitrine qui offre à la fois transparence et réflexion réunissant en sa surface les trois femmes ? Le contraste veut que l’on remarque en premier la jeune femme dont la robe à carreaux noir et blanc se détache vivement à l’intérieur du cadre créé par le manteau noir de Vivian Maier. Puis naturellement, c’est vers la seconde femme, qui l’accompagne et s’adresse à elle que nos yeux se portent. Cependant et parce qu’elle est plus lumineuse dans sa tenue, la jeune fille redevient rapidement le centre d’attention et c’est alors que son regard nous ramène vers la photographe. La silhouette de Vivian Maier impressionne, par sa taille et sa stature. Ses deux pieds sont posés bien à plat sur le sol et ses jambes se confondent parfaitement avec celles des deux femmes. La photographe est coupée en deux dans sa hauteur par un muret agrémenté de plantes surplombant les deux femmes de la scène qu’elle est en train de fixer sur la pellicule. La moitié inférieure de son corps incarnant alors les femmes qu’elle photographie, tandis que la moitié supérieure lui revient, révélant ses mains, son appareil photo et sa tête baissée sur le viseur. Et voilà que cette image prend les airs d’un curieux dialogue où une femme regarde une jeune femme qui regarde une photographe qui, quant à elle, les regarde autant qu’elle se regarde au travers de son viseur et d’une vitrine. Il y a comme une mise en abyme qui se dessine au cœur de cette photographie où se fondent trois femmes en un seul corps et dont deux d’entre elles en sont conscientes. Toutes les trois coexistent alors non seulement dans un même espace temps mais surtout et en particulier sur un même plan, une même dimension, incarnées en une seule représentation.
Voir dans le viseur comme dans un miroir de soi. Ou comment une quête photographique, au-delà d’être le témoignage d’une ville et de ses habitants à une époque, serait aussi une quête personnelle. Le triangle formé par les trois femmes inspire véritablement la dynamique d’un dialogue qui se traduit par des regards, comme un fil d’Ariane, les reliant successivement de l’une à l’autre. Vivian Maier a été arrêtée par la vision de ce qui pourrait être une mère s’adressant à sa fille. Il n’est pas possible de déterminer ce qui a retenu l’attention de la photographe dans cette scène et à ce moment précis. Ce peut-être le graphisme qui se dégageait de l’ensemble, la lumière, le langage corporel des deux femmes, ou le regard de la jeune fille. La mère est un peu penchée en arrière avec les jambes croisées, et bien que l’on distingue à peine l’expression de son visage tourné vers sa fille, on a le sentiment qu’elle la réprimande, du moins c’est ce que révèle la posture de son buste qui semble indiquer un mouvement de recul. La jeune fille fait face à la photographe, ses pieds touchent à peine le sol, ses épaules sont basses et elle a les bras croisés, son visage est légèrement tourné à l’opposé de celui de sa mère, et son regard se perd loin devant elle. Ses yeux ont une expression qui pourrait relever de la tristesse, de l’accablement ou de l’inquiétude. Elle donne l’impression de regarder Vivian Maier, de la prendre à témoin ou de chercher quelque compassion, quelque chose ou quelqu’un à qui pouvoir se rattacher. On ne voit pas l’expression de Vivian Maier dont la tête est penchée sur le viseur de son appareil photo, et l’on sait qu’elle exprimait rarement ses émotions, elle ne les a jamais laissés paraître dans aucun de ses autoportraits. Pourtant ceux qui l’ont connue, les enfants dont elle s’est occupée la décrive comme une femme sachant se montrer chaleureuse, humaine, et pleine d’esprit. Les rares sentiments que l’on parvient à déceler dans ses autoportraits témoignent plutôt d’une forme de curiosité, comme le serait celle d’un anthropologue qui enquête sur ses pairs, à moins qu’elle n’enquêtât sur elle-même.
Vivian Maier a très tôt été indépendante, sans liens profonds avec sa famille, ou quiconque dans une sphère personnelle. Les seuls liens qu’elle entretenait étaient ceux qui se tissaient avec les enfants dont elle avait la charge, qu’elle élevait comme une seconde mère et qui en retour la comparait volontiers à Mary Poppins. Les seuls autre liens qui semblent avoir rythmé sa vie étant alors les brèves interactions qui pouvaient se manifester avec un inconnu et seulement le temps d’appuyer sur le déclencheur. Cette indépendance, cette solitude sociale qui la singularisait quand il s’agissait qu’elle en soit la bénéficiaire explique peut-être une grande partie de son travail. Comme si elle s’était mise entre parenthèses pour mieux se tourner vers les autres, mieux voir. Captivée par l’humanité tout autour d’elle, Vivian Maier se retrouvait alors de cadrage en cadrage, d’expression en expression lui permettant de regarder sa propre humanité et de lui donner chair sur une pellicule. Dans Self-Portrait, 1954, c’est peut-être son propre regard qu’elle a vu dans celui de la jeune fille, c’est peut-être un instant de sa vie qu’elle a reconnu dans son viseur, un moment entre elle et sa mère, et finalement, un moment que toute jeune fille vit un jour ou l’autre avec sa mère.
Vivian Maier :
Trailer du documentaire « A la recherche de Vivian Maier » :
Philip-Lorca diCorcia, Eleven W stories #3, Sept. 1997
C’est avec la musique du film « Un homme, une femme » que j’aurais voulu que mes mots s’enchaînent pour vous parler de cette image de Philip-Lorca diCorcia, issue de la série Eleven W stories, et pourtant rien ici n’augure de l’amour et de la passion mis en scène par Lelouch. Il y a bien un homme et une femme dans cette narration visuelle mais ces deux là nous racontent une toute autre histoire, qui ne semble pas annoncer un « happy end ».
Philip-Lorca diCorcia est un éminent représentant de la photographie scénique, à l’instar d’Erwin Olaf et Gregory Crewdson, autres maîtres de la mise en scène dont je vous ai parlé précédemment. Comme eux, le travail du photographe s’inscrit dans une démarche pictorialiste. Là encore nous sommes face à des compositions tirées au cordeau, où chaque élément de lecture s’inscrit très précisément dans le cadre de l’image, et même dans d’autres plans très clairement construits à l’intérieur de la photographie. Cependant il y a quelque chose de tout à fait déconcertant dans l’œuvre de Lorca diCorcia dans la façon dont il traite ses sujets. C’est que l’artiste est transversal, connu pour son travail personnel autant qu’en mode et publicité, il pratique aussi la « street photography » mais avec une approche de plasticien. Ainsi, son trépied installé dans la rue, il va saisir des instantanés de façon aléatoire où se démarqueront des visages et des silhouettes, isolés de l’ensemble par la lumière des flashs qu’il aura préalablement installé et dissimulé. Cette technique, par son utilisation du cadre fixe et des flashs, se rapproche de ce qui pourrait relever d’un travail de studio et Philip-Lorca diCorcia la transfère à la prise de vue documentaire. En résulte que ce qui aurait pu être une classique scène de photographie de rue telle qu’on la connaît, s’en éloigne, et prend des airs de fiction ou de scène de cinéma dans sa facture. A l’inverse lorsqu’il construit ses images de mode, de publicité ou pour ses travaux personnels, toujours à grand renfort de décors, de mise en lumière sophistiquée, casting, stylisme, et plus encore, là, il s’attache à reconstituer des scènes qui pourraient quant à elles relever du registre documentaire.
C’est sur cette idée d’une plastique cinématographique que viennent se rejoindre les différents aspects de l’œuvre de l’artiste, un style qui s’inspire de l’iconographie hollywoodienne pour mieux questionner ce qu’elle peut aussi représenter, tant dans le fond que de la forme. Le glamour, l’artifice, et un portrait fantasmé des modes de vie des différentes strates de la société, c’est ce que semble questionner Philip-Lorca diCorcia. Quelque soit le récit qu’il propose, mêlant intimement le documentaire dans le sujet et le théâtral dans sa représentation, ses clichés sont toujours ambivalents voir ambigus. Et au-delà de leur esthétique parfaitement maîtrisée, ils suggèrent bien plus qu’ils ne racontent. Alors même qu’il enferme notre regard de façon très précise dans le cadre de la photographie, à l’inverse, la narration proposée ne s’arrête pas aux bords de l’image. Il intègre délibérément des éléments de tension, parfois dérangeants dans ses mises en scènes, qui amènent à se questionner sur la légitimité de cette beauté avant tout formelle qu’il présente. Comme une plante carnivore dont la beauté est un leurre, ces tirages particulièrement séduisants à première vue sous-tendent une autre réalité bien moins reluisante. A la manière des dramaturges de la tragédie grecque, Philip-Lorca diCorcia dépeint la société et ses mœurs dans des tableaux cathartiques à la facture précieuse et la scénographie millimétrée, à la différence qu’il ne nous en livre pas le dénouement.
La composition d’Eleven W stories #3 révèle immédiatement ses clés de narration. Philip-Lorca diCorcia présente sa scène en un plan moyen, lui permettant d’installer le décor autant qu’une ambiance et de présenter ses personnages en pied. La perspective d’une fuyante horizontale traverse l’image de part en part et son angle inspire déjà un sentiment de tension. Elle dirige de regard de la droite de l’image où se tient la femme, vers l’homme placé à la même distance du cadre qu’elle, mais en son côté opposé, à gauche. Dès lors, la lecture de l’image tend à exprimer le passé plutôt que l’avenir, ce qu’il en reste... La scène s’inscrit dans une construction fermée de toute part à l’exception du coté gauche où se situe l’homme, pourtant sa silhouette sombre et la limite de la baie vitrée arrêtent aussi très nettement le regard. En amorce, un généreux parterre de plantes aux feuilles lancéolées, participe à la dynamique de l’ensemble, tant par ses teintes lumineuses que par le rythme des formes aigües de son feuillage. Au premier plan, la femme, se détache tant par sa position et son attitude que par la lumière, de ce qui pourrait être le soleil, auquel elle fait face. L’homme est positionné en second plan, et sa place à cet endroit en particulier amenuise sa silhouette autant que son autorité. La vue en contre-plongée suggère la puissance, la force, la supériorité et en particulier celle de la femme placée sur un plan plus rapproché que son partenaire. L’image est aussi divisée verticalement en trois panneaux délimités par les lignes séparant les surfaces vitrées. Le premier et plus grand encadre la femme, sur le fond sombre de son intérieur et d’arbres en arrière-plan. Le second est moyen et vide de vie si ce n’est celle de la végétation à l’horizon. Enfin dans le dernier et plus petit, la silhouette grise de l’homme se dessine sur un ciel d’azur délavé. Avec ce jeu de cadres dans la composition Philip-Lorca diCorcia fabrique ici une mise en scène qui n’a rien d’anodin, et qui bien au contraire est lourde de sens. Enfin La lumière et les couleurs participent elles aussi à appuyer un scénario qui se précise un peu plus avec l’articulation des contrastes et des oppositions mis en scène ici. L’une de ces oppositions se situe notamment au niveau des couleurs, associées à la femme, alors que l’homme ne bénéficie que de teintes neutres. Mais encore, les éléments les plus lumineux, les plus vibrants et colorés sont concentrés sur la végétation et plus particulièrement sur elle. Sa tenue au motif floral composé de rose, jaune et bleu, ainsi que l’éclat de sa peau et de ses cheveux blonds dans la lumière d’un soleil couchant, découpent sa silhouette très distinctement alors que derrière elle le décor est plongé dans l’obscurité. Et le contraste est inversé en ce qui concerne la figure de l’homme qui quant à lui est présenté devant un ciel clair et dans les mêmes valeurs sombres que celles du décor.
Et la luxueuse maison pris des airs de cage de verre. La scène d’Eleven W stories #3 prend place dans une maison d’architecte, perchée sur les hauteurs d’une colline que l’on imagine être située à Los Angeles et que seuls les plus fortunés peuvent s’offrir. A l’intérieur un couple, à distance l’un de l’autre, chacun portant son regard vers l’extérieur dans des directions différentes. La femme est élégante et domine l’image par sa position, son attitude, et la lueur dorée dont elle profite, cependant elle ne semble avoir de solaire que la lumière qui se pose sur elle. Ses pieds sont ancrés dans le sol dans des escarpins qui donnent un galbe fuselé à ses longues jambes. Ses mains appuyées sur sa taille, son port de tête ainsi que l’expression de son visage lui confèrent autorité et détermination. Elle regarde droit devant, vers le couchant, résolument. L’homme, plus loin dans l’angle formé par la jonction des baies vitrées, regarde dans une direction contraire. Son attitude est différente, les mains dans les poches de son costume à la veste ouverte, il paraît moins en tension, dans une attitude qui suggère un détachement. Au milieu le vide, un large espace froid les sépare, comme une distance qu’ils auraient mise entre eux pour ce qui pourrait être une divergence de point de vue telle qu’indiquée par leurs regards. Ne leur reste en commun qu’une vaste et faste demeure depuis laquelle et derrière des parois de verre, ils observent et dominent le monde à leurs pieds, mais sans plus se regarder l’un l’autre.
Le décor est installé, les personnages mis en scènes. Pour ce qui est des scénarios et dénouements possibles, Philip-Lorca diCorcia nous laisse à notre imagination. Plusieurs hypothèses sont possibles, une dispute et le froid qui s’installe après elle, la discussion sans appel et le dialogue rompu avec lequel on ne parvient pas à renouer. Un couple puissant sans autre affect que celui généré par le goût du pouvoir au point de ne plus se considérer mutuellement, de ne plus manifester de sentiments l’un envers l’autre. Et puis à les considérer l’un et l’autre dans leur toute puissance vient l’idée que « derrière chaque grand homme se cache une femme » et ce serait donc elle, dominante et lumineuse dans la photographie qui aurait le véritable pouvoir entre ses mains ? Une femme à la plastique parfaite et l’apparence soignée à l’extrême, au point que son image s’apparente à celle d’une mannequin en vitrine, tant elle semble figée, déshumanisée. Le pouvoir et la beauté ont un prix, celui des sacrifices auxquels on consent pour les conquérir. Alors peut-être, à trop vouloir s’affranchir d’une certaine condition, elle comme d’autres, aura choisi la voix de l’ascension sociale, et peu importe ce qu’il lui en aura coûté, ses émotions, son cœur, une vie entière en quête d’une nouvelle liberté, mais cette liberté là, toute matérielle peut avoir un goût amer. A désavouer son humanité, c’est l’être dans toute sa substance qui se retire et ne laisse derrière lui qu’une enveloppe inhabitée, aussi belle soit-elle. Tandis que d’autres, comme des papillons se brûlant les ailes sur une ampoule, resteront brisés d’avoir cheminé un temps aux côtés de ces êtres glorieux qui ne cherchaient pourtant au départ que la réussite pour avoir une chance d’être libres. C’est peut-être ce modèle de société et ses tristes conséquences que cette photographie nous invite à reconsidérer, comme une parabole entre l’être et l’avoir, où le juste équilibre reste encore à trouver. Quelques soient les hypothèses qui se bousculent les unes après les autres pour tenter de mettre des mots sur ce que Philip-Lorca diCorcia présente dans cette photographie, ce qui reste le plus évident et le plus imparable à évoquer, est certainement le sentiment qui s’en dégage. Et ce sentiment, s’il exprime le faste et le pouvoir d’un couple, matérialisé en bien des apparences, il exprime aussi qu’en son cœur ne demeurent plus que l’indifférence et le désamour emprisonnés dans une cage de verre.
Gregory Crewdson - Untitled, Summer (Summer Rain) from the series « Beneath the Roses », 2004
Une pluie d’été... On peut se l’imaginer de bien des façons, parfois exotique comme la mousson s’abattant sur un paysage tropical, mais se la représenter comme Gregory Crewdson nous la présente dans Untitled, « Summer Rain » relève d’un imaginaire peu commun, qui ne laisse en rien rêveur... Et c’est là l’une des caractéristiques de l’œuvre singulière de Crewdson, c’est cette forme de discordance où une scène du quotidien, qui aurait pu être une scène heureuse après tout, se transforme en paysage insolite délibérément fabriqué pour nous rappeler à nos angoisses, nos doutes et mille autres sentiments que nous avons soigneusement appris à refouler au fil du temps.
Gregory Crewdson est un photographe autant qu’un metteur en scène, il n’y a rien de réel dans ses images, il ne construit que des réalités fictives, et pour cela il n’hésite aucunement à s’entourer d’une équipe digne d’une production cinématographique, allant des décorateurs, aux costumières en passant par les techniciens lumière, les maquilleurs, les accessoiristes etc. La plupart des scènes d’intérieur de son œuvre sont des décors entièrement construits d’après ses story-boards. Pour les extérieurs, il parcourt des régions entières des États-Unis, parfois avec ses équipes de repérage, pour trouver le lieu idéal, celui qui sera au plus proche de ce qu’il a préalablement conçut dans son esprit. Enfin que ce soit en intérieur comme en extérieur, il n’y a pas de lumière naturelle dans ses photographies. Il ré-éclaire chaque scène et chaque détail selon sa vision. C’est un travail d’une précision absolue où le hasard n’a pas lieu d’être. C’est que Gregory Crewdson sait exactement ce qu’il veut raconter et comment.
Avec Untitled, Summer (Summer Rain), le photographe nous plonge dans le noir, au milieu de la nuit, dans une ville désertée à ce moment particulier, et pour parfaire le tout, l’artiste décide de verser des trombes d’eau sur cette scène dont l’atmosphère semble déjà pour le moins morose. Au milieu de la rue, un homme grave en costume se tient debout de profil, il est détrempé et il regarde sa main gauche dont la paume est tournée vers le ciel, comme s’il prenait conscience de la pluie ou comme s’il cherchait à s’assurer qu’il pleut vraiment et qu’il ne rêve pas. Derrière lui sa voiture est mal garée et la portière ouverte, il a abandonné son attaché-case juste à côté sur le bitume où l’eau ruisselle.
C’est une image fabriquée sur mesure où composition, lumière et couleurs, travaillent ensemble à faire sens et ont leurs places définies bien avant la prise de vue. Cette scène d’une pluie d’été sur une ville la nuit est définie selon la désormais classique composition par tiers. Les deux tiers de l’image à droite installent le décor en une évocation qui me semble manifeste... Celle d’une artère commerçante dans une petite ville ordinaire des États-Unis, où les lumières des vitrines ne s’éteignent jamais et illuminent continuellement la rue de leurs lueurs dorées, alors même que les portes de ces boutiques resteront closes jusqu’au lendemain... Cette succession de vitrines aux couleurs ambrées se détache par contraste de toutes les nuances de bleu profond que seul le ciel, à la nuit tombée, peut offrir. Elle nous dirige aussi par la ligne en perspective sur laquelle elle s’inscrit, vers le point d’orgue de la scène, un homme sous la pluie. Sur le tiers gauche de l’image, la chaussée inondée brille de l’éclat des réverbères qui s’y reflète, puis se perd en arrière plan dans la masse sombre de quelques arbres que l’on discerne à peine et qui semble indiquer la fin de la route ou le début d‘un voyage incertain. Au premier plan, les lignes blanches d’un passage piéton traversent l’image tout en la fermant, et forcent le regard à se concentrer sur le cœur de la scène. De la même façon, les feuillages des arbres, de part et d’autre de la rue, ferment aussi l’image dans ses angles supérieurs, tandis que le foisonnement des lignes électriques dans le ciel dessine un filet qui arrête le regard au centre de l’image, autant qu’il semble retenir les rêves ou les espoirs de l’homme. C’est à la croisée de ces plans, que la silhouette sombre de l’homme se détache, tournant le dos à sa voiture, à son porte-document, aux devantures illuminées.
Ce que représente Gregory Crewdson est toujours chargé de sens. Comme je l’ai mentionné plus haut, ses photographies sont des réalités fictives ce qui à priori est une contradiction, il y a la réalité et il y a la fiction, ce sont deux choses distinctes. Pourtant, chez lui elles vont toujours de pair, se nourrissant l’une et l’autre. Il faut savoir que le père du photographe était psychanalyste, ceci expliquerait peut-être que l’un des cheval de bataille de Gregory Crewdson soit avant tout le psychisme, des américains en l’occurrence, et leurs désillusions sur la société de rêve qui leur était promise... Mais ces américains qu’il met en scène sont-ils seulement les victimes de ce désenchantement ou y participent-ils, en sont-ils conscients ?
Et il y a cet homme au milieu de la rue, déconcerté par ce déversement d’eau, qui comme un déluge funeste, l’empêche de rentrer chez lui après une longue journée à travailler dans des bureaux impersonnels. Ou qui l’empêche de poursuivre sa route vers sa prochaine destination, une autre ville, un autre rendez-vous, pour vendre peut-être des contrats d’assurance bien rangés dans sa mallette ? Dépité, il abandonne sa voiture, sa mallette, et au milieu de la rue il essaye d’estimer les conséquences de cette pluie diluvienne sur le programme qu’il s’était imposé, il tente de prendre la mesure de la situation. Mais le seul constat qu’il puisse vraiment établir, c’est qu’en cet instant il n’a plus le contrôle de sa vie tel qu’il l’a toujours entendu et c’est alors qu’il est confronté à sa vulnérabilité et qu’il doit faire face à ses illusions.
Mais si l’espoir demeurait, s’il était possible de s’affranchir des illusions d’un monde dont les promesses se révélaient comme n’étant que vacuité, où une vie normalisée à poursuivre un quelconque veau d’or ne pouvait plus faire sens ? De quelle façon alors une telle prise de conscience pourrait-elle se produire ? Et c’est peut-être cet instant précis que nous présente Gregory Crewdson, ce moment où un homme n’a pas d’autre choix que celui d’interrompre sa course, arrêté brusquement par une pluie aussi dense que soudaine. C’est peut-être à ce moment que le temps s’est aussi arrêté pour notre homme. Ce moment où la pluie l’immobilise dans son voyage et l’amène à la considérer, sentir à son contact qu’il y a d’autres perspectives à envisager, autres que celles du fait social. Alors c’est peut-être par une pluie d’été, au milieu de la nuit, qu’un homme aura appris à tourner le dos aux lumières de la ville, à sa voiture, à son attaché-case, symboles de ses rêves normalisés, pour simplement pouvoir revenir à lui-même, recentré sur sa nature première, sur l’essentiel…
Gregory Crewdson : https://gagosian.com/artists/gregory-crewdson/
Gregory Crewdson film : « Brief Encounters »: http://www.gregorycrewdsonmovie.com
Erwin Olaf : Grief, Barbara - 2007
Il était une fois, la fin... Ce sont les premiers mots qui me viennent à l’esprit devant « Barbara », cette photographie extraite de la série « Grief », (deuil en français) réalisée en 2007 par Erwin Olaf. A l‘exception de Troy, seul personnage masculin de la série, chacune des images de « Grief », a pour titre un prénom féminin. Comme au cinéma ce prénom n’est bien entendu pas celui d’une actrice, mais celui du personnage qu’elle incarne. C’est ainsi que dans la mise en scène d’Erwin Olaf, une mannequin devient Barbara, une femme, seule, dans une chambre qui pourrait être celle d’un hôtel de luxe, ou d’une riche résidence de fonction.
Erwin Olaf est un photographe de la mise en scène, son travail est celui d’un narrateur qui questionne la nature humaine autant que la société, il s’attache à déchiffrer les émotions tout en les contextualisant dans des décors façonnés comme des manifestes. Et c’est bien à cela que l’on identifie immédiatement ses photographies, que ce soit dans le soin apporté au cadre autant qu’à la mise en scène, tout y est particulièrement étudié, soigné et réalisé avec une précision d’orfèvre. Ses décors, comme ses images, sembleront aseptisés ou froids aux yeux de certains, tandis que d’autres les verront feutrés, quoi qu’il en soit il y a toujours une forme d’élégance dans ses constructions. C’est que ce photographe là maîtrise parfaitement l’art subtil de la nuance. Il y a rarement plus de deux couleurs dans les photographies d’Erwin Olaf, et le plus souvent ses décors sont constitués de l’association raffinée de teintes sourdes et douces qui seront ponctuellement relevées d’une couleur plus franche et généralement issue de la même gamme chromatique.
Et puis il y a la lumière d’Erwin Olaf, comme une signature, une lumière qu’il met en scène pour orchestrer dans les moindres détails ses images et son propos. Cette lumière s’apparente aux éclairages de cinéma, façonnés pour imiter l’atmosphère d’un lieu précis à un instant particulier et nous faire croire en la réalité de ce qui nous est présenté. Elle a aussi quelque chose des lumières d’ateliers d’artistes dont les grandes verrières étaient orientées vers le nord, présentant le double avantage d’avoir une luminosité constante tout en limitant l’entrée du soleil et ses ombres dures. Avec Erwin Olaf nous sommes en présence de lumières réfléchies, conçues comme si elles venaient d’une fenêtre le jour, ou de néons et autres luminaires lorsque la scène se situe la nuit et dans des lieux clos. C’est une lumière douce, aux ombres discrètes et diffuses, une lumière qui modèle et enveloppe, qui caresse ce qu’elle éclaire, une lumière qui évoque l’intime. Elle en deviendrait presque un personnage incontournable de chacune des images du photographe tant elle semble avoir son propre caractère, profondément révélateur et souvent délicat même sur des sujets sensibles, presque comme si elle personnifiait Erwin Olaf lui-même au coeur de ses mises en scènes.
C’est dans cette lumière que se révèle Barbara, entre deux fenêtres... On la découvre dans une vue presque frontale mais pas tout à fait. Une légère perspective horizontale dont le point de fuite à droite ouvre l’espace en son côté opposé et emmène le regard à gauche, vers Barbara, assise, donnant le dos à une coiffeuse et son miroir à trois panneaux. Le claustra aux lignes géométriques à droite de l’image suggère l’idée d’une limite, comme si nous étions au seuil d’une porte entrouverte dont nous ne devrions pas franchir plus encore le pas. La photographie repose sur une composition par tiers, les deux fenêtres et le mur devant lequel se trouve la coiffeuse, tiers auquel plusieurs éléments du décor allant aussi par trois font écho. Les trois montants du claustra, les trois panneaux du miroir, les trois vases... Dans tout le travail d’Erwin Olaf, le décor sert l’image, et c’est ainsi que chaque élément a été placé exactement là où il doit être, autant qu’il a été précisément choisi pour son style, ses teintes et ses matières. De fait c’est ici l’idée d’un lieu et d’un moment que nous montre Erwin Olaf, reprenant les codes d’un groupe social en un instant singulier de son histoire, à l’origine de son inspiration dans la création de « Grief ». Pour autant il veille à ne pas laisser de place à une quelconque personnalisation du lieu, lui ôtant les signes distinctifs d’un habitat privé, autant qu’il y gomme tout élément qui permettrait de dater précisément la scène, il ne reste que le luxueux des meubles design qui laissent penser que nous nous situons vers le milieu du XXème siècle.
Barbara, Caroline, Margaret, Victoria, Grace, sont les noms de chacune des photographies de la série et des femmes qui y sont représentées. Erwin Olaf a choisi ces prénoms exactement car ce sont des prénoms de femmes issues de la grande bourgeoisie américaine des années 60. En effet, c’est suite à la lecture d’un livre de photographies sur les Kennedy, des femmes influentes de leur entourage et plus particulièrement sur ce qu’a traversé Jackie suite à l’assassinat de John, qu’Erwin Olaf a conçu les images de la série. « Grief » est un questionnement sur le deuil et tous les sentiments qui viennent avec lui, et ces photographies interrogent l’idée d’une forme de beauté qui pourrait en émaner... Toute surprenante qu’elle puisse paraître la question d’un esthétisme du deuil est pertinente, car après tout ne dit-on pas que c’est dans l’adversité ou la douleur que peuvent se révéler la grandeur et la dignité, la mesure et la pudeur de l’âme, prenant alors les traits d’une élégance de l’esprit, d’une élégance sociale...
Barbara à sa façon, incarne tout cela. Elle est face à nos regards alors que le sien est baissé, comme perdu dans le geste suspendu d’enfiler un bas. Elle est figée dans sa féminité, dans son rituel, ce moment intime où elle doit se préparer, se mettre en beauté, et revêtir l’habit de la même façon qu’on revêt l’étiquette et que l’on met en scène l’image à donner de soi. Le temps s’est arrêté et elle est arrêtée dans son mouvement, comme figée par une pensée qui aurait pris possession de son esprit, une émotion plus forte que l’habitude, la volonté et la bienséance réunies. Ses épaules fléchissent, son corps plie, donnant à voir sa nuque, vulnérable, dans le miroir auquel elle ne fait plus face. De toute façon elle est déjà coiffée et maquillée, le miroir ne lui est donc plus d’aucune utilité en cet instant. L’usage aurait voulu qu’elle ait les genoux joints, mais après tout, elle est encore dans une chambre au moment de s’habiller, d’enfiler le bas qui ne couvre pas encore une de ses jambes. Et puis il y a son autre jambe qui elle est couverte et c’est, selon les convenances, ce qui est attendu, mais sa cheville se tord, son pied est en dedans, ses orteils crispés, brisant la grâce et l’harmonie de ses membres autant que le maintien exigé par le protocole. Pourtant c’est à la vue de cet infime détail que sa douleur et son désarroi se dévoilent, tout aussi timidement que dans son dos qui se courbe, son visage incliné, et son regard dont on se dit que s’il n’est pas perdu il est alors resté tourné vers l’intérieur...
Et il n’est rien dans cette image qui ne respire la beauté. Que ce soit celle de cette chambre aux teintes fondantes allant du moka au lin en passant par le tilleul et qui viennent adoucir l’atmosphère grave de la scène. Ou encore la finesse des voilages légers devant les fenêtres, laissant filtrer la lumière tout en préservant l’intimité d’une femme en deuil. Et puis celle, précieuse, des vêtements de soie aux doux reflets de beige doré et de rose poudré, posés comme un dernier réconfort sur les épaules fragiles de la veuve. Enfin il y a la beauté de Barbara avec sa chevelure attachée en un élégant chignon, ses yeux soulignés de noir, sa bouche peinte, et ses mains gracieuses jusqu’au bout des ongles. C’est dans cet instant qui est un entre-deux, celui où elle s’abandonne à la pleine conscience de ce qu’elle traverse, que Barbara incarne dans sa retenue un peu plus que la beauté, elle incarne l’élégance, qui elle demeure quand la beauté et le chagrin ne sont finalement que passagers.
Erwin Olaf : https://www.erwinolaf.com/art
Erwin Olaf : « Grief » https://www.erwinolaf.com/art/Grief_2007
Gilbert Garcin : L’interdiction, 2000
Une image vaut mille mots, la très belle analyse d’image de Valérie Servant, qui nous parle aujourd’hui d’une image de Gilbert Garcin, l’interdiction.
Quand Gilbert Garcin met en image “L’interdiction” en 2000, il est déjà au-delà d’un bon nombre d’a priori sur l’idée que l’on peut se faire d’un artiste et de son parcours. Il n’est en rien un homme interdit, bien au contraire sa vision est claire et sa photographie tout autant. Car voilà, le fabuleux Mr G. jeune premier de la photographie qui a débuté en 1992, a exposé pour la première fois en 1993, et connu le succès à peine 5 ans plus tard en 1998, n’est plus si jeune lorsqu’il s’entiche de la photographie, l’homme est alors âgé d’un peu plus de 60 ans. Né en 1929, Gilbert Garcin passe son enfance entre l’école et l’Eden-Cinéma, celui-là même des frères Lumières, géré par son grand-père. Après ses études dans une école de commerce puis dans une université américaine il consacre la majeure partie de sa vie à son entreprise de luminaires, jusqu’à sa retraite où, redoutant l’ennui qui menace d’envahir le vide laissé par la fin de son activité professionnelle, il décide de s’inscrire au club photo d’Allauch. Ne s’interdisant rien, Gilbert Garcin participe à un concours photo amateur qu’il remporte et gagne un stage aux Rencontres de la photographie d’Arles avec Pascal Dolémieux qui va l’initier au photomontage en noir et blanc. C’est le début d’une nouvelle aventure, l’écriture d’un destin hors du commun, celle d’un homme qui sous les traits “d’un monsieur comme tout le monde” allait “l’air de rien” devenir une référence majeure dans la photographie contemporaine.
C’est donc avec l’enthousiasme et l’humilité de l’amateur autant qu’avec l’efficacité de l’entrepreneur qu’il a été, que Gilbert Garcin se lance corps et âme dans la photographie. Un petit cabanon au fond de son jardin sera désormais son studio de prises de vues et une simple table deviendra la scène où construire les représentations du théâtre de son imaginaire et de ses réflexions sur l’existence. Armé de son Nikon argentique acheté d’occasion, Gilbert Garcin devient Mr G. et photographie un personnage à son effigie qu’il va faire évoluer au cœur d’univers sortis tout droit de son esprit malicieux. Sur la table, un peu de sable, des cailloux, et autres bouts de ficelles, lui suffiront à construire son décor. Il réalise aussi des photos de ciel qu’il développe en diapositive pour les projeter dans sa mise en scène, n’hésitant pas à dérégler le projecteur pour flouter un peu l’image et créer l’illusion d’un paysage à l’horizon nuageuse. Quant au personnage de “monsieur tout le monde” qu’il s’est fabriqué et qu’il met en scène dans ses images, il n’est autre qu’une photo de lui-même prise avec le retardateur de son appareil. Développée sur papier, puis découpée et collée sur un bout de carton ou du fil de fer pour pouvoir tenir debout au milieu des paysages imaginés par le photographe, la figurine devient tantôt acteur, tantôt témoin, sujet ou objet de la photographie, invitant chacun de nous à flâner avec elle dans ces images qui font sourire autant qu’elles interrogent. Il en fera de même avec son épouse qui partagera avec lui ses aventures photographiques. A regarder les péripéties de ce petit homme au pardessus gris on ne peut s’empêcher de penser à cet autre personnage aux aventures rocambolesques qu’était Monsieur Hulot créé, incarné et mis en scène par Jacques Tati au cinéma. Là aussi, les décors se voulaient autant minimalistes qu’efficaces tandis que des scénarios drolatiques révélaient l’absurde et parfois la vacuité de nos existences pour mieux nous amener à reconsidérer l’essentiel. Gilbert Garcin dira lui-même que le personnage de Mr Hulot l’a inspiré : « Je voulais un "monsieur-tout-le-monde" auquel on puisse facilement s’identifier ».
Chez Gilbert Garcin le sourire est une clé vers les portes de la réflexion. C’est que l’homme joue avec les représentations graphiques autant qu’avec les idées. Il nous emmène dans un monde lunaire et minimaliste, qui ressemble juste ce qu’il faut au vrai monde, assez pour que nous nous projetions dans son univers mais pas trop afin de concentrer le regard et créer le questionnement. Gilbert Garcin jongle entre dénotation et connotation, où ce qui fait l’objet de la dénotation dans ses images est toujours réduit à l’essentiel jusque dans son choix du noir et blanc, afin de faire la part belle à la connotation, soit la réflexion et l’interprétation. Il y a toujours de l’ambivalence dans les photographies de Gilbert Garcin, des sentiments contradictoires qui permettent de faire sens, qui mènent à l’évidence. Ses mises en scènes photographiées présentent des situations relevant souvent de l’absurde ou du surréalisme, et c’est en cela que leur caractère à la fois amusant et poétique se manifeste. Dès lors Mr G. attrape notre attention, il nous fait sourire pour nous faire réfléchir, et nous emmène immanquablement à comprendre son propos, souvent résumé dans les quelques mots avec lesquels il aura intitulé son œuvre.
Des images d’une comédie humaine teintée d’existentialisme, voilà ce que nous délivre le facétieux Gilbert Garcin. Car à bien y regarder chacune de ses photographies illustre Mr G. face à un choix ou un constat, qu’il réalise autant qu’il interroge, et ce faisant, nous met avec lui face à nos propres choix. Qu’elles soient allégories, aphorismes ou métaphores, toutes ses images nous parlent de nos préoccupations, et de questionnements universels sur la vie, l’amour, le temps, la mort…
Et c’est bien de choix qu’il s’agit dans « L’interdiction » lorsqu’en 2000 Gilbert Garcin réalise cette photographie. Comme à son habitude, le photographe nous propose une image simple où il va à l’essentiel. La vue est frontale, symétrique et au centre se dessine Mr G. en personnage de dos une petite valise à la main, faisant face à l’horizon. Devant lui une corde, suspendue entre deux piquets, fait barrière, tandis que de part et d’autre sont alignées à distances égales quelques pierres. De belles nuances de gris divisent l’image en deux parties, par le milieu et horizontalement, avec pour la moitié inférieure les gris moyens d’un sol sableux et pour la moitié supérieure les gris clairs d’un ciel traversé de nuages. Au cœur de ce décor minimaliste et en noir, la silhouette sombre de Mr G., la barrière et les pierres, forment les éléments graphiques de l’image qui vont créer le contraste et fixer le regard au centre de l’image. On pourrait se croire enfermés dans cette image, interdits comme Mr G. devant cette barrière s’il n’y avait ces pierres. Or il en va autrement, avec elles et la ligne pointillée qu’elles forment depuis le centre vers les bords, nous pouvons entrevoir et envisager d’autres alternatives, une échappée. Elles nous guident vers le cœur de l’image autant qu’elles nous en laissent sortir à gauche et à droite, elles nous montrent un chemin salvateur à la manière de Perrault et son Petit Poucet. Mieux, elles ouvrent la question sur l’interdiction de Mr G., et sur nos interdictions.
Pourquoi resterions-nous en arrêt devant cette barrière quand il est aisé de l’enjamber, plus encore de la contourner et traverser la ligne tracée en pointillé par les pierres en passant simplement entre deux d’entre elles ? On peut imaginer qu’une des réponses se trouve alors symboliquement dans la petite valise du personnage. Car il n’y a pas de hasard dans les mises en scènes de Gilbert Garcin et encore moins d’éléments superfétatoires, chaque chose étant toujours à sa place et toujours porteuse de sens, alors cette petite valise véhicule forcément un message et a été délibérément placée là, comme une clé de lecture. C’est qu’une valise est un contenant, ainsi et forcément on se demande alors ce que l’homme transporte avec elle, là, au milieu de ce qui ressemble à un désert. Une interprétation possible serait de se dire que c’est toute son histoire, sa vie qu’il emporte, et avec elle, son esprit, ses constructions psychologiques, les rêves qu’il avait et les limites qu’il s’est donné, ses envies et ses déceptions, ses espoirs et ses peurs… Et que c’est peut-être tout cela qui le freine, l’arrête devant une simple barrière. On pourrait aussi se dire que la barrière serait alors la projection du contenu de sa valise, une barrière qu’il se serait donc fabriqué au fil de son existence. Mais cela suffit-il à justifier l’interdiction ? L’homme à l’arrêt, interdit, ne fait pas seulement face à une barrière, il est au milieu d’un espace nu qui pourrait être le présent en train de s’écrire et le futur encore à écrire, porteur de craintes autant que d’espérances. Là, dans l’expectative, il doit choisir. Ainsi, au milieu de cet espace et selon la valise qu’il emmènera avec lui, il s’interdira de pénétrer dans ce qu’il appréhende comme étant un désert aride, ou, il se libèrera, verra les passages entre les pierres et se décidera à aller de l’avant vers ce qui peut aussi être le champ de tous les possibles.
Gilbert Garcin : http://www.gilbert-garcin.com
Gilbert Garcin Vidéos :
Tout peut arriver - essentiel : https://vimeo.com/69603341
Tout peut arriver - complet - jusqu’au 21/01/2021 Arte : https://www.arte.tv/fr/videos/097378-000-A/tout-peut-arriver/
Le cabanon de Mr G. : https://www.youtube.com/watch?v=jVe-LXfRB-4
Stephan Vanfleteren : Fishermen, 2003, Ostende - Belgique
Fishermen de Stephan Vanfleteren, série de portraits réalisée en 2003, est certainement le plus bel hommage aux hommes de la mer qu’il m’ait été donné de voir. Plus encore, et c’est ce qui me bouleversera toujours dans le travail de Vanfleteren, c’est son inclination à aller photographier les êtres au plus proche de leur chair comme pour, et par elle, révéler leur histoire et leur âme. Stephan Vanfleteren est le photographe dont les portraits m’impressionnent immanquablement, et ce quelles que soient les personnes photographiées ou autant de fois que je les regarde, j’y ressens toujours une profonde émotion autant que je me sens happée par les visages de ces hommes et de ces femmes, leurs expressions, leurs regards.
C’est peut-être et en partie le noir & blanc tel qu’il est traité par le photographe qui créé cette intensité dans les portraits qu’il réalise. A ce sujet, son choix de film n’est pas anodin. Il travaille régulièrement avec une pellicule Kodak T-Max 400 connue tant pour la profondeur de ses contrastes et de ses noirs profonds, que pour la richesse de sa gamme de gris. C‘est aussi la finesse de son grain, restituant avec une admirable netteté les moindres détails de l’image, qui fait de ce film un medium particulièrement apprécié des photographes qui œuvrent encore en argentique. Enfin il faut saluer la maîtrise du moyen format et de l’illustre Rolleiflex SL66 par Stephan Vanfleteren, avec lesquels il donne à ses portraits une dimension qui ne peut laisser indifférent.
Il y a quelque chose de radical dans ce portrait de pêcheur comme dans la majorité des portraits de Vanfleteren. Et ce n’est pas uniquement le fait du noir & blanc si particulier au photographe qui par ailleurs participe à la signature de l’artiste. Car une fois que l’on a vu ses noir & blanc, on les reconnait ensuite entre mille. La profondeur de champ propre au travail de Stephan Vanfleteren est aussi une dominante de sa photographie. On la reconnait dans le modelé qu’il donne à ses images par la différence de traitement des plans. Ainsi ceux qui se trouvent en avant comme le nez, et en arrière telles les mâchoires et les oreilles, partiront dans les flous, tandis que le plan médian au niveau de la peau et des yeux sera toujours d’une incroyable netteté, d’un piqué soulignant chaque relief du visage jusque dans ses plus infimes détails. En révélant ce visage de pêcheur avec une telle proximité et une telle précision, la photographie se fait incarnation, de l’homme, de son être et son histoire pleinement inscrite dans sa peau. On sent alors l’iode, les brises et les tempêtes, les marées et les roulis, la puissance des éléments qui ont tour à tour caressé ou frappé ce visage le temps d’une vie passée sur la mer du Nord, à en récolter ses fruits. On devine des jours éprouvants et le labeur du pêcheur, peut-être le tabac et l’alcool qui réchauffent aussi, mais surtout on lit toute la dignité de l’homme qui nous fait face. Et puis ce cadrage définitivement frontal, serré, sans concession, sans artifice, ne laisse de place qu’au visage qui se grave ici, comme profondément encré dans le papier. Stephan Vanfleteren va à l’essentiel dans la composition de son portrait, et place les yeux quasiment au centre de l’image, comme une ligne d’horizon, nous faisant inévitablement plonger dans ce regard, intense, qui semble dirigé vers nous. On se retrouve ainsi pris dans un face à face auquel il est difficile d’échapper. Un face à face tel que l’a voulu et vécu le photographe avant nous, au moment de la prise de vue, car les deux qui se regardent ici, sont au commencement, le photographe et son modèle.
Le regard, c’est bien là que réside l’essence de la photographie dans l’œuvre de Stephan Vanfleteren. Quel prodigieux tour de passe-passe que celui qu’opère le photographe à nous laisser croire que nous sommes l’objet du regard de ce pêcheur comme de la majorité des hommes et des femmes qu’il a photographiés. Car pour que nous ayons le sentiment d’être regardés par les personnages de ses photographies, tel ce pêcheur, c’est avant toute chose le photographe qui en leur portant son propre regard les invite à le fixer lui, face caméra. Et le regard de Stephan Vanfleteren est celui d’un homme honnête face à d’honnêtes gens. Honnête car franc, pur, et teinté d’une sensibilité exceptionnelle tant il sait trouver la singularité dans le quotidien. Il prend la mesure de la vie, de l’usure qu’elle exerce sur les êtres, il décèle la solitude qui n’est jamais bien loin autant que la chaleur humaine qui lui tient à cœur, et il nous en délivre des portraits graves dans lesquels pourtant se dévoile une ineffable tendresse.
Ce que photographie Stephan Vanfleteren c’est l’existence, et souvent celle de ceux qu’on ne regarde pas. Même s’il est vrai que le photographe à souvent produit de superbes clichés d’artistes, écrivains, musiciens, comédiens, il revient toujours aux anonymes, à « ces gens-là », mais pas à la façon de son compatriote Jacques Brel. Il dit d’ailleurs à ce sujet : « Dans son œuvre, Brel dénonçait la bourgeoisie. Je regarde le monde sans condamner personne et, avec mes photos, j’essaie tout simplement de préserver un certain nombre de choses. […] Je veux montrer les gens invisibles dont on ne parle jamais ». Stephan Vanfleteren a grandi sur la côte belge, de son enfance, il a gardé son amour et sa fascination pour la vie des pêcheurs. Pourtant on ne voit pas toujours ces hommes, ou on ne leur accorde pas tant d’attention et, la flotte de pêche belge diminue dramatiquement d’année en année. En 1950 le pays comptait 457 bateaux, puis 208 en 1980 et en 2014 il ne restait plus que 80 navires à partir en mer. Lorsqu’en 2003 Stephan Vanfleteren photographie les pêcheurs d’Ostende, il tente peut-être à sa façon de préserver ce qu’il reste du métier et de l’existence de ces hommes, du moins il témoigne d’eux, un peu comme s’ils étaient les derniers héros de la mer. Avec ce portrait en grand format d’un pêcheur qui regarde droit devant, Stephan Vanfleteren fait de son art un acte romantique, en nous confrontant à l’homme, en nous emmenant dans sa réalité, comme on jetterait une bouteille à la mer. On dit de Vanfleteren qu’il photographie les hommes et la fuite du temps, il répond : « Je suis plus qu'un passager du passé. Les gens me demandent parfois si je regarde trop en arrière. Bien sûr, je regarde en arrière, mais je regarde aussi en avant, à gauche, à droite, de haut en bas. Loin et proche. Et pour la première fois, je regarde aussi vraiment à l’intérieur. »
Fishermen par Stephan Vanfleteren : https://www.stephanvanfleteren.com/fishermen
Stephan Vanfleteren : https://www.stephanvanfleteren.com
Michael Wesely: The Museum of Modern Art‚ New York (7.8.2001 - 7.6.2004)
Michael Wesely avec cette image : The Museum of Modern Art‚ New York (7.8.2001 - 7.6.2004) nous met face à une représentation photographique hors du commun. L’artiste réalise des images témoignant d’une autre temporalité que celle que nous avons pour habitude d’appréhender, des images où le temps, plus qu’ailleurs, se fait le façonneur du sujet. On peut s’en rendre compte ne serait-ce qu’en lisant le titre de sa photographie : The Museum of Modern Art‚ New York (7.8.2001 - 7.6.2004)… Vous avez bien lu, la date de cette prise de vue est : 7 Août 2001 - 7 Juin 2004, soit une photo pour laquelle l’objectif est resté ouvert en continu durant pratiquement 3 ans. C’est là et en une seule photographie, que sont inscrites 3 années de la vie d’une rue, de la construction d’un bâtiment : le Musée d’Art Moderne de New-York. Au-delà d’une brillante idée dans ce qu’elle implique de réflexion sur le temps et j’y reviendrai, c’est aussi je crois une véritable prouesse technique, à contre-courant de la course aux innovations technologiques que nous proposent en continu le marché de la photographie.
Michael Wesely a réalisé plusieurs images du MOMA en construction, sous des angles différents, et elles ont toutes en commun le fait d’avoir été réalisées sur un très long temps de captation allant d’une à quatre années consécutives. Elles font partie d’un projet plus vaste baptisé “open shutter” ou obturateur ouvert, qui réunit toutes les photos de l’artiste prises selon ce même procédé où le temps d’exposition dépasse largement tout ce que l’on pratique habituellement en photographie. Cette technique de prise de vue unique est propre à Michael Wesely, qui à force de recherches et d’essais, est parvenu à mettre au point sa méthode, et plus encore à adapter son matériel, appareil et objectif, de manière à les rendre efficients sur de telles durées de pose. Pour rappel, et de manière générale, la fourchette large des temps d’exposition pratiqués en photographie peut s’étendre du 10ème au 1000ème de seconde selon les sujets, et plus encore pour des photographies en conditions particulières. C’est à dire que le volet de l’appareil photo s’ouvre pour faire entrer la lumière sur un moment communément inférieur à une seconde. Michael Wesely quant à lui, fait entrer la lumière dans son appareil photo pendant un, deux, trois, voire quatre ans. Et c’est là que se pose alors la problématique de l’ouverture de l’objectif. Car plus le temps d’exposition est long et plus l’ouverture de l’objectif est grande, plus élevé est le risque d’avoir une photo surexposée, et dans son cas, tout simplement blanche !
On ignore encore aujourd’hui avec quelles ouvertures Michael Wesely parvient à prendre ses photos au “long-cours”. Il n’a rien révélé de cela, on sait juste qu’il a réalisé certains de ses clichés selon la technique du “pinhole”, traduire “trou d’aiguille”, qui permet de créer parmi les plus petites ouvertures d’objectif, on parle de tailles de l’ordre de centaines de micromètres… On sait aussi qu’il travaille à la “camera obscura”, la chambre noire, qui n’est autre que le premier instrument d’optique ayant permis la reproduction de la lumière, d’une image sur une plaque, soit le premier appareil photo qui ait existé. L’artiste dit lui-même qu’il ne sait jamais réellement quelle image naitra de ces prises de vues dont les temps d’expositions défient presque l’entendement. Il dit : « J’ai échoué, encore et encore, jusqu’à ce que je réussisse à faire ce que je voulais. […] Il n’y a aucun moyen de calculer le temps et la taille du shutter (obturateur) sur des expositions aussi longues ». On sait en revanche qu’il arrive qu’il positionne plusieurs appareils au même endroit pour s’assurer d’avoir un résultat et qu’il a aussi équipé ses “camera obscura” de combinaisons de filtres protégeant l’ensemble des éléments et intempéries. A l’heure où la technologie en matière de photographie est en perpétuelle évolution, Michael Wesely a pris le parti d’en prendre la direction opposée. Il a fait le choix de revenir techniquement aux fondamentaux, aux origines de la photographie, en œuvrant selon les principes premiers de la captation d’image. Il travaille avec ce qu’il y a de plus simple et de plus mécanique, une chambre noire dont l’objectif serait un “pinhole” d’une taille infinitésimale, pour ne laisser entrer que la plus faible quantité de lumière possible sur des temps d’exposition qui se comptent en années. Et ce choix que l’on pense avant tout comme étant technique est en réalité un véritable choix artistique.
Ce que l’on voit sur cette image, c’est l’empreinte vivante de trois années de construction du MOMA à New York. Vivante et vibrante car du 7 Août 2001 au 7 Juin 2004, tout ce qu’il s’est passé et tout ce qui est passé devant l’objectif de la chambre noire de Michael Wesely est enregistré, inscrit, représenté dans l’image de façon plus ou moins perceptible. C’est, à mes yeux, une splendide représentation de l’architecture émergente d’un édifice où se dessinent aussi les multiples visages de l’urbain… Pour représenter l’ensemble Michael Wesley a positionné sa chambre noire en hauteur, de l’autre côté de la rue et du musée à venir. Ce cadrage, et cette construction d’image selon une perspective cavalière, réunit à la fois le site d’édification du MOMA, les immeubles voisins dressés vers le ciel, ainsi que la rue traversant la photo à ses pieds et qui s’en va vers l’infini, le point de fuite de l’image. C’est une vue dont l’orientation est dirigée selon une perspective horizontale présentant un angle d’environ 45 degrés. On distingue aisément les fuyantes de cette composition qui convergent toutes vers le côté droit de l’image, presque à mi-hauteur, et qui lui confèrent une dynamique manifeste. Le choix du noir et blanc par Michael Wesely pour cette photographie permet de mieux discerner les traits essentiels de ce qu’il veut montrer. Nous sommes face à une multitude de nuances de gris qui sont à la fois le produit de l’incidence de la lumière sur les différents éléments tangibles de la photographie, plus encore, ils sont aussi la trace laissée par le vivant dans la rue, qui selon son temps de passage laissera une empreinte plus ou moins marquée. L’immobile et l’inanimé s’inscrivent de façon nette et distincte tandis que l’impermanent, parfois en surimpression, dessinera de délicats sillages aux formes nébuleuses. Le graphisme des édifices présents du début à la fin de la prise de vue est particulièrement lisible, alors que tout ce qui est mouvement et passager créé le questionnement tant il est moins aisé de déchiffrer ce qui se dessine dans les voiles lumineux de l’image. On devine alors l’élévation des murs du MOMA aux plans plus clairs qui se juxtaposent sur les immeubles devant lesquels il est en cours de construction. Ailleurs dans l’image, le plan lumineux traversé de lignes parallèles plus foncées qui prend place entre deux gratte-ciel, n’est autre que la manifestation de la course du soleil au fil des ans. Plus évident, en bas à droite dans la rue, l’évanescente trainée lumineuse qui court vers le point de fuite du cadre, est la marque laissée par les phares des voitures qui s’y sont succédées nuit après nuit. Cette photographie de Michael Wesely, c’est le temps qui s’incarne de ses multiples visages, et parvient à nous montrer tant ses jours que ses nuits, en un seul lieu de rendez-vous : The Museum of Modern Art‚ New York (7.8.2001 - 7.6.2004).
C’est une incontestable démarche artistique, et je crois philosophique, que de choisir de créer des images réalisées selon des temps d’expositions si longs. Car au-delà d’une vue de New York et de son désormais emblématique musée ce que nous donne à voir Michael Wesely c’est le temps. Et pourtant, s’il est une chose que nous ne pouvons appréhender de façon sensitive c’est bien le temps. Il n’a pas d’odeur, de goût, de son, de texture, il est invisible… Il ne nous est perceptible que par l’idée que nous nous en faisons. Nous en avons fait un concept, nous l’avons découpé, mathématisé pour pouvoir le compter et s’en faire une idée. Nous ne le discernons réellement que dans ses grandes lignes, celles des jours et des nuits qui se suivent, des saisons qui se succèdent. Nous ne le comprenons que selon les marques qu’il laisse sur le paysage ou nos visages, son sceau en filigrane sur nos existences. Et pourtant, dans la photographie de Michael Wesely, il nous apparait en devenir. Il s’exprime en degré d’intensité dans la lumière, il s’étend, s’allonge, dans le cadre, il est inscrit dans le commencement, la vie et la fin de chaque chose qui s’y passe. Il transparait à travers chacune d’elle, se laissant à peine entrevoir dans l’éphémère, s’affirmant un peu plus dans le continuel et le durable, jusqu’à révéler son indicible présence dans la permanence des choses. Il est ces halos de lumière vivants et vibrants, imprimés par le soleil ou les phares de voitures, autant qu’il est ces édifices érigés vers le ciel comme des défis éternels. Et finalement dans cette photographie, lorsque nous pensons voir une rue, des immeubles, la ville, ne voyons-nous pas plutôt la matérialisation du temps par la lumière ?
Le véritable sujet de la photographie de Michael Wesely, plutôt que le MOMA, ne serait-il pas alors le temps, la vie et la mort, un questionnement existentiel sur la permanence et l’impermanence des choses ? Quelle est la place de l’humain, sa représentation dans une photographie comme celle-ci, si ce n’est ce qui reste de lui pour témoigner de ses actes, puisque même sa silhouette ne saurait apparaître dans une telle prise de vue. En m’interrogeant sur cette photographie de Michael Wesely, il me venait sans cesse en tête des images de peintures de « vanités », à l’évidence ce n’était pas un parallèle visuel qui s’effectuait dans mon esprit mais clairement une association d’idées. Car en dehors de mon attachement aux qualités esthétiques de l’œuvre de Michael Wesely, c’est le sujet inhérent à sa photographie qui résonnait dans mes pensées. J’y retrouve l’esprit du « memento mori » ce concept né dans l’antiquité et qui depuis le Moyen âge n’a eu cesse d’évoquer notre fragilité face à la fuite du temps, comme pour mieux nous rappeler que mortels, nous ne sommes que de passage, et ne restera de nous que ce qui nous dépasse.
Michael Wesely : https://wesely.org
Michael Wesely vidéo I en anglais :
Saul Leiter: Foot on E1, 1954
L’esthétisme de cette photographie de Saul Leiter « Foot on the EI » prise en 1954, va bien plus loin que de simples considérations de goûts. Et c’est bien en cela qu’elle retient l’attention autant qu’elle éveille émotions et sentiments.
Saul Leiter, à l’instar de William Eggleston, fait partie des pionniers de la photographie couleur. A ce sujet le photographe déclarera : « Je suis censé être un pionnier de la couleur. Je ne savais pas que j'étais un pionnier, mais on m'a dit que je suis un pionnier. Je vais juste aller de l'avant et être un pionnier ! ». Je pense que cette phrase dit beaucoup de l’homme qu’était Saul Leiter et de sa photographie. Elle révèle un état d’esprit, que l’on retrouve aussi chez William Eggleston, et tant d’autres grands photographes qui ont marqué l’histoire de la photographie. Ce que nous dit ici Saul Leiter c’est qu’il est libre, qu’il suit son instinct, fait confiance à son regard, et photographie la beauté là où il la voit, comme il la voit, sans aucune contrainte, sans se laisser influencer de quelque manière que ce soit. Et si tant est que quelque chose ait pu influencer le photographe ce serait alors sa passion pour la peinture qu’il a toujours pratiquée. Or la peinture, c’est de la couleur. Je ne connais pas, hormis dans la peinture contemporaine, d’œuvre en noir et blanc. Saul Leiter s’en amuse d’ailleurs lorsqu’il déclare : « Je trouve étrange que quelqu'un puisse croire que la seule chose qui compte est le noir et blanc. C'est juste idiot. L'histoire de l'art est l'histoire de la couleur. Les peintures rupestres avaient des couleurs… (Mais) il y a toujours eu l'idée dans certains cercles que la forme est plus importante, qu'avoir trop de couleurs n'est pas bon, cela distrait de votre concentration. »
Voilà donc un homme libre, qui photographie aussi les couleurs de ce qui appelle son regard au hasard de ses promenades. Il nous délivre des images d’un esthétisme qui transcende l’idée de « street photography » tant elles dépassent, dans leur facture, ce que l’on s’attend à voir de l’instantané, du quotidien, de la rue « Foot on the EI » en est l’une des expressions. Cette photographie s’inscrit typiquement dans le style « street photography » par son contexte, un instantané, et par son sujet, le pied d’un homme sur le siège d’un wagon de métro. Alors que, paradoxalement, le rendu de cette image suggère une démarche qui pourrait s’apparenter à une vision pictorialiste de la photographie.
La lecture de cette photographie, qui pourrait sembler presque évidente dans sa composition, reste pourtant troublante. Evidente car les lignes qui l’anime sont fortes, le regard suit des diagonales ascendantes et descendantes venant se rejoindre à droite de l’image comme une flèche dont la pointe nous révèle la présence d’un homme seulement par son pied posé sur une banquette. Pourtant à première vue, c’est un wagon vide que l’on pensait voir. Ce n’est là qu’un premier déchiffrage, comme lorsque l’on ouvre un livre et que notre regard va mécaniquement de gauche à droite, s’attardant de temps à autre sur des points d’accroches. Mais où Saul Leiter s’amuse, et c’est ce qui rend cette première lecture troublante, c’est qu’à bien y regarder, la dynamique de ce cliché ne vient pas seulement des sujets photographiés, à savoir l’intérieur d’un wagon, ses banquettes et fenêtres, un soulier d’homme. On a le sentiment qu’il y a comme une autre image par-dessus ce que l’on voit du wagon et ses banquettes, comme une image fantôme, et qu’elle participe à sa construction, en devient une partie parfaitement intégrée. On comprend alors que c’est l’effet de jeux de reflets nous donnant à deviner la présence d’autres fenêtres que celles que l’on voit. Ils dessinent l’une des diagonales maîtresse de la composition de l’image, qui vient en rejoindre une autre, celle tracée par les lignes des banquettes. Ainsi les plans qui construisent la photographie sont à la fois le fait des objets parfaitement tangibles qui y sont représentés mais aussi celui d’éléments immatériels, comme superposés, tels ces reflets. Et ce sont ces différents plans et ces superpositions qui font passer l’image d’une lecture bidimensionnelle à une lecture en trois dimensions.
Une autre particularité de cette photographie est sa facture, dont l’esthétisme pourrait avoir des airs de pictorialisme. Le mouvement pictorialiste 1890-1910, avait pour nom d’origine « pictorial photography » soit « photographie peinture » ou « photographie image ». L’idée, à une époque où la photographie était majoritairement documentaire, était de prôner une photographie créative où l’image devait prédominer le réel. Elle devait être pensée de manière picturale, comme une peinture, pour tendre vers une dimension plus artistique. Pour cela, les photographes pictorialistes, s’aventuraient à essayer de nouveaux cadrages, exploraient la lumière, et favorisaient les compositions suggérant un point de vue subjectif pour transmettre des sensations plutôt qu’une réalité qui se voudrait objective. Et « Foot on the EI » de Saul Leiter semble se faire l’écho de cette volonté artistique dans son cadrage, sa composition et sa lumière. Même les couleurs de l’image, les quelques teintes d’ocre et de brique qui se détachent d’un gris presque bleuté, ne sont que nuances et dégradés selon la façon dont la lumière se pose sur elles. Chaque élément pictural est exprimé avec délicatesse, avec une retenue qui donne à voir un peu pour offrir beaucoup plus à imaginer.
Saul Leiter est un maître dans l’art d’inviter notre imagination à se promener dans ses photographies. Dans cette image il nous présente uniquement ce qu’il veut que nous voyions et nous ouvre un espace de liberté, celui d’en interpréter le sujet selon notre perception. Comme s’il nous passait le relais, se dépossédait de sa photographie pour que nous puissions nous l’approprier à notre tour selon ce que nous en comprenons. Les lignes formées par les éléments tangibles et immatériels seraient alors comme des indices ayant pour rôle de nous guider le temps d’un premier regard. Alors que les plans, comme d’autres territoires à explorer, appelleraient le questionnement qui nous permettra de nous emparer de l’image par le ressenti que l’on s’en fait. Comment alors interpréter cette image ? Que peut-elle évoquer, si ce n’est un ensemble d’interrogations dont les réponses n’appartiennent qu’à ceux qui y attardent leur regard et laissent aller leur pensée ?
On peut se raconter que le wagon est presque vide en raison de l’heure à laquelle aurait été prise la photo ? Mais alors quand dans la journée puisqu’à l’évidence il fait jour, le matin ou l’après-midi en dehors des heures de pointe, à moins que ce ne soit en milieu de journée, au moment où l’on prend sa pause repas ? On peut se dire aussi que la raison pour laquelle cet homme s’autorise à poser son pied sur la banquette serait parce qu’il est seul dans ce wagon, ou qu’à cette époque ce n’était pas une posture inconvenante ? Et plus encore, peut-être profite-il de son trajet pour se détendre entre deux entrevues professionnelles, se rend-il à un déjeuner d’affaires ou bien un rendez-vous galant ? Est-ce qu’il lit un journal, somnole-t-il ? Et son soulier semble être de belle qualité, il ne s’agirait donc pas d’un ouvrier, peut-être alors d’un homme issu de la classe moyenne ? Ainsi « Foot on the EI », ouvre le champ des questions et réveille notre inclination à se demander qui il est, pourquoi on ne le voit pas ? Dès lors une grande partie de l’intérêt de cette photographie réside dans le mystère créé par ce qu’elle ne montre pas, le fait que l’on ne voit rien de l’homme si ce n’est son pied.
Ces questions et tant d’autres encore sont les premières qui me viennent à l’esprit, et elles relèvent d’intuitions, de connaissances, d’observations qui me sont toutes personnelles. Une autre personne, un autre vécu, un autre regard, amèneront d’autres questions et d’autres réponses. C’est pourquoi je pense que l’on peut dire de Saul Leiter qu’il est un photographe généreux, car il invite chacun d’entre nous à prendre la liberté de nous égarer dans ses images, pour mieux retrouver le sens de ce que nous souhaitons y voir.
Saul Leiter : http://saulleiterfoundation.org
Saul Leiter Vidéo : In conversation with Saul leiter 2012 I en anglais
https://americansuburbx.com/2012/04/asx-tv-saul-leiter-in-conversation-with-saul-leiter-2012.html
In no great hurry I en anglais I extraits
https://tomasleach.com/portfolio/in-no-great-hurry-13-lessons-in-life-with-saul-leiter
In no great hurry I en anglais I achat:
http://watch.innogreathurry.com
William Eggleston : Untitled, 1974
William Eggleston : Untitled, 1974 © Eggleston Artistic Trust
J’aime beaucoup cette photographie de William Eggleston : Untitled 1971-1974, pour ses couleurs, son cadrage et ce qu’elle raconte des Etats-Unis de cette époque. Il est difficile d’arrêter son choix sur une image de William Eggleston, tant nombre d’entre elles sont exceptionnelles et iconiques. C’est donc tout à fait subjectivement que j’ai sélectionné cette image qui pourrait s’appeler « Ford Torino » ou « New Generation » et qui de mon point de vue est assez représentative de ce qui fait la singularité de ce photographe, considéré aujourd’hui comme l’un des plus influents de la photographie contemporaine.
C’est lors d’une traversée de l’Amérique avec son ami Walter Hopps commissaire d’exposition que William Eggleston a pris cette photographie, à Los Alamos ville dont le nom est aussi le titre du livre réunissant les photographies prises à l’occasion de ce road-trip. Les sujets de prédilection du photographe s’inscrivent majoritairement dans ce qui semble banal, une sorte de quotidien visuel auquel on ne prête guère attention mais qui représente une Amérique iconique dont on aurait gratté le vernis. William Eggleston explore l’ordinaire pour montrer une autre Amérique, déshabillée de ses promesses, de ce qu’elle voudrait dire d’elle aux américains et au reste du monde. Il en fait le portrait avec autant d’attention et de soin qu’il ferait celui d’une personnalité importante. Il refuse l’idée d’une hiérarchie des sujets, c’est ce qu’il appellera « the democratic camera ». De la même façon, il fera le choix de la couleur, avec le procédé Dye- Transfert, à une époque où elle était plutôt l’apanage de la publicité, et donc considérée comme vulgaire, pendant que le noir et blanc régnait en maître sur la photographie d’Art. Ainsi William Eggleston photographie une Amérique dans toutes ses couleurs, il en fait le portrait avec la plus grande des libertés et une ironie dont je pense qu’elle reste teintée d’une certaine tendresse.
Voici une image assez frontale, dans laquelle pourtant aucun élément ne se trouve au centre. Elle pourrait presque évoquer l’idée d’un triptyque, tant elle est organisée autour d’éléments allant par trois. Les sujets, la voiture, et les deux affiches « New Generation » et « Ford Torino », blocs de couleurs dans l’image, accrochent le regard. Les plans avec la teinte neutre du bitume, l’imposant mur noir et le ciel bleu pâle, forment eux aussi un trio, et semblent être au service des sujets dont ils renforcent la présence par contraste. Au-delà de la circulation qui se créé dans l’image par les écarts de valeurs entre lumineux et sombre, couleurs et non-couleurs, c’est aussi la composition de la photographie qui en révèle le sujet, et donne sa force à l’ensemble. Chaque élément est à sa place presque comme si tout avait été placé volontairement et précisément. Or il n’en est rien, cette photographie de William Eggleston, comme le reste de son oeuvre, relève de l’instantané, il voit la dynamique des formes et des couleurs, les comprend et sait se positionner pour créer le cadrage le plus révélateur de ce qu’il souhaite montrer. Il dira d’ailleurs de son travail : « je suis soucieux d’organiser ce qui se trouve dans le cadre, dans le moindre détail ».
Il y a dans cette photographie une énergie palpable dans la façon dont sont organisés ses éléments constitutifs. Comme un travail d’équilibriste entre le signifiant matérialisé par la voiture et les affiches publicitaires, et le vide tout autour, le dépouillement du reste de la scène, de cette rue déserte et sans vie, qui devient plus qu’un simple cadre et se fait acteur de la photo au même titre que le reste. C’est un dialogue qui se créé entre forme et fond, où chacun sert le rôle de l’autre. Tout est contraste, les pneus noirs sur le bitume usé par le soleil, le vert émeraude de la voiture avec son toit beige qui se détache sur le fond noir du mur. Et l’affiche d’un bleu délavé par le temps, illustrant une vitre brisée de laquelle surgit de l’ombre une typographie blanche, vient pour sa part, répondre aux teintes et aux contrastes de la voiture. Enfin le panneau publicitaire qui surplombe l’ensemble avec cette Ford Torino bleu roi sur fond jaune est aussi affaire de contraste. Dans cette photographie le regard est constamment baladé d’un élément à l’autre, les teintes claires sont en écho dans leurs gammes de beige et de jaune, les couleurs se répondent en vert et bleu, nous guidant dans la lecture de l’image avec un rythme qui lui est propre.
Il faut se souvenir, et je l’ai mentionné plus haut que cette photographie a été prise en 1974 à Los Alamos, ville où Oppenheimer effectua ses recherches sur la bombe atomique de 1942 à 46, soit environ 30 ans auparavant. Et c’est à se demander si Wiliam Eggleston, en faisant cette image, n’aurait pas vu là une belle occasion d’ironiser sur l’essor fulgurant de l’économie américaine, son hégémonie à l’issue de la seconde guerre mondiale, et sur le désormais célèbre « american way of life ». De fait, le photographe met en relation dans le même cadre une voiture garée, de type « muscle car », une affiche où les mots « new generation » en lettres capitales, brisent une vitre pour jaillir de l’obscurité, et une affiche publicitaire de la fameuse Ford Torino accompagnée de ces mots « really solid car ! ». A mes yeux, ces trois sujets, la voiture et les deux affiches sont des symboles particulièrement forts pour peu qu’ils soient replacés dans leur contexte géopolitique.
Quand je regarde cette photographie, ce que je vois en premier lieu ce sont les deux voitures, et je ne peux m’empêcher de faire le lien avec l’histoire de l’industrie automobile américaine et ses conséquences. Dès la fin de la guerre, l’industrie automobile américaine a pris la relève de l’industrie de guerre et a imposé les Etats-Unis en maîtres absolus du marché à échelle mondiale, amenant dans sa course, la majorité des pays à se repenser dans un nouveau mode de vie basé sur le « tout-automobile ». La voiture est devenue incontournable, elle est le symbole d’une victoire, de la réussite, et même de la liberté, elle est la nouvelle Amérique, elle est toute puissante. Et c’est ce que je lis de la photographie de William Eggleston, avec la représentation de ces deux voitures triomphantes régnant sur l’image, comme elles règnent sur une rue désertée de toute présence humaine.
Puis vient l’affiche « new génération » et son impact visuel, il y a une forme de violence dans la façon dont les mots, en blanc sur fond noir, s’imposent au regard, comme une explosion, ils font voler une vitre en éclat. Alors qu’on aime à penser que les mots « nouvelle génération » soient porteurs d’espoirs, ici l’espoir semble être présenté comme une rupture. Que comprendre de cette affiche si ce n’est que la « nouvelle génération », sort de la noirceur et n’arrive pas sans fracas, comme si elle naissait d’un combat avec une obscurité passée pour apparaître, lumineuse, en grande conquérante. De la même façon que l’Amérique moderne et triomphante, est née de la guerre et s’est révélée au monde dans sa toute puissance avec la bombe atomique, conçue à Los Alamos, où William Eggleston a pris cette photographie !
Enfin comme pour mettre un point d’exclamation à la photo dans sa composition, autant qu’à ce qu’elle raconte, vient l’affiche publicitaire qui domine la scène et qui représente la nouvelle Ford Torino qui remplacera peut-être celle garée à ses pieds, comme une nouvelle génération et qui s’affirme déjà comme étant : « solid ! ».
Je tiens à remercier « The Eggleston Art Foundation » pour son aide dans la préparation de cet article, qui a répondu très agréablement à mes questions et pour m’avoir procuré la photographie de William Eggleston présentée ici.
William Eggleston :
http://egglestonartfoundation.org https://www.instagram.com/egglestonartfoundation/
Vidéos :
Imagine - The Colourful Mr Eggleston (en anglais):
Douglas Sloan Director (en anglais): le fils de William Eggleston parle de son père et ses photographies:
Nadav Kander : Chongqing IV _ Sunday Picnic
Cette photo de Nadav Kander qui a gagné le prix Pictet Earth, m’a profondément émue, tant par sa beauté que par son sujet.
Les couleurs y sont d’une douceur et d’une poésie subtile, toute en nuance. La composition est magistrale. L’image semble coupée en deux par une grande colonne au pied de laquelle à droite, est installée pour un pique-nique une famille paisible qui semble minuscule dans une architecture aux proportions titanesques. En face, sur le fleuve, on découvre la présence d’un pêcheur sur sa modeste barque, qui observe la scène, tel un témoin d’une autre époque. Au-delà de la famille, le rythme des colonnes amorce une perspective comme une mise en abîme. En la suivant, le regard revient vers le côté gauche de l’image, derrière le pêcheur, et là se dessine dans le brouillard, un autre pont plus récent que celui sous lequel se situe la scène.
Ce qu’il y a de remarquable dans cette photographie, c’est la façon dont elle témoigne du rapport de l’homme à son environnement. Elle nous parle du contraste entre un héritage culturel, qui se manifeste paisiblement avec l’homme assis dans sa barque traditionnelle, et le futur toujours en construction, d’un pont à un autre, toujours plus moderne. On voit bien que les berges du Yang Tse ont pris à cet endroit, des airs de terrain vague, comme un espace en devenir, suspendu entre le passé et l’avenir. C’est à mon sens, ce que semble illustrer ce pont aux colonnes bleues filant vers celui, plus contemporain, qui se profile à l’horizon.
Nadav Kander raconte en une image la place laissée à l’homme, secondaire, face au progrès et ses constructions. Il montre une course à la croissance qui ne s’encombre pas de considérations quant à l’humain et la nature dans laquelle il vit, à savoir un milieu naturel détérioré par l’homme et contre l’homme. Le paradoxe du progrès, où l’homme devrait vivre en harmonie sur ses terres, préserver son eau, et où, si tant est qu’il doive construire, ce serait alors pour améliorer son bien-être. Mais là, plus rien de cela ne compte, l’environnement est sacrifié, autant que les êtres qui y vivent et qui en vivent. Pourtant et malgré cela, cette photographie laisse entrevoir une forme d’espoir, elle parle de résistance autant que d’adaptation, comme une force vitale qui ne s’éteint pas et tente de conserver un équilibre pourtant bien fragile, figuré ici par les personnages de la scène.
Le pêcheur sur sa barque devient le symbole immuable d’une Chine multiséculaire qui ne saurait disparaître. Il personnifie un mode de vie hérité de ses ancêtres et observe paisiblement le monde moderne, incarné par cette famille installée sur la rive du fleuve. Famille qui, quant à elle, s’approprie la modernisation et son architecture envahissante, en s’accordant le bonheur simple d’un pique-nique autour d’une table recouverte d’une nappe de dentelle.
Cette photo pourrait avoir quelque chose de rude dans ce qu’elle évoque des outrages de la pollution, de la course à la modernisation. Elle demeure pourtant une image d’une délicatesse inattendue en prenant les traits d’un paisible pêcheur et d’une famille souriante, réunie pour partager le plaisir de manger ensemble au bord de l’eau.
L’intelligence et la force de Nadav Kander avec cette photographie est d’avoir su illustrer un péril environnemental sans pour autant stigmatiser les personnages présents sur l’image, qui certes y participent à leur échelle mais en subissent aussi les dévastations. Car après tout cette famille n’est peut-être pas culturellement sensibilisée comme nous le sommes à l’écologie. Et il serait trop aisé de vouloir dénoncer seulement quelques individus pour des déchets laissés après un pique-nique, sans au préalable s’interroger sur les politiques industrielles du monde dans lequel nous vivons autant que sur nos habitudes consuméristes.




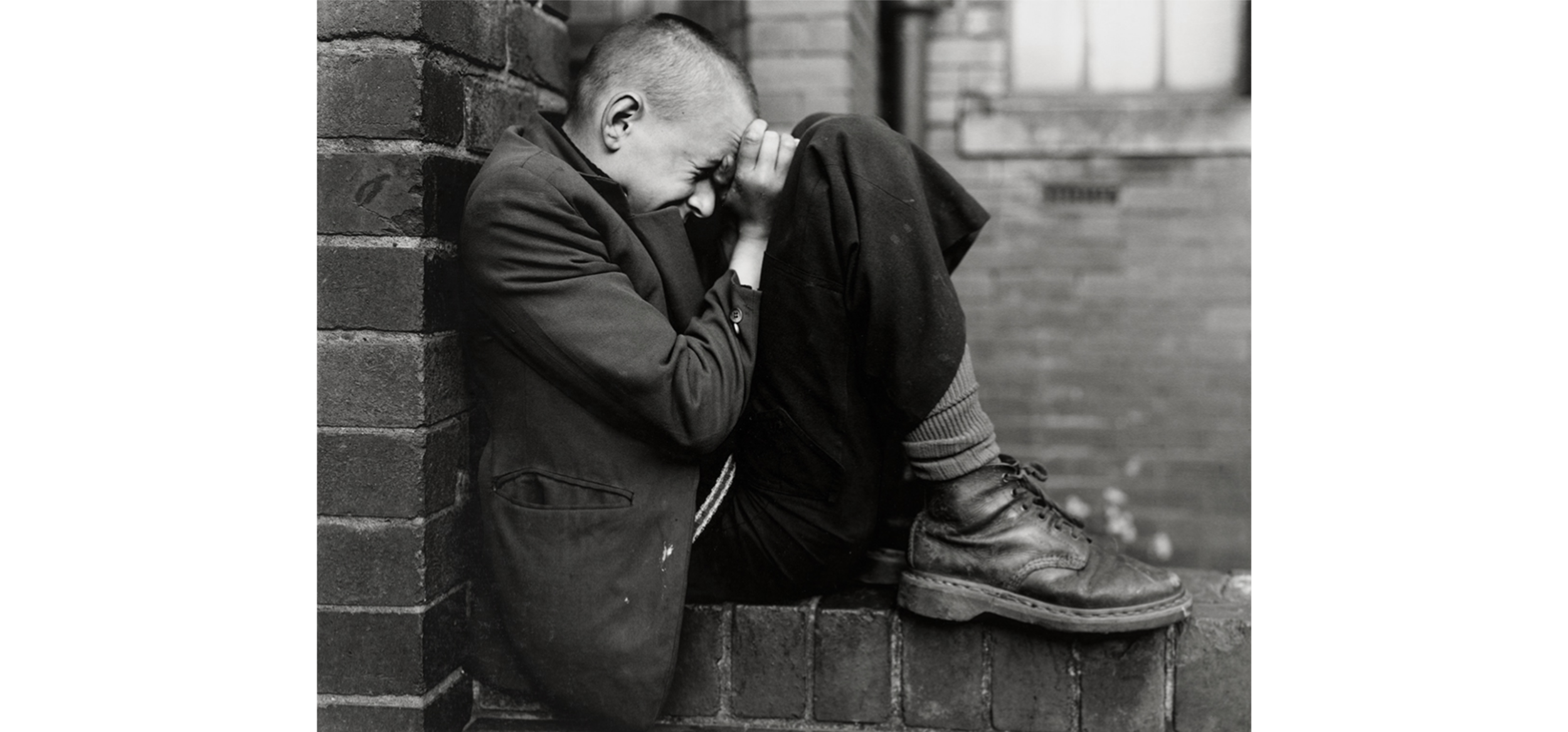





























C’est à 10 ans qu’elle est tombée amoureuse de la photographie, elle lui a promis fidélité, dans le bonheur comme dans les épreuves, ils vivent heureux et font beaucoup de photos !
Photographe d’architecture, de décoration intérieure, d’établissements touristiques, de culinaire et de portraits, ce qui l’anime c’est l’humain et son savoir-faire, ce qu’il fait et lègue. On dit d'elle qu'elle amène poésie et spiritualité autant dans les petits riens graphiques ou colorés qui nous entourent, que dans les personnes ou le monde qui la balade.
Site web - Facebook - Instagram - LinkedIn