Invité dans le podcast “Prime Lenses”
J’ ai eu la chance d’ être invité dans le podcast de Iain Farell, Prime lenses, où je parle de …
Je poursuis ma percée dans l’univers de la photographie Anglo-Saxonne puisque j’ai eu la chance d’être invité dans le podcast de Iain Farell, “Prime Lenses”, où j’ai pu parler de mon évolution en tant que photographe à travers mes différents choix de lentilles au fil des années.
D’un loisir fun, à un simple job, à une passion dévorante, je vais loin dans une auto-analyse que je n’avais bizarrement encore jamais faite.
L’épisode est en Anglais mais vous avez la possibilité d’obtenir une transcription qui semble bien s’accommoder de mon accent Frenchy, et des sous-titres sur Youtube, je vous mets les différents liens à disposition pour que vous puissiez choisir ce qui vous convient le mieux.
MAGA: Make Analogue Great Again
Un esprit analogique dans un monde numérique, c’est possible et même souhaitable, et je vous explique pourquoi dans cet article…
J’ai quitté Facebook il y a maintenant un peu plus d’un mois. Enfin, quitté, le mot est un peu fort, tellement Facebook est omniprésent partout sur Internet et a réussi, incroyablement, à privatiser un lieu sur lequel on se rend avant tout parce qu’il est censé être un espace ouvert et libre.
Mon compte est donc toujours actif, et le restera à priori puisque j’ai été trop investi dans ce réseau par le passé, mais j’en suis déconnecté partout et j’y vais très rarement, en espérant tomber sur l’une des rares fois où le réseau m’a apporté quelque chose de positif.
Car la positivité, c’est précisément ce qui manque aux réseaux sociaux en général, et à Facebook en particulier. La jalousie, la frustration, l’énervement face aux opinions extrêmes qui se banalisent, il y en a à foison, et le souci, c’est que quand on ressent ce genre d’émotions devant l’écran, on les garde avec nous au moment de se déconnecter.
Je me suis donc déconnecté de Facebook pour retrouver ma positivité. Celle de ma jeunesse, où tout ça n’existait pas et où la seule chose qu’on pouvait voir quotidiennement, c’était le Club Dorothée. Qui était le plus proche qu’on pouvait trouver de la surabondance, vu le temps absolument dément qu’ils passaient à l’antenne chaque jour pour l’époque, mais encore bien loin de l’omniprésence qu’on sent partout aujourd’hui. C’était avant le numérique, ma jeunesse. Tout était analogique.
Ca m’a fait réfléchir à ce que le numérique nous a réellement apporté? Coté pile, c’est l’illimité et l’instantanéité. Coté face, c’est la perte de la conscience de soi face à la surabondance de vie des autres qu’on peut observer en temps réel, H24.
Quand Internet est arrivé en France et dans le monde, il passait par des réseaux téléphoniques surtaxés qui faisaient qu’on ne passait pas trop longtemps en ligne: on se connectait, on faisait ce qu’on avait à faire, et on se déconnectait pour reprendre le cours de sa vie normale. Les e-mails, qu’on consulte maintenant en temps réel, étaient très occasionnels à l’époque, et mes échanges avec ma meilleure amie partie vivre aux Etats-Unis se faisaient par courrier aérien. Pour lire une BD que je n’avais pas le moyens d’acheter, j’allais à la FNAC m’asseoir dans les rayons, au lieu de pouvoir tout trouver dans les boutiques en ligne, voire sur des sites qui publient les derniers mangas avant même leur sortie officielle. Si je faisais des photos, j’avais 36 poses sur mon film, et tant qu’il n’était pas fini, je patientais pour les découvrir. Si je regardais Dragonball à la télé, c’était à la merci des diffuseurs qui décidaient quel épisode j’allais voir, et si je pouvais regarder la série jusqu’au bout (après toutes ces années, nombreux sont ceux d’entre nous qui regardaient religieusement Ulysse 31 ou Jayce et les conquérants de la lumière, mais n’en ont jamais vu la fin). Bref, l’ère analogique, c’était plein d’inconvénients, mais il fallait prendre son temps et avancer lentement. Et c’était chouette en fait.
Je ne crache pas sur ce que nous a apporté le numérique, et l’abondance qui va avec: c’est chouette de pourvoir converser en direct avec quelqu’un qui est à l’autre bout du monde, de découvrir en avance une histoire qu’on adore ou même simplement de pouvoir consulter, retoucher, imprimer et insérer dans son journal une photo prise le jour même. Le numérique a plein de bons cotés.
Mais quand on enlève d’un coup 100% des limitations, il y a aussi un contrecoup: les e-mails gratuits, ça engendre un volume terrifiant de spam, comme les appels et SMS gratuits d’ailleurs. Le stockage de photos illimité, çe fait qu’on prend 35 photos identiques qu’on ne regardera absolument jamais. Les messages instantanés, ça fait qu’on a toujours plusieurs discussions en cours, en permanence, même quand on dort. Oui c’est « gratuit » et il n’a jamais été aussi abordable de faire à peu près tout et n’importe quoi qu’aujourd’hui, mais parfois, il faut savoir se limiter tout seul pour garder les avantages et ne pas se laisser déborder par les inconvénients.
D’où mon idée: entre accepter de voir sa vie gouvernée par ce qu’on peut, mais ne veut pas forcément faire, et rejeter en bloc tout ce que le progrès nous a apporté, il y a une voie médiane. Et cette voie médiane, c’est un esprit analogique dans un monde numérique. Exploiter les possibilités, tout en sachant se limiter pour ne pas en subir les effets pervers. Ralentir intentionnellement, se réhabituer à réfléchir en amont, pour gagner du temps et de la sérénité en aval. Ne pas dire non au numérique, mais l’exploiter correctement.
Ce sera l’objet de cette série d’articles, comment appliquer la philosophie d’un monde aux ressources limitées à un monde où on nous pousse à croire que tout est infini. Pour ralentir, reprendre le contrôle, et respirer sans se laisser happer par la matrice. Mon but est de tenter de reprendre le contrôle pour vous montrer que c’est possible, souhaitable, et vous donner envie de vous approprier cet état d’esprit. Chaque article, je prendrai un domaine en particulier où je vais retrouver la manière de faire à l’ancienne, et je vais trouver un moyen de l’adapter au monde actuel et à ses possibilités, sans se laisser déborder.
Un grand photographe m a dit un jour « tu dois remplir ta tête de tes propres pensées, pas de celles des autres ». Ceci est le premier pas vers mes propres pensées. Et les votres.
Je parle de Street Photography sur Youtube
J’ai été invité il y a quelques semaines à parler de street photography sur la chaine Youtube de Guillaume W.
Le principe est simple: on marche dans le quartier de mon choix pendant une matinée, je fais des photos, et on discute de comment je vois les choses et de pourquoi je fais ce que je fais.
Un excellent moment, d’autant plus que parvenir à ordonner ses propres pensées est un excellent exercice pour progresser. Et une bonne leçon de Youtube, un de mes objectifs de 2024 étant de m’y développer.
Je vous laisse découvrir la vidéo et je mets mes photos réalisées pendant la balade juste en dessous,























VLOG 001: Photowalk Blurb à Paris
Je vous avais prévenu dans l’épisode 096, cette saison sera celle de toutes les expérimentations. Dans les choses que j’ai envie de tenter, il y a la vidéo et YouTube. Non pas que le format me plaise particulièrement, je trouve que filmer et monter une vidéo est particulièrement lourd et ennuyeux, mais j’ai peut-être trouvé la petite brique de matériel qui me permettra d’alléger un peu ce coté technique, pour me focaliser sur ce qui m’intéresse: créer et raconter des histoires, et pousser les gens à donner le meilleur d’eux-même.
J’ai donc trouvé une petite caméra qui me convient bien (je rêve d’un appareil qui fait ça depuis au moins 25 ans), et une façon de fonctionner qui va certainement demander à être affinée avec le temps, mais c’est un premier pas. J’ai surtout trouvé l’envie et l’excitation de créer quelque chose sans craindre le résultat, qui est le pire frein qu’on puisse croiser dans la vie.
Pour démarrer, je vous propose donc de me suivre sur le photowalk avec Blurb du 11 novembre dernier, organisé par un photographe dont j’adore le travail, Daniel Milnor, qui a été l’occasion parfaite de m’essayer au vlogging.
Pour voir tout ça, direction YouTube:
12 leçons à retenir du livre Eaux Fortes de Christophe Jacrot
J’ai découvert ce livre par le biais d’un communiqué de presse, et l’image incroyable qui orne sa couverture m’impressionne toujours autant après plusieurs jours à trôner sur la table de mon salon. Premier constat, l’objet est imposant, et si c’est un plaisir de voir des images en aussi grand format, il est nettement moins facile à ranger (mais du coup il peut rester à disposition sur la table du salon).
Je pourrais me contenter de vous dire que ce livre est magnifique et vous en faire une critique rapide, mais ça serait mal me connaître et j’essaie, à chaque fois, d’apprendre quelque chose de ce que je regarde avec admiration. Au lieu d’un avis, je vous propose donc les 12 leçons que j’ai tiré de la lecture de ce livre, que je vous invite à consulter ensuite pour peut-être confronter vos observations aux miennes.
C’est parti:
On trouve parfois son inspiration ou personne d’autre ne va
Photographe du mauvais temps, quelle drôle d’idée... Là où la plupart d’entre nous se mettent à l’abri quand il pleut, Christophe se dépèche de sortir de chez lui au moindre signe de mauvais temps. Parfois, il faut avoir l’esprit tourné différemment pour produire un travail différent.
Il faut savoir pousser les portes fermées
Certains des bâtiments photographiés dans cet ouvrage sont sur des propriétés privées ou difficiles d’accès. De la même manière qu’il faut parfois oser aller chercher une image dans la rue, il faut souvent oser pousser les portes fermées pour dénicher des trésors.
La préparation est la clef de la réussite
Non seulement il faut rechercher les lieux exceptionnels pour produire constamment de belles images, sans se reposer sur le hasard ou la chance, mais il faut également être prévoyant pour provoquer sa propre chance, par exemple en prévoyant des miettes de pain pour attirer des oiseaux et apporter un peu de vie à une image.
Il faut parfois plusieurs tentatives pour obtenir un (ou plusieurs) bon résultat
On retrouve dans ce livre plusieurs images de lieux similaires, et parfois, il faut insister et revenir pour voir les choses sous un autre angle ou dans de meilleures conditions.
Ce qu’on ne montre pas est plus important que ce qu’on montre.
C’est valable dans de nombreux travaux photographiques, mais dans celui-ci, ce qui est masqué dans les ombres ou dans le brouillard sert à mettre en avant ce qui est dans la lumière sans le phagocyter.
Un mouvement donne vie à l’image du paysage
Qu’il s’agisse d’un animal, d’une vague, de la neige, de la pluie, d’un arbre qui penche ou d’herbe qu’on devine bouger par la force du vent, un mouvement perçu transforme un paysage, qui aurait pu être figé, en une scène pleine de vie. Scène dans laquelle se déroule une action qui va laisser le spectateur s’interroger sur ce qui va bien pouvoir se passer ensuite dans cette image.
Les lignes horizontales n’ont pas nécessairement à être droites, mais les lignes verticales si.
L’absence de netteté bien maîtrisée, c’est très joli
Et ça fait de beaux tableaux abstraits.
Le plus important reste de bien connaître son sujet
Savoir photographier son sujet, surtout quand il a été peu exploré par ailleurs, c’est souvent le résultat de plusieurs années de pratique et de réflexion. Les photos à travers le pare-brise, où l’eau dégouline, ont nécessité de nombreux essais avant de trouver la bonne formule, et une fois maîtrisée la technique, on peut avancer rapidement et sans improvisation quand on est pris par le temps.
Les lignes font l’image
Mais vous le saviez déjà.
Simplifier au maximum son image permet de faire ressortir les détails importants et de la rendre plus lisible.
La perfection n’est pas atteinte quand il n’y a plus rien à ajouter, mais quand il n’y a plus rien à retirer.
Les photos sont faites pour être vues en grand
J’ai dit plus haut que le format du livre le rendait compliqué à ranger, mais quel plaisir de visualiser ces images en très grand format, qui est le seul à leur rendre justice.
J’espère vous avoir donné envie de découvrir ce magnifique livre, et que vous aurez appris des choses à la lecture de cet article. Vous pouvez acheter le livre Eaux Fortes de Christophe Jacrot à l’adresse suivante.
Ernst Haas : One, USA - 1968
La photographie couleur, aujourd’hui omniprésente, n’a pas toujours été considérée du même œil que la photographie noir & blanc. Il aura fallu le talent de plusieurs photographes, les pionniers de la couleur, pour qu’elle obtienne ses lettres de noblesse. Tout comme William Eggleston ou Saul Leiter, Ernst Haas, a très largement contribué à sa reconnaissance. Cette image « One, USA - 1968 », me semble assez emblématique de la sensibilité d’Ernst Haas quant à la couleur, et de la façon dont il l’a utilisée pour montrer bien plus que la simple représentation d’un sujet à l’intérieur d’un cadre. Son travail de la couleur, ici associé au flou, réforme l’idée que l’on se fait de la street photography et nous amène à apprécier cette dernière dans une forme d’esthétisme plus pictural, qui semble badiner avec l’art contemporain, voir l’abstraction.
Ernst Haas, est né en 1921, il est autrichien... Il a vécu sa jeunesse en temps de guerre et sera le témoin de ses conséquences dramatiques. Après des études littéraires, il se tourne dès 1940 vers un cursus de médecine, la gravité des évènements ayant très probablement développé en lui le sentiment qu’il fallait se rendre utile dans cette époque plongée au cœur d’un conflit d’une rare violence. Parallèlement il nourrit une affection particulière pour l’art et il est curieux du monde qu’il aimerait découvrir. En 1942, il entre alors à l’Institut des Arts Graphiques de Vienne, mais il se verra contraint de quitter l’école en raison de ses origines juives. Et c’est en 1945 qu’il découvre la photographie se révélant à lui comme une réponse, celle d’une discipline ayant le pouvoir de concilier sa sensibilité artistique et son appétit de voyages.
Comme beaucoup d’autres, Haas a commencé par la photographie en noir & blanc. Il est donc photographe à la fin de la 2ème guerre mondiale et c’est avec ses images du retour des prisonniers de guerre à Vienne, publiées en 1947 par l’hebdomadaire Suisse DU, qu’il se fera remarquer par le magazine américain Life. S’ensuit l’invitation que lui fait Robert Capa d’intégrer l’agence Magnum où, il retrouvera son ami Werner Bishop qu’il avait connu lorsqu’il travaillait pour DU, et où il se liera d’amitié avec Henri Cartier-Bresson. Nous sommes en 1949 et Haas est l’un des premiers photographes à être invité, par ses fondateurs même, à rejoindre la première agence indépendante de photographes, devenue aujourd’hui une référence incontournable. Comme le souhaitait Robert Capa, les photographes de Magnum sont libres, ils choisissent les thèmes qu’ils veulent traiter, suivent leurs idées autant que leur instinct, développent leur propre style, ils partent à l’aventure pour couvrir leurs sujets... C’est en s’inscrivant dans cette dynamique, ce sentiment de liberté, qu’Ernst Haas choisira de venir s’installer aux Etats-Unis en 1951, et qu’il y fera ses premières images en couleur avec le film Kodak I, d’une sensibilité estimée à 12 asa/iso. Le succès ne se fera pas attendre et en 1953 il est le premier photographe à avoir un portfolio de 24 pages exclusivement en couleur, des photographies de New York, publié dans le magazine Life : « Images of a magic city ».
La couleur comme une évidence, en lien avec son histoire et celle du monde. Ernst Haas dira : « Avec le recul, je pense que mon passage à la couleur s'est fait de manière plutôt psychologique. Je me souviendrai toujours des années de guerre, y compris au moins cinq années amères d'après-guerre, comme des années en noir & blanc, ou mieux encore, des années grises. Les années grises étaient révolues. Comme au début d'un nouveau printemps, je voulais célébrer en couleur les temps nouveaux, remplis d'un nouvel espoir [...]. Tout était lié à ce nouveau courage de la couleur. Mode, gastronomie, voyages, voitures, avion, tout changeait et prenait un nouvel éclat. L'âge des ténèbres était révolu. Faut-il alors s'étonner qu'un jeune photographe ait rêvé d'un film couleur avec lequel il pourrait capturer toutes ces nouvelles couleurs de l'environnement ? ». C’est ainsi, et à l’opposé d’Eggleston et de nombreux photographes dont les images servent parfois un propos critique sur les Etats-Unis, qu’Ernst Haas, car il a connu « les années grises » de la guerre dans son épicentre, aura pris un chemin contraire et célèbrera les couleurs, la liberté, et son pays d’accueil.
La couleur et le flou, une démarche esthétique à part entière. La couleur est le point d’orgue de la photographie d’Ernst Haas. Mais pas seulement, l’utilisation du flou sous ses diverses formes, occupe également une place particulière, et sert bien souvent à révéler plus intensément la couleur, l’un et l’autre se soutiennent. Avec le flou la couleur est en vibration, elle glisse, fuse, oscille, coule, s’étire, elle est énergie, elle s’anime. Ernst Haas jouera aussi des reflets et des transparences, de la même façon qu’avec le flou, pour donner vie à la couleur. Ses photographies sont une célébration, celle de voir, de laisser le regard se remplir et s’émerveiller par tout ce que la couleur peut produire d’émotions. La couleur a son identité et son caractère, elle est presque tangible, elle peut se montrer mystérieuse autant qu’elle peut être joie, elle vous absorbe et vous emporte comme dans des rêves dont les teintes ouvrent les portes de l’imaginaire.
La photographie d’Ernst Haas en écho à la peinture, un regard et une pratique de plasticien. Je crois en une révolution photographique amenée par Ernst Haas et qui est très certainement le produit de sa passion pour l’art et des études de peinture auxquelles il s’est consacré durant sa jeunesse. Ernst Haas a expérimenté la peinture, il a peint et je le vois dans ses photographies. A mes yeux, il travaille la lumière, la couleur, le contraste, le flou, de la même façon qu’on travaille la matière. Comme la main du peintre fait danser les couleurs avec son pinceau, le regard d’Ernst Haas fait danser les couleurs avec son appareil photo. Il y a dans sa photographie un positionnement artistique, comme un postulat dont la couleur serait tout à la fois le point de départ, le voyage, et le point d’arrivée, le matériau à explorer jusqu’à l’exalter. Dans cette image, « One, USA - 1968 », je retrouve les vibrations que peuvent m’apporter les couleurs et leurs contrastes dans l’œuvre de Mark Rothko. Alors qu’avec « Lights of New York City, NY - 1972 » et ses foisonnements de lumières polychromes, je ressens une énergie similaire à celle qui jaillit des bouillonnements de couleurs d’un Jackson Pollock. Dans « NY, 1952 » c’est le rythme des larges et généreux coups de brosse de Pierre Soulages qui me vient à l’esprit. Et lorsqu’Ernst Haas joue avec le flou de mouvement, je vois « Forces d’une rue - 1911 » d’Umberto Boccioni, ou le « Nu descendant l’escalier n°2 - 1913 » de Duchamp. Et puis, à parcourir l’ensemble de sa production, j’entrevois la musicalité des toiles de Vassily Kandinsky, le rythme des compositions de Paul Klee, ce sont aussi des œuvres Robert Delaunay, ou encore de Zao Wou Ki, pour ne citer qu’eux, qui m’apparaissent et me reviennent en mémoire... Pour autant je ne pense pas qu’Ernst Haas eut l’abstraction pour objectif, en ce sens que son travail reste ancré au réel et a pour point de départ ce qui se présente devant lui. Il ne s’agit donc pas d’une création abstraite telle que le serait une production conçue en dehors d’un regard direct sur son environnement. C’est je crois plutôt une immersion, c’est ce qu’il voyait et la puissance des couleurs, des lignes et des formes qu’il y décelait, que ses images révèlent avec lyrisme. La photographie d’Ernst Haas est une vision, et cette vision là s’était libérée de la représentation, nous emmenant avec lui un peu plus loin dans notre façon de regarder autour de nous, de nous ouvrir aux émotions que peuvent engendrer les couleurs sur nos esprits, de considérer les choses plus en profondeur. Comme ses photographies où il saisissait une image dans une image, deux images se superposant, et ne faisant qu’une, changeant ainsi la vision et la lecture de chacune d’entre elles. Ernst Haas, avec ce regard si particulier nous apprend à découvrir la couleur qui prend vie, à envisager les lignes comme des chorégraphies, il nous apprend à voir à la manière des poètes.
Selon Ernst Haas : « L'appareil photo ne fait que faciliter la prise de vue. Le photographe doit donner afin de transformer et transcender la réalité ordinaire. Le problème est de transformer sans déformer. Il doit gagner en intensité dans la forme et dans le contenu en faisant entrer un ordre subjectif dans un chaos objectif. Vivant à une époque de lutte croissante de la mécanisation de l'homme, la photographie est devenue un autre exemple de ce problème paradoxal de comment humaniser, comment vaincre une machine dont nous sommes totalement dépendants : l'appareil photo […]. Dans chaque artiste il y a de la poésie. Dans chaque être humain, il y a l'élément poétique. Nous savons, nous ressentons, nous croyons […]. L'artiste doit exprimer la somme de son sentiment, de sa connaissance et de sa croyance à travers l'unité de sa vie et de son œuvre. On ne peut pas photographier l'art. On ne peut le vivre que dans l'unité de sa vision, ainsi que dans l'ampleur de son humanité, de sa vitalité et de sa compréhension […]. » Ainsi, et c’est peut-être justement parce qu’il s’est consacré à la photographie de cette façon, où ce qui permet de constituer une image photographique importe tout autant et parfois plus que la simple figuration de ce qui y est représenté, Ernst Haas a été le premier photographe travaillant en couleur à avoir une exposition monographique au MoMa, en 1962, soit 14 ans avant celle de William Eggleston.
« One, USA - 1968 », la nuit, le flou d’un mouvement, trois couleurs, ce bleu. La composition est simple et linéaire, le point de vue frontal, il n’y a rien d’extraordinaire dans la construction de cette photographie si ce n’est justement ce choix de la simplicité pour mieux révéler ce qui importe ici, les couleurs d’une rue animée de New York, peut-être autour de minuit. Le bleu s’installe, en premier plan et horizontalement sur les deux tiers inférieurs de la photographie, il entre et sort de l’image depuis le bord droit vers le gauche. Il flotte et prend la forme d’une trace, rappelant le mouvement de travelling d’une caméra au cinéma, à la différence qu’ici, la caméra ne se déplace pas, le mouvement est devant l’objectif. C’est celui de la vie d’une rue, et plus particulièrement celui du passage d’une voiture traversant le cadre de droite à gauche. Le bleu dans cette photographie est mouvement, il est flou au point de devenir multiple. C’est un bleu qui vibre de toutes ses nuances, il se décline en différentes tonalités allant du Bleu de Prusse et de l’Indigo, au Cyan en passant par le Bleu Cérulé. Il se manifeste en quatre rubans, où s’alternent ses variations, de la plus dense à la plus légère selon les plans qui se succèdent derrière lui, selon la vitesse d’un véhicule qui passe ou l’immobilité d’un autre stationné là, et selon les lumières des phares et des néons. Sur le bord inférieur de l’image, il s’habille de ces lumières et de ces néons, qui, en rythme et par une multitude de reflets transversaux, répondent aux couleurs du tiers supérieur de la photographie. Il ferme l’image en bas comme il la ferme en haut en un profond bleu nuit. Entre ces vagues de bleu et au niveau du trois quart supérieur de l’image, viennent le blanc, le rouge, et le jaune, éclatants, qui créent un contraste tant par leurs teintes, que par leur netteté. Ces couleurs, sont celles d’une fresque murale représentant des nuages sur fond rouge. Il s’agit certainement d’un club, en attestent les fenêtres occultées et couvertes du même motif nuageux que les murs, ainsi que l’entrée qui, quant à elle, se détache dans une lumière jaune, sous la protection d’un auvent marquise en demi-lune et où est inscrit : « One ». Là, dans cette lumière, se distinguent trois silhouettes. La première, celle le plus à droite, se détache derrière la voiture aux phares allumés et devant le mur peint, c’est peut-être un passant, à moins que ce ne soit un noctambule arrivant au club. Il a le corps dirigé vers la gauche de l’image et son visage paraît tourné vers le photographe. Le second est dos à la porte et regarde vers la droite, sa position pourrait laisser penser qu’il s’agirait là du physionomiste ou du portier. Le dernier, qui est dans le club et en arrière-plan, est de face et regarde dans la même direction que le premier. La position du corps du passant s’oriente dans la même direction que la trace laissée par la voiture qui passe, ainsi que celle, plus nette, des véhicules stationnés de l’autre côté de la rue, devant le « One ». L’entrée du club, avec sa couleur jaune attire l‘œil immanquablement sur le tiers gauche du cadre. Ainsi, et dans cette composition, la lecture de l’image, avec sa dynamique où on entre par la gauche, est définitivement installée et vient arrêter le regard sur le bord droit. Toute la construction de la photographie repose sur des tiers, horizontalement et verticalement, avec pour point de force l’entrée du « One » et les trois personnages aux visages tournés vers la rue, retenant ainsi le regard sur le tiers supérieur gauche de la photographie.
Que nous raconte alors Ernst Haas avec cette image ? Finalement nous ne pourrions deviner que peu de chose si nous devions nous poser la question de savoir ce qu’il se passe ici, ce que nous raconte cette scène de vie. Et c’est peut-être là aussi tout l’intérêt de cette image, elle n’est qu’une scène de vie, elle ne nous révèle que quelques indices sur un moment de vie nocturne à New York. Mais surtout elle nous montre ce qu’Ernst Haas voyait et souhaitait nous donner à voir. Elle nous montre la nuit, mais pas n’importe laquelle, celle de New York, où le temps ne s’arrête pas, où l’on continue de vivre. Elle nous montre les couleurs de cette nuit New Yorkaise, vibrantes, éclatantes et chaleureuses même dans la profondeur de la nuit. Elle nous montre la vie et la richesse de ses couleurs. Déjà, le premier reportage couleur qu’avait publié Ernst Haas dans Life en 1953, réunissait des clichés de New York, il l’avait intitulé : « Images of a magic city ». Nous sommes en 1968 au moment de la captation de cette image, soit plus de vingt ans après son expérience de la guerre et ses années grises, et 15 ans après sa publication dans Life. Avec cette photographie Ernst Haas nous montre que la magie des couleurs de la ville n’a rien perdu de sa superbe à ses yeux. Il nous emmène avec lui, à la rencontre des couleurs, de leur influence et de leur énergie, nous invitant à les embrasser pour mieux ressentir ce qu’elles nous apportent, et nous laisser nous émerveiller de peut-être simplement pouvoir les voir. Cette dernière citation du photographe me semble pouvoir illustrer ce que je comprends de son œuvre et ce pour quoi elle me touche tant : « Le style n'a pas de formule, mais il a une clé secrète. C'est le prolongement de votre personnalité. la somme de ce réseau indéfinissable de vos sentiments, connaissances et expériences. Prendre la couleur comme un ensemble de relations à l'intérieur d'un cadre […]. On ne cherche pas à attraper des bulles de savon. On les apprécie en vol et on est reconnaissant de leur existence fluide. Plus elles sont fines, plus leur palette de couleurs est exubérante. La couleur est joie. On ne pense pas à la joie. ». Voilà pourquoi, la photographie d’Ernst Haas est si précieuse à mes yeux car au-delà de ces indéniables qualités esthétiques, elle véhicule des émotions et des valeurs essentielles, des rappels à la vie dont chacun d’entre nous devrait pouvoir bénéficier. Ernst Haas nous a offert une photographie libre, curieuse, vivante et enthousiaste, à l’image de l’homme qu’il a toujours été.
Le site d’Ernst Haas :
https://ernst-haas.com/
Un beau catalogue des œuvres d’Ernst Haas en grand format :
https://www.atlasgallery.com/artists/ernst-haas
(cliquer sur les titres d’exposition à gauche)
Dans mon sac: Julien Pasternak (2022)
Mon sac a connu un certain nombre d'évolutions au cours des années écoulées, parce que mon métier et ma façon de le faire ont évolué, et qu'en conséquence mon matériel a évolué en même temps. Voici l'édition 2022 de mon sac photo.
Sac: Peak Design Everyday Backpack 30l v1
Je l'utilise depuis quatre ans, toujours personnalisé, toujours increvable. J'ai commencé par le détester puis j'ai fini par le comprendre et me l'approprier, pour ne plus pouvoir m'en passer au final.
Je l’ai largement customisé et il a connu un peu de couture, notamment pour lui rajouter une étagère en partie haute, et si ce n'était un léger jaunissement avec le temps, la faute à la couleur gris clair que j'ai choisi à l'origine, et une usure des coutures des étagères, il est comme neuf. Je tenterais bien un petit tour en machine cela dit, et les coutures se règlent facilement avec un petit coup de ciseau.
Je pense dans tous les cas qu'il va me suivre encore quelques saisons tellement j'ai pris mes marques avec lui, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le test que je lui ai consacré dans lequel j'explique en détail comment je le charge/décharge, et pourquoi c'est le sac parfait pour moi.
Appareils: 2 x Fuji X-T3 + 1 x Fuji X100V
Comme mon sac, mes X-T3 ont fait un bout de chemin avec moi puisque je les ai achetés début 2019. Mon seul regret est de les avoir pris gris plutôt que noirs, l'apparence métallisée étant en fait du plastique peint qui vieillit moins bien que la peinture noire de l'autre version. C'est un point sur lequel je me fais fréquemment avoir, au point que je me suis juré de ne plus prendre que des appareils noirs simples à l'avenir.
Normalement je renouvelle mes appareils plus fréquemment mais les confinements successifs et le fait qu'ils ont au final peu servi pendant cette période m'ont poussé à les garder plus longtemps. Je ne suis par ailleurs pas fou des "améliorations" très (trop) orientées vidéo du X-T4, ce qui me fait réfléchir à passer à la gamme X-Pro pour mon prochain achat. Vu que Fuji vient d'annoncer sa nouvelle génération de capteurs, je vais attendre les prochaines générations de ces deux gammes d'appareils avant de faire un choix définitif, et peut-être tenter de me faire prêter un X-Pro 3 et les optiques en F2 pour voir s'ils me conviennent en environnement de travail.
Le X100V est mon appareil personnel, mais il est tellement peu encombrant que je l'emmène partout avec moi, toujours en bandoulière. Du coup, il est hors de mon sac quand je me déplace et dans mon sac quand les X-T3 sont sortis, ce qui fait que je peux documenter facilement ce qui m'entoure avant même d'être en place. Et il fait un parfait appareil de Back-Up si un de mes X-T3 venait à me jouer des tours (l'un des deux est capricieux depuis quelques semaines et va partir en révision pendant les vacances).
Optiques: XF 10-24mm f4.0, 23mm f1.4, 35mm f1.4, 56mm f1.2, 80mm macro f2.8
Un des secteurs qui peut être amené à évoluer de mon sac, parce que je cherche toujours à améliorer la portabilité de mon matériel, donc à en diminuer le poids et l'encombrement.
Le 10-24mm f4 est mon optique de dancefloor, elle a pour elle sa grande qualité optique et sa versatilité, et contre elle son encombrement et son poids, pas si importants, mais je m'en sers en tenant l'appareil d'une main et plutôt bas, la gauche étant prise par le flash, donc chaque gramme compte. J'envisage d'essayer le 12mm f2 Samyang pour le remplacer, affaire à suivre.
Le 23mm f1.4 est mon optique la plus utilisée de très loin. Il est globalement toujours monté sur un de mes appareils et si ce n'est pas le cas, c'est que le X100V n'est pas loin. Ma focale préférée, que j'envisage parfois de remplacer par la version f2. Mais je n'arrive pas à m'y résoudre, d'autant plus que la nouvelle version du 1.4 a perdu beaucoup de ce qui faisait le charme de cette optique et que le retour en arrière pourrait être difficile.
Le 35mm est mon optique d'appoint, elle me sert à faire les détails proprement ou à avoir un peu plus de profondeur en reportage, et souvent les arrière-plans sont plus faciles à nettoyer avec cette focale.
Le 56 me sert pour les portraits ou quand je veux varier un peu les photos une fois que j'ai fait le tour au 23mm.
J'utilise très peu le 80mm, encore moins en macro, mais quand j'en ai besoin je suis content de l'avoir. dans tous les cas, il couvre le gros de l'utilisation de mon 50-150, en moins encombrant, et je n'arrive plus à fonctionner avec un zoom donc ça me va très bien au final, même si je reprendrais plus facilement le 90mm f2 si je devais refaire mon achat.
Flashes: 2 x Godox V1 et 1 x Godox AD100 Pro
J'utilise les flashes Godox depuis longtemps et j'en suis ravi. En début d'année dernière j'ai acheté un AD100 Pro, intrigué par sa petite taille, et j'en suis tombé fou amoureux.
Pour rester dans le même format de tête et de batterie, je l'ai complété par deux V1f, qui ont remplacé mes minuscules V350f, pour un bilan mitigé. Les V1 pèsent lourd sur l'appareil au contraire des V350, et au final je m'en sers essentiellement en déporté donc plusieurs AD100 Pro, plus performants et moins encombrants, feraient parfaitement l'affaire, et je pourrai ressortir mes V350 quand le besoin d'un flash cobra se fait sentir. C'est probablement sur ce point que mon kit va fortement évoluer dans les mois à venir.
J'ai également plusieurs kits de modeleurs Godox, dont les grilles que j'utilise beaucoup, mon seul regret étant qu'on est obligé d'acheter un kit complet par flash là où on peut juste avoir besoin d'un filtre.
J'ai aussi deux déclencheurs Godox X-Pro F dont l'un commence à fatiguer, mais qui fonctionnent très bien.
Lanières: 3 x Peak Design Leash
J'ai essayé beaucoup de lanières pour mes appareils photo, mais au final avec des appareils aussi compacts et légers il suffit de peu. Les Peak Design sont légères, confortables, peu encombrantes, disponibles dans plein de couleurs, faciles à enlever où à mettre en mode latéral, et on peut facilement gérer deux caméras à la fois. Et ce sont les moins chères de toutes celles que j'ai essayé, imbattable.
Pieds flashes: Manfrotto 5001B, perche DJI Osmo, Pince Smallrig
Dans la mesure ou j'utilise mes flashes à 98% en déporté, soit sur pied, soit sur une perche que je tiens à la main, il me faut des supports.
J'ai toujours un pied Manfrotto parce que dans certaines situations, rien ne bat le confort de déplacer facilement son flash sur un pied. Ce modèle est le plus compact une fois replié que j'ai pu trouver, et il est assez stable pour ne pas être renversé trop fréquemment par accident.
Pour tenir mon flash à bout de bras, j'ai recyclé une perche de DJI Osmo première génération, et ça fait très bien le job. Mais si je passe à plusieurs AD100 Pro, Godox propose un grip qui a l'air parfait.
Pour positionner mes flashes tout autour de la piste, je me repose sur des pinces Smallrig, peu encombrantes, fiables, et qui s'accrochent un peu partout assez facilement.
Le petit adaptateur bleu Novoflex me permet de positionner un flash cobra sur un pied et de le tourner facilement.
Divers:
Batterie 25000Mah (dans le sac): Un gros modèle qui me permet d'être 100% autonome et de ne pas dépendre d'une prise murale pour charger mes batteries. J'ai également installé dans un compartiment de mon sac des chargeurs pour les différents types de batteries que j'utilise, que je mets à charger directement quand elles sont vides.
Peak Design Range Pouch v2: Un petit sac dans mon grand sac, qui passe sur ma ceinture pendant le travail et contient mes batteries, cartes mémoires, un miroir rond de chez Muji et tout accessoire dont je pourrais avoir besoin dans mon travail.
Portes cartes Think Tank: Je les ai acheté quand j’ai commencé mon activité il y a 10 ans, ils n’ont pas bougé.
Enregistreur audio Roland R-07: J’ai toujours sur moi un enregistreur audio, parce que j aime garder les sons quand je fais des photos. Je n’ai encore jamais pu intégrer de l’audio proprement dans une galerie, mais un jour pourquoi pas…
Batterie Magsafe Apple: Parce que je n’aime pas laisser mon iPhone charger dans mon sac, j’ai cette batterie qui se clipse dessus magnétiquement, et je la recharge sur l’autre batterie quand elle est vide.
Peak Design Propad: Pour avoir un seul appareil en bandoulière, mais le second sous la main, ou quand je veux avoir mon enregistreur audio sur moi pour capter les sons qui m’entourent.
Brosse à dents/dentifrice/médicaments: Je prends soin de moi, mais parfois on a des petits bobos, donc j’ai toujours du doliprane et du nociceptol sur moi si les muscles commencent à tirer.
Plein de batteries: Petit défaut des Fuji, les batteries sont petites et il en faut beaucoup, je mets un élastique autour de celles qui sont chargées pour les repérer facilement.
Lunettes de soleil bleues: Je vous renvoie à ma présentation pour découvrir pourquoi j’aime tant les lunettes de soleil bleues (et les gants de conduite).
Chris Killip : Youth on wall, Jarrow Tyneside - 1976
Lorsque je choisis le photographe dont je souhaite vous parler, j’ai souvent tendance à aller chercher, parmi ses images, celle qui me parle le plus, celle que je pense être l’une des plus révélatrice de son œuvre et son regard, et aussi, celle que vous ne connaissez peut-être pas. Mais pas cette fois, pas avec Chris Killip, qui nous a quitté en octobre 2020, car à la nouvelle de son décès, le monde de la photographie a ressenti un profond désarroi. Or, c’est particulièrement sur la condition humaine son désarroi et son dénuement face à une société qui se délite que se portait le regard du photographe. C’est donc sur cette image emblématique et particulièrement émouvante de Chris Killip : Youth on wall, Jarrow Tyneside, 1976, que je vais poser mes mots pour vous emmener à la découverte de ce grand monsieur de la photographie qui n’a eu cesse de témoigner des maux de ceux laissés pour compte.
Une histoire presque ordinaire dans des circonstances qui s’avèreront l’être beaucoup moins. Chris Killip est né en 1946 sur l’île de Man, un petit bout de terre qui se situe entre l’Angleterre et l’Irlande, il va à l’école jusqu’à ses 16 ans, puis rejoint son père pour travailler avec lui dans l’hôtellerie. Le parcours classique d’un adolescent que rien ne destinait finalement à la photographie. Mais c’était là sans compter sur le souvenir prégnant d’une photo d’Henri Cartier-Bresson sur le Tour de France qu’il avait découverte dans Paris-Match. Il n’avait alors que 8 ans et avait été marqué par cette image qui montrait « un garçon en culotte courte, une bouteille dans chaque main, rue Mouffetard », il déclarera : « cette photo a changé ma vie... j'ai commencé comme photographe de plage, et le soir je shootais des couples sur la piste de danse des hôtels ». Nous sommes en 1964, Chris Killip est désormais photographe. Il va assister plusieurs photographes à Londres, tout en revenant régulièrement sur son île natale. Il y réalisera entre 1970 et 1973 sa première série : Isle of Man. Et c’est aussi à cette époque que tout ce qui avait semblé être un temps immuable, que ce soit sur son île, en Angleterre ou en Irlande, commença à véritablement changer de visage. L’aviation civile s’est développée et, en devenant plus accessible, de nouvelles destinations telles que l’Espagne ont supplanté l’attrait touristique qu’exerçait auparavant l’île de Man auprès des britanniques. Pendant ce temps aussi, les attentats dus aux conflits nord-irlandais s’intensifient. L’empire britannique poursuit son déclin amorcé à l’issue de la seconde guerre mondiale, avec la décolonisation, la suprématie naissante des deux superpuissances américaines et soviétiques, et en réaction la création de l’Europe. Cet enchainement d’évènements aura pour conséquence la désindustrialisation du pays, entrainant dans sa course le bouleversement des sociétés organisées autour de l’industrie et par elle, les déclassements, les drames sociaux... Chris Killip se trouve là, au centre de ce tournant économique dont les effets sont tout autant visibles sur le visage des villes agonisantes que sur celui de leurs populations.
L’esthétisme d’une photographie qui témoigne de façon réaliste et objective de ce qu’elle capture. Chris Killip se positionne dans la mouvance de la photographie pure (« straight photography »), il se reconnait dans le langage plastique et stylistique de Walker Evans, Bill Brandt, Robert Frank, August Sander, et il va y faire écho avec son propre travail. Loin du pictorialisme, la photographie pure se veut instantanée, sans manipulation, ce qui compte, au niveau de la forme c’est la netteté, la composition et le cadrage qui permettront, dans le rapport de lignes et dans l’équilibre des noirs et blancs de concentrer l’attention sur le sujet. Dans le fond, son objet est le plus souvent de l’ordre du social, de l’humain ou lorsqu’il s’agit de paysages, qu’ils soient naturels ou urbains alors c’est purement sur une restitution signifiante, voire poétique, de la géométrie et la lumière que se concentre le « straight photographer ». Ainsi, Chris Killip ne déroge pas à la règle, et produira tout au long de sa vie des images à la chambre photographique où la puissance des noirs et blancs sera équilibrée de riches nuances de gris, des prises de vues où tous les plans seront nets, servis par des cadrages et des compositions parfaitement maîtrisés, signifiants.
« C’est ce que je fais, l’histoire s’écrit après les faits, mais mes photographies par contre vous montrent ce qui s’est passé ». Chris Killip n’est pas un journaliste, il ne se contente pas de documenter, il est bien plus qu’un témoin. Le photographe travaille de l’intérieur, il se familiarise avec les lieux, les gens, leur histoire et leurs histoires, partage leurs vies. Il travaille sur le long terme, passe des années auprès de ceux qu’il va photographier, il les appelle par leurs prénoms, il intègre une communauté, il devient un des leurs, et c’est alors, à partir de ce moment seulement qu’il va commencer à fixer ce qu’il sait d’eux sur les plaques de sa chambre photographique. Son regard n’est pas celui d’un étranger, et, il ne photographie pas des personnes qui lui sont étrangères. Avec cette confiance instaurée, ces liens qui se sont installés au fil du temps, la distance entre le photographe et son sujet s’en trouve réduite lui offrant une plus grande liberté d’approche. Chris Killip est dans l’intime, il est une figure familière qui immortalise ses semblables, tout en gardant une forme de réserve, de pudeur. Les personnes qu’il photographie ne posent pas, elles regardent rarement l’objectif, elles sont simplement là, saisies dans l’instant qu’elles vivent, au cœur de leur environnement, d’un paysage qui est aussi un élément de lecture essentiel, à la façon d’un second rôle, sans lequel l’histoire qui se tisse dans le cadre serait incomplète. Sa photographie est circonstancielle et empathique, c’est un moment arrêté certes, mais au cœur d’un récit qu’il connaît, l’image s’inscrit dans un continuum, elle montre ce qu’il s’est passé car elle en montre aussi et surtout les conséquences. Pour autant ses clichés ne tombent pas dans l’écueil du pathos, ils retranscrivent une tragédie mais sans emphase, et c’est là je crois que se situe aussi la plus belle part de respect et d’estime que le photographe puisse offrir autant à ces sujets qu’à son public. Il n’est pas question de manipuler et mettre en scène ce qu’il photographie pour ouvrir les vannes des bons sentiments et en faire un objet de commisération, d’apitoiement ou de complaisance. Il importe seulement d’offrir un moment de reconnaissance à ces êtres qui traversent une vie qui peut prendre des airs de tragédie, de les regarder pleinement et de voir leur entière dignité. Ils sont les témoignages des différents visages que peut prendre l’humanité lorsqu’elle est ballottée par des évènements qu’elle ne peut contrôler.
La dense gravité des hommes face à une existence qui se vide de sens. La photographie de Chris Killip montre ceux qui survivent tant bien que mal et tous les autres. Il y a ceux qui survivent, comme en résilience, qui subsistent en tirant ce qu’ils peuvent des stigmates d’une activité minière agonisante tels les « pêcheurs de charbon » ou « charbonniers de l’océan ». Ceux-là, quel que soit le temps, récoltent de leurs mains le charbon rejeté à la mer par des mines locales qui bientôt allaient ne plus exister. Il y a aussi les ouvriers, ils ont travaillé ensemble, avec les mêmes personnes, voisins ou amis, pendant des années et parfois depuis plusieurs générations, répétant les mêmes gestes, sur les mêmes lieux. Et puis les usines et les industries sidérurgiques ont cessé leurs activités parce que la main d’œuvre et le foncier sont encore moins chers ailleurs, les commandes n’arrivaient plus aux chantiers navals, tout ce qui faisait tourner l’économie s’est arrêté, là, chez eux, laissant l’immense majorité de ces hommes et ces femmes qui se rendaient au travail chaque jour, sans emploi, sans revenus, sans reconnaissance sociale, comme exclus de la société, et absolument démunis. La plénitude, parfois rude de leur travail, a cédé sa place au vide qu’engendre la perte d’emploi, et tous les maux qui l’accompagne. Que nous reste t-il lorsque tout ce que l’on a connu quotidiennement et qui nous faisait vivre disparaît ? Que reste t-il de nous ? Il y a dans les images de Chris Killip un étrange équilibre où la présence des hommes interroge le vide qui les entoure, un vide qui flotte dans l’air, comme une menace, celle de les atteindre dans leur âme et leur chair. Ils sont démunis mais ils existent, ils sont réels, authentiques, leurs regards et leurs postures, face à l’inanité, attestent au contraire d’une véritable présence.
Le corps d’un très jeune homme, recroquevillé sur un muret de briques jusqu’à presque s’y confondre. On y voit ses membres en tension, aussi rudes et saillants que les pierres sur lequel il se niche. L’image est une construction d’angles, ceux des arêtes des briques, ceux du corps plié du jeune homme, ceux de ses coudes et ceux de ses genoux. La composition elle-même repose sur un rectangle dessiné par le muret et le pilier contre lequel est adossé l’adolescent, au point qu’on a l’impression que lui-même prend cette forme. Le regard est enfermé dans un ensemble de rectangles qui viennent organiser l’image, comme une mise en abîme façonnée par la géométrie d’un jeu de cadres se succédant les uns aux autres. Il y a d’abord celui du cadrage, du format de la photographie, puis celui du pilier qui ferme l’image à gauche et son muret qui la ferme en bas. Au centre il y a celui du corps du jeune homme, ramassé au point qu’il semblerait pouvoir tenir dans une boîte. Et enfin, en arrière-plan, le rectangle d’un bout de mur lui-même encadré sur sa gauche par un autre pilier et fermé en haut par une fenêtre. Chacun de ces rectangles résonne comme un enfermement, il n’y a pas d’issue dans cette image, pas plus pour le regard que pour le garçon, coincé là avec tout le poids de la peine qui l’opprime. Et puis il y a les membres de l’adolescent, ses bras et ses jambes, composés d’angles et d’obliques réunis au cœur de l’image qui pourraient peut-être briser la rigueur des rectangles, si le contexte était autre. Car en ce qui l’en est de ces diagonales, bien qu’elles apportent une dynamique à l’image, pour autant elles ne créent pas de rupture quant à la perception que nous nous faisons de l’ensemble. Au contraire, et dans cette construction, elles se dessinent comme autant d’éléments d’intensification du sentiment qui se dégage de la photographie, elles disent l’émotion, elles figurent l’affliction ressentie par le garçon. Aucune d’elles ne permet de sortir du cadre, elles canalisent le regard et le mène inexorablement vers la tête du jeune homme elle-même encadrée par le triangle que dessine ses épaules, ses coudes et ses poings. Chacune de ces lignes exprime la douleur tant la tension qu’elles révèlent est palpable, jusqu’à la position presque fœtale de l’adolescent qui pourrait suggérer l’anxiété ou le repli et le besoin de protection qui l’accompagne. Ces lignes, qu’elles se matérialisent sur les plis des vêtements élimés de l’adolescent ou dans ses membres ramenés sur eux-mêmes, participent toutes à indiquer la désolation, l’usure, la misère. Chris Killip racontera plus tard que cette photographie n'avait pas pour objet de devenir un symbole de rage et d’impuissance et qu’elle montre avant tout un jeune homme qui « porte sa veste du dimanche, car il n’en a pas d’autre, et il grelotte de froid, pas de colère… ». Pourtant, ce froid qui tétanise le jeune homme exprime à lui seul tout le dénuement et toute la misère de sa condition. Il est alors légitime de se demander comment il se peut qu’il n’ait qu’une seule veste pour se couvrir quel que soit le temps et les circonstances. Et, comment il se peut qu’il se soit retrouvé là, transi, ne trouvant d’autre refuge que des pierres pour s’abriter peut-être de la morsure de l’air.
Une photographie avec pour point d’orgue, un profil d’adolescent. C’est parce qu’elle est en noir et blanc et parce que les gris déclinés dans les différents plans de la scène se situent tous dans des valeurs très proches, que cette image peu contrastée dans l’ensemble révèle avec encore plus de force l’émotion qui y est véhiculée. Et c’est dans les points de lumières, les gris plus clairs du visage et des mains, que vient alors se loger le contraste de l’image et toute la détresse du garçon, condensée dans sa chair, marquée dans les plis tracés par la souffrance sur son visage. Sa tête, de profil, est à la fois lumière et désolation, et c’est là chose peu commune en sémantique que d’associer ainsi la clarté dans la forme à ce qui relève de l’ombre dans le fond. Usuellement, la lumière est associée au bonheur, à la liberté, la délivrance, mais Chris Killip, dans cette image, l’utilise de manière diamétralement opposée et parvient cependant à assoir plus encore son propos, affirmer plus intensément ce qu’il a vu lorsqu’il a photographié le jeune homme. Cette lumière qui révèle avec force la figure désespérée de l’adolescent déchire l’image, elle est au regard ce que le cri est à la voix. C’est au travers de ce visage que s’incarnent alors les tourments qu’éprouvent ceux qu’une économie vacillante aura laissé dans la nécessité. C’est un éclairage, une lumière aussi vive que le désespoir ressenti par l’adolescent, que Chris Killip pose sur une population dont le mode de vie aura été sacrifié, voué à disparaître à l’aune de la mondialisation.
Voir les photographies de Chris Killip :
http://www.artnet.fr/artistes/chris-killip/
https://artscouncilcollection.org.uk/explore/artist/killip-chris
Chris Killip raconte Chris Killip, vidéo en anglais :
Dans mon sac - Valentine de Villemeur
Lors de mes sorties photo, je prends le strict minimum afin de partir léger.
Mon but étant d’éviter d’attirer l’œil et de ne pas me faire remarquer.
Je viens d’acquérir un sac photo de la marque Billingham, qui est très pratique pour ranger tout mon matériel.
En plus il est résistant à l’eau et à Dublin, j’en aurais bien besoin !
Dedans se trouve mon fidèle Leica M6 que j’ai toujours avec moi, et de temps en temps lors de grandes balades photos, mon Leica M3.
J’ai eu la chance de trouver mon M6 sur Leboncoin, ou un collectionneur vendait ses appareils photo. J’ai reçu l’appareil complètement neuf, il y avait encore le plastique en dessous sur la plaque de fond (il est toujours là d’ailleurs !). Il n’avait jamais été utilisé avant moi, donc toutes les marques d’utilisations ce sont moi qui les ai faites, en y pensant c’est assez fou.
Ensuite se trouvent évidemment des pellicules couleur et noir et blanc, ainsi qu’une pochette en cuir pour mettre les pellicules dedans.
J’ai aussi un lightmeter que j’utilise lorsque la lumière est compliquée et le temps difficile. Ça m’aide à bien régler mon appareil pour ne pas rater une photo.
J’ai aussi un petit flash, achetés 3 sous mais super efficace qui me sert dans certaines situations pour mettre en avant un sujet.
Enfin, j’ai un petit notebook dans lequel j’écris un peu tout ce qui me passe par la tête, que ce soit une note sur des réglages d’une photo ou des idées et pensées sur des projets en cours et futurs.
Cela étant, j’ai plein d’autres appareils que j’utilise moins fréquemment pour certaines occasions comme un Leica 3, un yashica ML, une chambre photographique 4x5 et même une caméra super 8(mm) pour faire des petits films de mes voyages.
En finir avec le syndrome de l’imposteur
Soyons honnêtes, nombreux sont les photographes qui travaillent aujourd’hui sans avoir de formation formelle en photographie, mais l’accès à l’information dont nous bénéficions depuis près de 10 ans est sans commune mesure avec ce qui a existé précédemment, et la plupart des personnes qui complexent aujourd'hui en savent plus sur les différents aspects de la photographie que les pros d’il y a à peine 50 ans.
Et pourtant, cette absence de formation contribue à délégitimer beaucoup de photographes qui mériteraient d’avoir une bien meilleure estime d’eux-même et de leur travail. Entendons nous bien, je ne parle pas ici des influenceurs qui font passer un faible bagage technique pour une quelconque compétence. Je parle de ceux qui font de la photo pour la joie de créer une image, tout en continuant de se former et d'explorer les moyens d’exprimer ce qu’ils voient et ressentent à leur manière, sans forcément singer une technique plus ou moins connue.
Car il y a deux clefs pour vaincre le syndrome de l’imposteur: Comprendre où on se situe par rapport au reste du monde, et comprendre que la photographie n’est pas une destination, mais un chemin qui n’a pas réellement de fin.
“Le monde a été construit par des gens qui n’étaient pas meilleurs que nous.”
La première étape est de comprendre où on se situe par rapport au reste du monde.
Historiquement déjà, il est important de réaliser que nous avons accès, en une courte recherche sur Internet, à plus de conseils pertinents et d’informations sur la technique photographique que la plupart des grands photographes du siècle dernier n’en ont eu au cours de leur formation complète. Si vous aviez appris la photographie dans les années 70, vous auriez appris les bases techniques dans le mode d’emploi de l’appareil en quelques pages, et vous auriez du découvrir les mystères de la composition et de la construction d’une image par vous mêmes, en gardant en plus à l’esprit le long délai entre la prise de vue et le développement proprement dit de l’image à l'époque de l’argentique. On est loin des écrans qui nous permettent de visionner instantanément la photo que nous venons de prendre, voire de la partager dans les secondes qui suivent.
De même, l’appareil photo le plus bas de gamme aujourd'hui ferait rêver un Ansel Adams qui transportait une chambre de plusieurs kilos et exposait des plaques aux ISOs ridicules en comparaison de ce qu’on est capable d’atteindre maintenant. La technique photographique s’est démocratisée à tel point qu’un enfant des années 2020 est certainement plus susceptible de créer une belle image qu’un amateur éclairé du siècle dernier.
Si nous cessons de revenir au passé, il suffit de lire toutes ces instructions et de les mettre en pratique un minimum pour être, instantanément, dans les 10% du monde les plus compétents sur le sujet. La route vers les 5% est aussi courte, et seul le dernier 1% est réellement difficile d’accès pour le commun des mortels, si tant est qu’il ait un intérêt pour le commun des mortels, justement. D’un point de vue statistique, il faut peu de choses pour être relativement compétent dans un domaine à l’heure d’Internet, ce qui en soi cause un certain nombre de soucis vu le nombre "d’experts” en tout et n’importe quoi qui nous inondent de leurs avis, et d’influenceurs qui se contentent de vendre une connaissance superficielle bien emballée. Cependant, cette connaissance quelle qu’elle soit n’en reste pas moins vraie et, mise entre les bonnes mains, peut s’avérer être aussi une des clefs vers une évolution dans le bon sens. Car la vie n’est qu’une succession de statistiques, et en prenant bout à bout des décisions qui maximisent nos chances d’obtenir un bon résultat, on y arrive plutôt facilement (du moins tant qu’un algorithme ne vient pas nous compliquer intentionnellement la tâche pour nous pousser à maximiser nos chances en payant de la publicité, ce qui est une exploitation commerciale des statistiques en fait…).
La seconde étape est de comprendre que les raccourcis n’existent pas, et qu’apprendre la photographie est le projet d’une vie.
Déjà parce que contrairement à ce que l’on pourrait croire en suivant les modes lancées par les réseaux sociaux, il n’y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire de la photo, c’est un simple moyen de s’exprimer et nous avons tous un message différent et une manière différente de le faire passer. Que la photographie professionnelle obéisse à certains codes est inévitable, mais même dans ce cadre restreint, il existe suffisamment de marge pour donner à chacun la possibilité d’exprimer son coté singulier et de trouver son public.
Ensuite parce qu’une photographie dépend aussi de qui la regarde, et qu’il est fréquemment arrivé qu’un travail soit reconnu tard dans la vie d’un photographe, il suffit de prendre en exemple Saul Leiter ou Vivian Maier pour s’en rendre compte. Certains ont le talent de savoir se vendre rapidement et efficacement, d’autres ont besoin de temps pour se construire et l’histoire ne leur en tient pas rigueur.
La photographie est un art et comme tous les arts, elle n’a pas à se plier à des règles trop rigides. La priorité est de s’exprimer sans trop se demander ce que les gens vont penser, de garder à l’esprit qu’on ne peut pas plaire à tout le monde, et d’être fier de son travail. Et de ne pas oublier que ce qu’on perçoit comme de la perfection, c’est à dire ce qui va convenir à tout le monde, est en général fade à mourir.
“Comparison is the thief of joy (La comparaison tue la joie)”
Un autre des défauts des réseaux sociaux est de montrer une image très partielle des succès des uns et des autres. Déjà parce qu’on ne voit que ce que les autres veulent bien nous montrer, à savoir un résultat qui ne laisse que rarement transparaitre les efforts qu’il a nécessité, ensuite parce que ce résultat est souvent un mensonge, au moins par omission. Comment nous vendre des raccourcis en admettant qu’on a soi-même du travailler dur pour obtenir un résultat?
Au contraire, il faut aujourd'hui être très performant, très vite, avec l’idée dans un coin de son esprit que tout le monde regarde, guette, épie. J’avais, dans un épisode du podcast avec Malo, une discussion sur le fait d’avoir grandi dans les années 80 où on avait le temps de consacrer toute son attention pendant un long moment à ce qui nous intéressait. A l'époque, on n’avait pas besoin de prouver immédiatement sa maîtrise, voire de la prouver tout court. Mais surtout, on pouvait prendre son temps pour se consacrer à un sujet car les sujets étaient infiniment moins nombreux, et surtout ne se chevauchaient pas les uns les autres en permanence en s’interrompant sans arrêt. Et, signe des temps, il n'était pas nécessaire d'avoir un avis arrêté sur tout, on n'était pas jugé immédiatement et sans recours sur cet avis ou son absence, et on pouvait discuter avec les gens qui avaient un avis différent sans risquer de froisser quelqu’un à chaque phrase. On pouvait s’exprimer librement. Et on n’avait, en retour, pas de crainte d’être jugé hâtivement par quelqu’un confortablement caché derrière un écran, qui n’a lui même rien prouvé d’autre que de sa capacité à critiquer ceux qui font, qui agissent, produisent, créent.
La photographie, comme beaucoup de formes d’art, prend du temps pour pouvoir être appréciée à sa juste valeur. Il est difficile de juger la valeur d’une image en temps réel, parce que seul le temps est capable de trier ce qui mérite de rentrer dans l’histoire, et même si au gré du temps le débat fait régulièrement rage entre ceux qui pensent que l’artiste fait la photo et ceux qui estiment que le sujet est présent et que l’artiste n’est là que pour le capturer mécaniquement, il n’en reste pas moins que c’est plus souvent l’image que les paramètres de sa réalisation qui reste dans l’histoire. Dès lors, faire une photo pour faire une photo ne devrait déjà plus présenter grand intérêt, et la seule question à se poser serait “pourquoi fais-je cette photo?”. Donc, plutôt que de juger le nombre de likes qu’elle est capable d’obtenir sur les deux jours de durée de vie qu’elle aura sur Instagram, il vaut peut-être mieux observer l’impact qu’elle aura sur les gens qui la regardent, et prendre le temps de la regarder vivre loin de notre contrôle, sur le temps long. Il sera toujours temps de la revoir dans quelques années, si elle est encore là c’est déjà bon signe.
Au delà d’être meilleur, vous pouvez déjà facilement être différent. En commençant par ne pas regarder les modes en cours sur les réseaux sociaux et en diversifiant vos sources d’information et d'éducation pour ne pas avoir les mêmes que tout le monde. Avez vous déjà lu un vrai beau livre photo? Un qu’il faut acheter et dont le savoir se mérite. Avez vous déjà étudié le travail d’un photographe qui au premier abord ne vous inspire pas particulièrement? Vous pourriez bien y trouver une petite pièce de puzzle qui influencera durablement votre façon de voir le monde, ou plus modestement votre façon de travailler. Avez-vous déjà contacté un photographe dont le travail vous plait pour engager une discussion avec lui? Vous seriez surpris de la disponibilité même des plus grands. Et le simple fait d’avoir des sources d’informations différentes de la masse des autres photographes suffira à vous en différencier.
Vous pouvez enfin cultiver votre différence en vous appuyant sur votre propre vie. Il n’est pas utile d’avoir une vie incroyable faite de voyages et de vols en hélicoptère pour faire un travail remarquable et parler de choses intéressantes. Vos photos, de la même manière qu’elles n’ont pas à obéir à des règles trop rigides, doivent résulter de vos expériences et exprimer votre vision des choses, quitte à froisser du monde, quitte à ne pas correspondre à l’opinion de la majorité. C’est ça, un point de vue, et c’est éminemment personnel.
Vous n’avez pas à souffrir du syndrome de l’imposteur, parce que vous n'avez pas à être un imposteur. Si vous aimez vraiment faire de la photo, pour la joie de créer une image plutôt que pour la reconnaissance qu’elle pourrait vous apporter, vous ne pouvez pas être un imposteur. Vous n’avez qu’à être vous-même, parler de ce qui vous inspire, faire comme vous le sentez, exprimer ce que vous souhaitez exprimer. Impossible d’être un imposteur quand on ne cherche qu’à être soi-même…
Weegee : “ Their First Murder " , 1941
Octobre 1941, le PM Daily publie cette photographie que Weegee a intitulée : “Their First Murder”.
Mais déjà à cette époque, le photographe quant à lui n’en est plus à son premier meurtre. Photographier le bouillonnement d’une ville au cœur de la nuit, ses fêtes, galas et autres divertissements, mais aussi et surtout les drames qui y surgissent, des accidents de voitures aux scènes de crimes en passant par les incendies, c’est là son fond de commerce, sa vie, son œuvre. C’est le regard qu’il a porté sur ces scènes qui a fait de lui un photographe unique et qui a fait de ses images une référence photographique dépassant de loin tout ce que l’on pouvait attendre du photojournalisme en ces temps, à tel point que ses photographies ont été exposées, de son vivant, au MOMA.
Weegee, en voilà un drôle de nom. Sans la photographie il n’y aurait eu qu’Arthur (Ascher) Fellig. Mais c’est parce que l’homme n’était pas commun, ni dans la trajectoire qu’il a empruntée, ni dans sa façon d’opérer, que la figure de Weegee est née. Issu d’une famille juive d’origine Ukrainienne, il a rejoint son père, rabbin, avec sa mère et ses trois frères aux Etats-Unis dans sa petite enfance. Très tôt, il a rejeté le strict judaïsme prêché par son père, et, a décidé de suivre son instinct, de donner chair à son rêve américain. Il y a deux histoires derrière le nom de Weegee celle que ses pairs rapportent, et celle plus fabuleuse que le photographe lui-même aimait raconter. Cependant l’une comme l’autre, témoignent de son histoire, sa vérité, et en quoi Arthur Fellig a embrassé son destin, l’a façonné jusqu’à devenir l’incroyable personnage qu’il était, Weegee The Famous. Il faut savoir que sa passion pour la photographie s’est révélée à lui très tôt, lorsqu’il avait été photographié au ferrotype dans la rue, il devait avoir entre 13 et 14 ans. A cette époque il avait déjà quitté l’école pour aider financièrement sa famille, et il enchaînait les petits boulots. Mais, ce portrait au ferrotype a été son déclencheur, son révélateur, Weegee était photographe, il le savait, il ira jusqu’à dire plus tard : « Je pense que j'étais ce qu'on pourrait appeler un photographe né, avec l'hypo dans le sang." (Hypo : les produits chimiques utilisés dans la chambre noire). C’est alors que le jeune Arthur achète un appareil photo et un poney sur lequel il fait poser les enfants qu’il photographie pour vendre les tirages aux parents. Il se fera aussi embaucher par différentes compagnies d’assurance ayant besoin d’images pour leurs catalogues. La première explication à son surnom vient de son parcours et en particulier de son expérience au sein de Acme News Pictures où il s’était fait remarquer par son habileté à pouvoir développer des tirages en toutes circonstances et situations (dans une rame de métro par exemple), au point que ses collaborateurs l’avaient rebaptisé Mr Squeegee. L’autre version de la naissance du nom de Weegee vient de son extraordinaire talent à se trouver exactement là où se déroulait l’action et bien souvent avant tout le monde. A tel point qu’on lui a prêté des dons médiumniques par lesquels il aurait été capable de deviner ce qui allait se passer et où. Ainsi, l’idée que l’homme était tel une planche de Ouija est née. Le photographe s’amusait à laisser croire qu’il avait de tels dons, voir même encourageait cette légende, et c’est ainsi que Ouija serait devenu Weegee.
Les embrasements de la cité résonnant dans une cloche, ses tressaillements dans des ondes radios. Voilà comment Weegee parvenait à toujours se trouver au cœur de l’action. L’homme, déterminé, débrouillard et inventif, avait conçu son propre système d’alertes lui conférant une indéniable longueur d’avance sur ses confrères. Cette réactivité a participé de façon incontestable à faire de lui le chasseur d’image le plus prolifique de sa génération. Weegee s’est créé son emploi, et avant même d’avoir da carte de presse, il s’est positionné comme photographe indépendant. A ses débuts, et pour trouver ses sujets, il avait relié les alarmes des pompiers à une cloche qu’il avait installée dans sa chambre. Il se rendait aussi dans les postes de police de New York et de Manhattan en particulier. Là, à l’affût des messages qui arrivaient sur les transcripteurs du commissariat, il ne lui restait plus qu’à choisir l’histoire qui l’intéressait plus particulièrement avant de foncer sur les scènes de crimes. Mais cela ne lui suffisait pas, il avait quand même le sentiment de ne pas arriver assez vite sur les lieux. Son tour de force a été d’acheter un Coupé Chevy 1938 dont il transforma le coffre en laboratoire photo, et, d’obtenir de la police que la radio de sa voiture soit branchée sur les mêmes ondes, lui conférant cette fois l’avantage de ne plus jamais arriver trop tard. Sa Chevy est devenu son studio, son « photomobile », avec dans le coffre tout son matériel, des pellicules aux flashs, plusieurs boîtiers, sa machine à écrire, des vêtements pour toutes circonstances et même des déguisements, de quoi se nourrir et bien sûr ses cigares !
Weegee the famous une revendication, une signature. Aujourd’hui, il est un fait acquis que les photographes possèdent des droits : « perpétuels, inaliénables, imprescriptibles, insaisissables, absolus » sur leurs créations, leurs œuvres. Et pourtant ce droit subit encore de nombreuses entorses. C’est une lutte constante que de faire reconnaître, et surtout faire valoir ces droits par nombre de supports qui choisissent d’utiliser le travail des photographes sans rémunération, ni même autorisation... Mais le droit est dorénavant du côté des photographes, ce qui n’a pas toujours été le cas. Pour avoir été spolié de ses droits durant tout le début de sa carrière Weegee a rapidement pris conscience de cette aberration, et est certainement l’un des premiers à avoir combattu pour la reconnaissance de sa propriété intellectuelle. Avant d’être indépendant, Weegee avait été mandaté par Acme News Pictures afin de constituer une photothèque destinée à la presse quotidienne, mais ses images une fois livrées ne lui appartenaient plus, elles étaient devenues la propriété d’Acme. Le photographe au caractère bien trempé, et conscient de sa valeur autant que de la valeur de son travail, n’allait pas accepter plus longtemps que ses photos soient publiées sans sa signature, sans cette reconnaissance à laquelle il aspirait et dont il savait qu’elle devait lui revenir. Ainsi, plus tard lorsqu’il commença à vendre ses photographies au World-Telegram, ce fût cette fois selon ses conditions : obtenir son crédit photo avec la publication de son image. Et pour s’assurer que plus jamais aucun journal ne s’autoriserait à ne pas le créditer, là encore, Weegee à été aussi inventif qu’astucieux en trouvant une solution aussi simple qu’efficace pour régler le problème. Il a fait réaliser un tampon sur lequel était inscrit en lettres capitales : « Crédit photo by Weegee the Famous » afin d’estampiller le dos de ses tirages de son nom. Cette signature a été déclinée en diverses versions au cours des années, parfois indiquant aussi son adresse. Une autre des idées visionnaire du photographe a été de commencer à légender lui-même ses images, et il s’est donc tout simplement doté d’une machine à écrire. Ainsi, une fois la photo prise, le photographe la développait immédiatement dans le coffre de sa voiture, la tamponnait de son crédit photo, et dans la lancée, l’insérait dans sa machine à écrire pour inscrire sans plus attendre sa légende : « Ce que je vois et ressens profondément, je le photographie, puis j'écris ce que j'ai remarqué et ressenti ». Ainsi, il photographiait essentiellement la nuit, développait et signait son travail avant que le jour ne se lève, pour, à l’aube, se rendre dans les journaux, et y vendre ses clichés marqués de son nom et de ses légendes, afin qu’ils soient publiés dès la première édition du matin.
Mettre la nuit au grand jour, faire la lumière sur l’obscurité. Tout semble plus dramatique la nuit, plus mystérieux, intense, et c’est peut-être cela qui opérait sur Weegee une telle fascination qu’il ne pouvait s’en lasser. Il aimait la nuit, ce moment où la rue devient le théâtre de scènes de crimes, de débauche et d’incidents en tous genres, où les masques tombent révélant les gens, qu’il aimait, dans toute leur humanité. Et puis la nuit, ce qui est au loin disparait, englouti dans le noir, seul ce qui est dans la lumière reste visible. L’obscurité était donc un précieux atout pour Weegee car après tout, le métier de photographe, n’est-il pas celui d’écrire avec la lumière, de dévoiler par la lumière. Et, la lumière de Weegee, puissante, précise c’était son flash-gun. A coup d’éclairs, il ne révélait que ce qu’il visait, ni plus, ni moins, limitant la scène et l’image à ce qu’il illuminait un peu moins d’une seconde. Il n’y a pas plus efficace, voir radical, pour ne montrer que ce que l’on veut montrer, éclairer son sujet comme un acteur sous un projecteur, choisir et souligner les détails qui viendront soutenir le propos de l’image, tout en faisant disparaitre dans une noirceur absolue tout ce que l’on peut estimer comme superflu. Car c’est aussi cela la puissance du flash, plonger ce qu’il y autour dans un noir plus sombre encore que la nuit elle-même, une obscurité si dense que ce qui n’est pas dans le cercle de lumière est purement et simplement éclipsé, créant ainsi une atmosphère particulièrement dramatique, où l’ombre, souvent énigmatique, devient présence. Le photographe s’attachait à représenter ce qu’il considérait comme la réalité, et pour cela il estimait qu’il fallait l’exposer nue et dépouillée. C’est en ce sens que photographier la nuit, au flash présentait pour lui les conditions idéales de prises de vues. La réalité dans les images de Weegee, c’est ce qui est dans la lumière se détachant très distinctement de l’arrière-plan, assombri. Pour autant, le noir de ses photographies n’est pas anodin, il n’est pas la fin ou la limite de l’image et du discours, sa présence est telle que l’on en vient à se demander ce qu’il s’y cache. Weegee excellait dans cette technique, et c’est en cela que ses photographies sont non seulement incroyablement efficaces, autant que parfaitement reconnaissables entre mille. Les images de Weegee c’est du noir et blanc pur et dur, brutal, donnant à ses sujets une place centrale tant ils sont éclairés, quand le reste disparaît puisqu’occulté par opposition à la lumière en un contraste extrême. On ne voit qu’eux, et quelques autres éléments, précisément choisis, qui viennent s’inscrire là comme autant d’indices d’une enquête à mener. Weegee est vif, malicieux, il saisit tout du drame de l’instant autant que l’ironie qui s’y joue parfois, et il n’hésite pas à intégrer des détails dans ces photographies comme autant de traits d’esprits. Ainsi cette photographie du corps d’un automobiliste ayant périt dans une collusion avec un pilier en feu, où il prendra soin d’intégrer dans le cadre, l’enseigne de cinéma qui se trouvait là et où était inscrit « Joy of living » (Joie de vivre)... C’est aussi en cela que s’est démarquée l’œuvre de Weegee, une vérité crue, souvent teintée d’impertinence et pourtant toujours empreinte d’une forme de tendresse. Comme s’il voyait l’ironie de la vie au-delà de la tragédie, ou peut-être son humour lui rendait la violence de tout cela plus supportable, ou encore était-ce là une forme d’acceptation de notre condition, de notre humanité ? Toujours est-il qu’à ma connaissance et dans l’histoire du photojournalisme, aucun autre photographe ne s’est aventuré à user de l’humour comme élément de lecture dans des images qui révèlent des scènes à l’issue fatale.
New York s’incarnant en Weegee, sa ville comme une seconde peau. Weegee a tout photographié, plus exactement tout le monde, des plus modestes aux plus privilégiés, et il en a immortalisé toutes leurs facettes. Que ce soit dans le désespoir ou l’arrogance, la vanité, la futilité, ou le désir, les hommes et les femmes qu’il a photographiés forment à eux tous un véritable portrait sociologique et psychologique de New York, où personne n’aura été épargné. La relation du photographe à sa ville et ses habitants, est celle d’un couple fusionnel, où l’un en vient à se confondre avec l’autre, Weegee est New York, et New York est Weegee. C’est une vision frontale, intime et impudique, presque charnelle, aussi tendre qu’houleuse et souvent sarcastique que le photographe pose sur sa ville. Il semble inventorier l’effervescence de ses rues comme on étudierait des manifestations de la psyché humaine, il s’amuse de ses débauches, sonde ses tribulations. Il le fait avec une acuité si troublante qu’on ne peut l’expliquer que par une incroyable sensibilité et l’on pourrait en venir à se demander si Weegee ne se retrouvait pas lui-même dans cette profusion de portraits. Ainsi, New York ville de contrastes, haut-lieu du rêve américain où rien n’est impossible, a rendu possible l’existence même du photographe. En embrassant la cité, de son macadam à ses gratte-ciels, il s’est de la même façon hissé du statut de modeste immigrant des quartiers pauvres à celui de star de la photographie, à la fois témoin et acteur, Arthur Fellig est devenu Weegee The Famous !
A la vie, à la mort, des mots qui sonnent comme un serment, comme une déclaration de Weegee à sa ville, ses habitants, la photographie. Des mots qui résument l’œuvre du photographe, dans lesquels on retrouve l’ensemble des sujets qu’il a exploré et figé à coups de flash. C’est précisément parce que la vie et la mort sont les deux faces d’une même pièce que Weegee traitait de l’une et de l’autre indistinctement, et que j’ai choisi cette photographie. Car ici, en un ingénieux choix de point de vue, la vie et la mort se trouvent réunies sur une seule face, celle d’un tirage argentique. Montrer la mort du point de vue des vivants, est tout autant précurseur qu’unique, et témoigne assez bien selon moi du regard de Weegee sur le monde, de son intelligence et son habileté à exposer la nature humaine autant que sa condition. « Their first murder » (leur premier meurtre) présente cette originalité que la photographie donne à voir une scène de crime sans cadavre. Lorsqu’elle a été publiée par le PM Daily, 9 octobre 1941, l’image était accompagnée de l’article suivant : "Des écoliers de Brooklyn voient un joueur assassiné dans la rue. Les élèves quittaient le P.S. 143, [6th Ave. & Roebling St.] dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn, à 15h15 hier lorsque Peter Mancuso, 22 ans, décrit par la police comme un petit joueur, s'est arrêté dans une Ford 1931 à un feu rouge à un bloc de l'école. Un tireur s'est approché de la voiture, a tiré deux fois et s'est enfui à travers la foule d'enfants. Mancuso, touché à la tête et au cœur, a lutté jusqu'à la portière et s'est effondré mort sur le trottoir. Ci-dessus, certains des spectateurs. La femme âgée est la tante de Mancuso, qui vit dans le quartier, et le garçon qui tire les cheveux de la fille devant lui est son fils, qui se dépêche de s'éloigner d'elle. Voici ce qu'ils ont vu lorsqu'un prêtre, flanqué d'un médecin ambulancier et d'un détective, a prononcé les derniers sacrements de l'Église sur le corps." La photographie est en adéquation absolue avec son sujet, frontale et brutale elle nous montre une multitude de visages mêlés les uns aux autres, en une agitation palpable et chaotique. Et pourtant au cœur de ce tumulte, se dessinent deux lignes de construction particulièrement dynamiques positionnées en croix. L’intersection formée par le croisement des deux diagonales est légèrement décentrée vers la droite de l’image, accentuant l’effet de surprise et de panique de la scène, comme si le photographe n’avait lui-même pas eu le temps de bien cadrer et centrer son image, mais, ce serait là mal connaître Weegee dont l’œil et la technique sont aguerries par des années de pratique de la photographie dans des circonstances plus complexes les unes que les autres. Ainsi, la majorité des protagonistes présents se trouvent concentrés sur les deux tiers gauche du cadre, alignés sur une diagonale ascendante qui vient mettre en exergue le visage le plus saisissant d’entre tous à l’emplacement central de la croix : la petite fille au regard inquisiteur. Au-delà de la puissance formelle de la photographie dans la force et le rythme créés par sa composition et ces contrastes, c’est le point de vue abordé qui la rend magistrale.
Montrer la tragédie, l’exhiber sans en montrer son objet, la rendre vivante et tangible, manifeste. La violence n’est plus dans les traces de sang s’échappant de blessures fatales, elle n’est plus dans la forme triste d’un corps auquel on a arraché la vie, Weegee l’a déplacée pour mieux nous la rapporter… Car après tout, que ressentons nous réellement face à l’image d’un cadavre dont nous ne connaissons pas l’identité, la dépouille d’une personne que nous ne connaissions pas ? En choisissant de photographier la foule, Weegee a trouvé le moyen de personnifier l’horreur, la douleur, et tout le panorama des émotions qui peuvent traverser des êtres confrontés à une telle scène, plus encore si la victime est un proche. Sartre disait : « l’enfer c’est les autres », certes, mais dans cette image, c’est dans les yeux des autres que Weegee nous donne un aperçu de l’enfer, celui des sentiments qui se bousculent dans les esprits comme tous ces enfants se bousculent les uns les autres. Et ces émotions que nous voyons sur leurs visages, nous pouvons les lire car nous les connaissons toutes, personnellement. Nous avons tous ressenti la douleur dans la perte d’un être proche, et face à l’injustice et la violence, n’avons-nous pas ressenti la colère, la peur, la fureur, le doute, ou l’incompréhension. Devant un évènement soudain et un attroupement n’avons-nous pas été curieux, ne sommes-nous pas tous un peu voyeurs parfois même ? Et puis de temps à autres il y a l’égo, indifférent à tout ce qui ne le concerne pas, que nous ne savons retenir, surtout face à la caméra, et qui nous fais agir de façon irrationnelle dans l’excitation du moment comme celle de se mettre en scène tout sourire devant l’objectif ? Chaque visage de cette photographie est l’une de ces émotions, vécue par eux et par nous. En déplaçant le point de vue, Weegee nous implique, nous atteint, il a personnifié l’horreur en une multiplicité d’émotions tangibles, dont nous ne pouvons-nous dérober, même face à une photographie !
Weegee : blog consacré au photographe: https://weegeeweegeeweegee.net/
Weegee : photographies: https://www.gettyimages.fr/photos/weegee
Weegee tells how :
Canada - Renaud Julian
Paris, 2012
Je suis casanier.
Je ne parle pas anglais.
Je n’ai jamais pris l’avion.
Et puis finalement, une rupture conventionnelle passe par là, une autre moins conventionnelle aussi d’ailleurs, puis la photo… la photo qui rend curieux, des lieux, des gens, de la lumière… la photo qui devient doucement mon métier et me donne envie de sortir de ma zone de confort, de partir, d’explorer… et franchement quoi de mieux pour explorer qu’un road trip à travers le continent nord-américain ?
J’ai donc pris mon sac à dos, mon PVT, et je me suis envolé pour Montréal, sans autre plan que de rejoindre San Diego un jour ou l’autre.
J’arrive en mai à Montréal, où l’hiver est bien fini et où le printemps érable et la révolution des casseroles agitent les jeunes et moins jeunes qui revendiquent et manifestent, parfois dans le plus simple appareil.
Après quelques mésaventures et surprises administratives, je deviens l’heureux propriétaire d’un Dodge Grand Caravan (renommé Prosper), qui m’accompagnera fidèlement pendant ce long road trip de 8 mois.
Il va être bien difficile de résumer ce road trip en quelques mots…
Je laisse le soin à mes photos de vous décrire ce que j’ai pu voir, et pour le reste…
Pour le reste je peux vous raconter les mouches noires du Saguenay et les moustiques de Banff qui m’auront laissé une forte impression… cutanée, l’attraction touristique relativement décevante qu’est Niagara Falls, les villes nord-américaines qui sont un paradis pour la street photo, le blast que j’ai vécu au Saskatchewan en contemplant ses plaines à perte de vue, l’Icefield Parkway et ses panoramas fabuleux sur les rocheuses canadiennes, les parkings de Wallmart qui m’ont vu camper partout sur le continent, les 6 mois de régime macdo, le passage de la frontière américaine à Port-Angeles et la fouille minutieuse de mon van par des agents hilares, la peur que j’ai eu de voir ma voiture se remplir de sable pendant une tempête dans la Death Valley, la contravention de 90$ pour mauvais parking à Venice Beach…
Et puis finalement, je vous parlerai de Lloyd, gérant d’un hostel à Thunder Bay, montreur d’ours en milieu quasi naturel, et pourvoyeur de gros câlins, et de sa femme Willa, qui se battait contre le cancer avec le sourire. Je vous raconterai ma rencontre avec Edward, qui m’a invité au resto à Malibu pour mon anniversaire. Je vous dirai le plaisir que j’ai eu à discuter avec Kerria à Vancouver, jouer au billard avec Simon à Jasper, prendre Eleanor en stop, regarder le débat Romney-Obama avec Father Tom à San Francisco… et tant d’autres.
Bien sûr il y eut aussi les moments de doutes, la solitude, les pannes, la santé qui vrille, le genou qui grince… mais putain c’était bon !
Ma voiture était ma maison, le parking du Wallmart était ma terrasse… et finalement, le continent entier était mon jardin.
Hors de ma zone de confort, j’ai finalement ressenti un peu de liberté, de plénitude, beaucoup de curiosité… et j’aurai pu vivre ça plus intensément si je ne m’étais pas un peu trop concentré sur les photos, mais ce sera l’objet d’un autre voyage et l’occasion de revenir !



























Retrouvez cet article et la suite du voyage à l’adresse suivante: https://renaudjulian.com/canada
Dans mon sac - Umbertha Richeux
Dans mon sac, ou dans mes sacS, il y a :
Un boitier Canon 5D mark III qui fait le job avec, dans son ventre, une batterie pleine d’énergie (en avoir une seconde, de secours, de batterie, sur soit pour le cas où) et, dans une de ses côtes, du 5D mark III, une carte SD 64 GB pour capturer nos images que j’aime appeler animalières tant je bouge devant l’objectif.
Un Objectif 16/35 canon EF 2, solide, résiste au froid, au chaud et aux chocs. Le canon 14 est excellent pour la prise de vue en URBEX. On peut alors dérober plus de décors autour du personnage. La focale fixe offre une qualité d'image remarquable. Cependant, le 16/35 a le mérite de nous éviter de devoir changer l'objectif pour une prise de vue que l'on souhaite plus rapprochée et ça, ce n'est pas négligeable, surtout en cas de stress.
Une télécommande rayée survivor, clic clic clic, tous les 3/6 secondes pour 30 clics quand on a compris le fonctionnement de la bête.
Un sac photo plein de poussière de France, de Belgique, d’Allemagne et d’Italie.
Un trépied qui danse temporairement d’une patte bancale, c’est plus rock.
Des robes, des jolies, des transparentes qu’on ne peut pas utiliser autrement comme pour faire ses courses au supermarché du coin sauf à se faire remarquer.
Un sac à robe sombre ou multicolore à défaut, attention, les lieux de friches ne sont pas tranquilles, la discrétion est donc de rigueur.
Des perruques arc en ciel, des longues, des courtes, des classiques et des rebelles.
Des chaussures à talon pour avoir l'air plus grande.
Un morceau de tulle rouge pour le cas où.
Une seule motivation, cultiver son jardin secret, s’évader quelques instants, s’échapper de la foule.
Création de poésie, à distiller, le cas échéant, comme des pétales de roses à qui y est sensible.
Communion d’esprit pour les « à fleurs de peau » au parfum de patchouli avec une note d’humour, de sensualité de l’âme, de simplicité et d’amour des trésors du cœur ♥️ par l’œil.
Voyager à travers l’espace et le temps au sein d'un univers parallèle.
James Nachtwey for Time : “opioid addiction America” n°37 – Alcalde, 4 février 2018
“Opioid addiction America” n°37 – Alcalde, 4 février 2018 est une photographie de James Nachtwey, issue d’une série commanditée par Time magazine. James Nachtwey est connu pour avoir photographié des zones de désolation, de crise, de conflits partout dans le monde, et en particulier dans les régions les plus enflammées et dévastées par la guerre. Jusqu’au jour où, en 2018, Time Magazine lui demande de parcourir son propre pays pour documenter les ravages de la toxicomanie.
Photographe de guerre, à quoi ça sert, d’être là, voir tout ça et ne pas intervenir ? Voilà des propos que l’on peut entendre parfois, et même s’il s’agit là d’enfoncer des portes ouvertes, je pense qu’y consacrer un paragraphe n’est pas vain. Je peux comprendre cette réaction, surtout face à des images particulièrement poignantes et tragiques, mais alors, si ces images provoquent ces réactions c’est qu’elles ont atteint leur objectif. Le rôle et le métier du photographe n’est pas celui d’un militaire, ou d’un politique. Il n’en a pas la vocation, ni les compétences, il n’a pas la même puissance d’action. Et s’il pouvait intervenir, ne serait-ce qu’une fois, cela changerait-il la donne ? Il en va de même pour chacun d’entre nous. S’il nous était possible d’intervenir, en serions-nous seulement capables face aux scènes qui se dérouleraient cette fois devant nos yeux plutôt que derrière nos écrans ou dans les pages d’un magazine ? Il faut cesser de penser que nous en aurions le courage, que dans l’action, nous saurions garder notre sang-froid et immédiatement savoir comment réagir... Le photographe de guerre agit, il va jusqu’à mettre sa propre vie en péril pour nous informer du péril des autres. Une autre de ses forces est justement de ne pas se laisser dépasser par ses propres émotions, de ne pas réagir, interférer, lorsqu’il est face aux horreurs qu’il doit cadrer, assez pour que son image, son témoignage, nous atteigne. Le postulat de Nachtwey, tel qu’il l’affirme est le suivant : « J’en ai été témoin, et ces images sont mon témoignage. Les événements que j’ai enregistrés ne doivent pas être oubliés et ne doivent pas se répéter. » James Nachtwey agit, il rend compte de ce qu’il voit, jusqu’à ce que nous ne puissions plus ignorer ces drames qui s’abattent sur d’autres que nous, jusqu’à ce que nous nous sentions tellement horrifiés que nous ne puissions plus regarder sans réagir. Il agit pour que nous réagissions, il est seul, nous sommes nombreux, et c’est sur cette puissance là que reposent ses objectifs et ses espoirs de changer les choses. Nachtwey est devenu photographe de guerre parce qu’il croit au pouvoir des images, leur pouvoir d’émouvoir, d’influencer, de dénoncer, il en a fait sa ligne de conduite, et jamais il n’en a dévié. Il s’est donné une mission, et pour la mener a bien il se sert des outils qu’il a à sa portée, sa photographie et la presse. Voici ses mots lors d’une interview pour Polka magazine : « Le but de mon travail est de documenter notre histoire contemporaine et de la montrer dans les médias de masse [...] afin qu’il soit vu par le public le plus large possible. Celui-ci doit voir et savoir. Plus la société est informée, plus il est possible de mettre la pression pour qu’une situation inacceptable change. Quand un sujet est dans l’œil des médias, cela peut aider à mettre plus de pression sur les politiques. Et parfois, ils peuvent se sentir obligés d’agir. C’est le rôle essentiel de la presse, selon moi. »
Aller au bout du monde et être toujours plus proche. C’est à cela que l’on reconnait les images de Nachtwey, comme si le photographe avait pris au mot Robert Capa lorsque ce dernier affirmait : « Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près ». Nachtwey va là où la vie est mise à mal, par les épidémies, les catastrophes naturelles, les crises sociales. Il va là où plus personne n’ose s’aventurer, des zones tellement instables que seuls quelques combattants les foulent encore de leurs pieds aux côtés de civils anéantis. On reconnait souvent les images de Nachtwey par la sensation de proximité qu’elles suscitent, le sentiment que l’objectif est littéralement au cœur de l’action, à presque toucher les personnes qui se trouvent là, des victimes pour le plus souvent, des résistants aussi, ou parfois leurs bourreaux. Quand j’observe les images de Nachtwey je vois une photographie de contact, une photographie où les tragédies du monde s’incarnent au travers des êtres qui les subissent, des femmes, des hommes, des enfants, dont le visage ne sera plus jamais anonyme. Nachtwey, supprime la distance qui existe entre nos mondes en paix, et ceux emportés par la tourmente. Ces drames, s’ils étaient jusqu’alors loin de nos vies et de nos regards spectateurs, deviennent alors en l’image d’une personne, une réalité qu’on ne pourra plus se contenter de simplement la survoler. Le cadre est trop serré, le sujet est trop proche, si proche qu’on a le sentiment qu’on pourrait, nous aussi le toucher, et presque le connaître. Le sujet est si proche, que l’émotion contenue dans l’image en déborderait presque tant elle est palpable, et tout paradoxal que cela puisse paraître, au point d’en occulter aussi la présence même du photographe. Et c’est bien là la volonté de Nachtwey, nous amener au plus près de ces gens dont il saisit et fige la douleur, le désespoir, ou la colère, nous faire ressentir ce qu’ils vivent, nous impliquer. Il dit : « Je veux que le premier impact, et de loin, l’impact le plus puissant, soit une réaction émotionnelle, intellectuelle et morale sur ce qui arrive à ces personnes. Je veux que ma présence soit transparente. [...] Je veux enregistrer l’histoire à travers le destin d’individus singuliers [...], je ne veux pas montrer la guerre en général, ni l’histoire avec un grand H, mais plutôt la tragédie d’un homme unique, ou d’une famille. »
Et si le bout du monde n’était pas si loin... Si d’autres drames, tout autant dévastateurs qu’un conflit armé, se déroulaient chez nous, sous nos yeux, si proches qu’on en ne mesurerait pas l’ampleur... Si une guerre non déclarée s’abattait sur nos voisins, faisant en moyenne 150 victimes fatales par jour, sans rencontrer de réelle opposition. Imaginons une guerre qui ne serait pas civile, ou, qui n’opposerait pas deux puissances portant des noms de pays ou de religion, un combat qui ne serait pas une crise sociale ou une lutte des classes, une guerre qui aurait un autre visage que celui de la majorité des conflits identifiés comme tels au cours de l’histoire, cette guerre là n’a pas de nom et pourtant elle existe. C’est une guerre presque unilatérale tant il est difficile d’identifier et de localiser les forces en action. Ses principaux acteurs sont d’une part des criminels qui tuent à distance sans utiliser de puissance de feu, et d’autre part, leurs victimes qui les enrichissent. Cette guerre là ne peut pas se régler sur un champ de bataille, ni par des traités de paix, son seul point commun avec tout ce qui définit une guerre est le nombre de ses victimes. Quant à ses objectifs, s’ils sont économiques, ils le sont pour quelques individus et pas au nom d’une nation ou d’une communauté. Je précise que j’entends bien que le plus souvent les guerres sont menées pour des raisons économiques plus ou moins avouées, et enrichissent en particulier une poignée de privilégiés, mais celles-ci visent généralement à conquérir des marchés, des accès aux matières premières et autres sources d’énergie dans le but de développer le commerce extérieur, avec pour conséquence de préserver ou créer des emplois, de contrôler et maintenir les prix des énergies en import, enfin elles offrent une position économique et géopolitique au pays qui en sortira victorieux. La guerre qui se joue ici ne poursuit aucun de ces objectifs, elle étend son voile noir partout sur le monde, elle enrichit des individus, des dirigeants de laboratoires pharmaceutiques aux chefs de cartels, sans autre préoccupation que leur propre fortune, elle tue sans discernement, et ses victimes sont ceux-là mêmes qui la nourrissent.
On lui a donné le nom de « crise des opioïdes ». Ou encore celui « d’épidémie des opioïdes » pourtant, la situation est bien plus grave que ce que laisse entendre le mot « crise », quant à la notion d’épidémie, c’est dans son sens par extension qu’il faut aller chercher une concordance, la consommation d’opioïdes ne relevant pas de la médecine par sa transmissibilité, ni d’un phénomène dont les causes seraient naturelles. Il y a là une guerre qui n’est pas ouvertement déclarée et qui n’a pas trouvé d’opposition suffisamment forte pour mettre un terme à ses ravages. C’est en constatant le nombre croissant et exponentiel des victimes d’overdose que la presse a décidé de s’emparer du sujet, et que, l’hebdomadaire Time a choisit James Nachtwey pour le documenter. Selon le magazine : « Rien qu'en 2016, près de 64 000 Américains sont morts d'une overdose de drogue, soit à peu près autant que les pertes de l'ensemble des guerres du Vietnam, d'Irak et d'Afghanistan réunies. Plus de 122 personnes meurent chaque jour à cause de seringues d'héroïne, de gélules de fentanyl, d'un excès d'oxycodone. » Et ces chiffres n’incluent pas les morts violentes engendrées par le trafic, que ce soit celles des dealers lourdement armés, à la défense de leurs territoires, ou celles des victimes de balles perdues lors de règlements de comptes.
Sur le front avec les victimes, les premiers secours, la police. Au-delà des chiffres il y a la réalité, celle du terrain, qui propose une autre vision sans laquelle il est difficile de prendre conscience des drames qui frappent chaque jour, des êtres et leurs familles. Pour le photographe, la seule façon de sortir de l’abstraction des statistiques a été de voir de ses propres yeux qui sont ces personnes derrière les chiffres, d’aller à la rencontre des femmes et des hommes qui consomment, de ceux qui répondent à leurs appels de détresse, et ceux qui tentent de les sauver dans l’urgence. Nachtwey, fidèle à lui-même, est allé au plus près, au contact, proche de tous et de chacun, avec cette volonté de cerner la situation pour pouvoir la cadrer. Il a photographié des scènes qui se répètent sans fin, partout et au quotidien, les injections, les secours, les arrestations... Il a mis des visages sur les maux qui ravagent la population américaine depuis maintenant une décennie.
Un homme au sol, une femme se penche au dessus de lui. De toutes les images du reportage réalisé par Nachtwey, celle-ci montre à la fois l’impuissance du pouvoir face au fléau qui s’est abattu sur la population qu’il a promis de servir et protéger, et la spirale dans laquelle les toxicomanes sont emportés vers une fin bien trop souvent inéluctable autant que fatale. L’image se détache de la série par la simplicité de sa composition, son dépouillement, elle semble presque minimaliste comparée aux autres. Nous ne sommes plus dans les rues des cités américaines, l’homme et la femme sont seuls au milieu d’un paysage désertique, seule la voiture de l’agent de police nous indique qu’une route passe par là, nous reliant à la civilisation. L’homme est au sol et semble inanimé, ses yeux fermés, la bouche sèche et entrouverte. Il est étendu sur le dos, les bras en croix. La femme, debout, est penchée au dessus de lui, elle le regarde d’un air grave, comme si elle cherchait encore quelque traces de vie sur ce visage qui ne fait plus face qu’au ciel. La composition de la photographie est d’une redoutable efficacité, les lignes qui la construise nous mènent inexorablement vers l’homme tout en nous enfermant dans l’image. La voiture, masse noire coupée par le bord du cadre à gauche nous dirige au cœur de la scène, nous emmenant dans les pas de l’agent de police qui a répondu à l’appel lui indiquant où trouver la victime. On découvre le corps comme elle l’a découvert en suivant le chemin qui se poursuit sous ses pieds. De la voiture dans le tiers supérieur gauche, en passant par les bras de l’homme, et jusqu’à la bordure du chemin qui file vers le tiers inférieur à droite de la photographie, se dessine une diagonale, ligne maitresse, à laquelle notre sens de lecture ne peut se soustraire. Puis la silhouette de la femme placée dans le tiers droit de l’image sur toute sa hauteur vient stopper notre regard pour le ramener vers l’homme. Elle est penchée en avant sur le corps dans une position qui forme presque un angle droit, ses jambes parallèles au bord de la photo ferment l’image à droite tandis que son buste, parallèle au sol finit de former le cadre qui se dessine autour de la victime. C’est là, dans la position du corps en travers du chemin, qu’est inscrite la dernière ligne de force de l’image, une diagonale partant du crâne de l’homme depuis le tiers inférieur gauche de la photographie et se poursuivant au-delà de ses pieds, vers le désert. La dynamique de l’image réside dans l’association de ces lignes qui, réunies, forment un triangle duquel on ne peut sortir, pas plus que l’homme qui gît là, n’a pu échapper aux douloureuses conséquences de sa dépendance. On a le sentiment que cette image nous parle et dit : pour lui, la route s’est arrêtée là, il est parti, seul, au milieu de nulle part. Le choix du noir et blanc renforce aussi la dramaturgie de l’image, nous plaçant en peu au-delà du réel induit par la couleur que l’on a l’habitude de voir dans la plupart des reportages, en particulier ceux des journaux télévisés. La couleur peut parfois desservir la puissance narrative du sujet simplement parce que nous voyons tout en couleur. Le noir et blanc nous sort de nos repères, de notre quotidien. Il permet aussi d’exacerber les contrastes, faisant par là-même ressortir les lignes, les rythmes, les masses, tous les éléments graphiques qui révèlent la construction d’une image, les tensions qui s’y exercent. Comme d’autres photographes et pour les mêmes raisons, Nachtwey privilégie très souvent le noir et blanc, pour lui : « Si on montre le sujet en noir et blanc, on diffuse l’essentiel de ce qu’il se passe, sans compétition avec la couleur. » Dans cette photographie dont le sujet est tragique, et parce qu’elle est parfaitement exposée, il se créé un riche dialogue entre des noirs profonds et une très large gamme de gris. La puissance des noirs en contraste est adoucie par la place donnée aux gris qui couvrent l’image dans son ensemble.
La scène est tragique, l’image est belle. Voilà un constat qui sonne comme un paradoxe, et il y a bien là quelque chose de dérangeant. Pourquoi voyons-nous de la beauté là où nous est montrée la désolation, comment une scène tragique comme celle que nous présente Nachtwey parvient malgré tout à nous toucher par son esthétisme ? Lorsque je me pose la question, me viennent immédiatement à l’esprit les œuvres d’artistes tels qu’Otto Dix ou George Grosz acteurs majeurs de l’Expressionisme allemand et de la Nouvelle objectivité. Je vois aussi des œuvres de Géricault, Delacroix ou encore Goya... Et je me rappelle que la pratique est courante, depuis toujours en art. On ne peut pas ignorer que la peinture n’a pas attendu la photographie pour montrer le désespoir, les souffrances et les horreurs qui traversent l’histoire de l’humanité et brisent les êtres. Toutes ces œuvres ont traversé le temps et nous marquent encore aujourd’hui tant par les sujets qu’elles abordent mais aussi et peut-être surtout par la qualité de leur facture, par les choix esthétiques des artistes qui les ont réalisées. Alors, faut-il que l’image soit belle pour que nous nous arrêtions et prêtions attention au sujet qu’elle traite ? Et aussi terrible que cela puisse paraitre, il semble que oui. Nachtwey va dans ce sens et propose une explication que je rejoins assez pour en faire ma conclusion : « Le but de mes photos n’est pas qu’elles soient belles. Je ne suis pas à la recherche de cette esthétique, mais je sais la remarquer. La réalité est que beauté et tragédie coexistent partout. Ce n’est pas moi qui l’ai inventé. Regardez ce qui se fait en art depuis toujours ! S’il y a des références à des icônes religieuses dans mes photos, c’est tout simplement parce que ces représentations sont elles-mêmes inspirées par la beauté de la vie. Nous devrions plutôt nous demander pourquoi nous avons cette perception de la beauté. C’est peut-être un mécanisme humain nécessaire pour faire face à la tragédie, afin de ne pas lui tourner le dos. »
James Nachtwey : http://www.jamesnachtwey.com/
James Nachtwey - The opioid diaries : https://time.com/james-nachtwey-opioid-addiction-america/
James Nachtwey - War Photographer par Christian Frey (en anglais) :
https://archive.org/details/wphoto
James Nachtwey - War Photographer par Christian Frey (sous-titré/location) :
https://fr.cinefile.ch/movie/21082-war-photographer?streaming#
Test Grand angles Fuji: 8-16mm f2.8 vs f10-24mm f4
L'été dernier, après une longue formation sur la photographie de mariage, je me suis décidé à changer d’approche concernant les photos de soirée. Jusque là, j’avais pris l’habitude de photographier les dancefloors entre le 16 et 23mm Fuji (donc équivalents 24 et 35mm), mais les photos que j’aime d’autres photographes sont quasi systématiquement prises à l’ultra grand-angle, et je me suis donc décidé à faire évoluer mon kit.
Fujifilm X-T3 + XF10-24mm f4 R OIS @11mm - 1/60s, f4.0, ISO 800
La focale me permet de capter beaucoup d’informations dans cette image, et de faire le ménage par la suite.
Fujifilm X-T3 + XF8-16mmf2.8 R LM WR @8.1mm - 1/60s, f2.8, ISO 800
Photo prise volontairement à 8mm pour voir les distorsion qui sont, effectivement très présentes même assez loin des bords de l’image.
Magie de ce blog, je peux désormais me faire prêter assez facilement du matériel difficile à trouver autour de moi, et si un de mes amis avait un 10-24mm f4 à me prêter, le 8-16 était un peu plus rare dans mon entourage, et j’ai eu la chance d'être en contact avec Fujifilm France à ce moment là qui a accepté de me le prêter une semaine où j’avais un peu de travail, des dancefloors et l’opportunité de tester les deux optiques côte à côte.
Voici donc le résultat de ce test, réalisé dans les conditions suivantes: J’ai eu le 10-24 environ 3 semaines avant d’avoir le 8-16 en mains, j’ai donc pu me familiariser avec les focales un petit moment avant de les mettre face à face, ce qui n'était pas du luxe vu que je n’avais jamais shooté une soirée aussi large auparavant. Le test est donc plutôt fair-play puisque je shootais à ce moment là comme je shoote depuis quelques mois que j’ai réalisé ce test, aucun objectif n’a donc été défavorisé par ma manière de faire.
Commençons par les caractéristiques de chaque objectif:
Le 10-24mm, comme son nom l’indique, est un zoom qui oscille entre 10 et 24mm et a une ouverture maximale de f4. La version que j’ai eu en test était l’ancienne, qui n’avait pas de résistance à l’humidité et à laquelle il manquait la bague d’ouverture avec les marquages. C’est a priori une optique conçue pour du paysage vu sa faible ouverture, qu’on pourrait croire davantage conçue pour un trépied et des poses longues, mais qui s’est montrée très capable et versatile dans toutes les situations auxquelles je l’ai exposée. Son poids plume de 410g, la stabilisation optique, et des dimensions très raisonnables compte tenu de sa focale, font qu’elle ne se fait pas trop sentir dans un sac ou à bout de bras, ce qui est important dans mon cas puisque je tiens un flash sur perche dans la main gauche et donc l’appareil de la seule main droite.
Le 8-16, de son coté, va aller de 8 à 16mm et a une ouverture maximale de f2.8. Il ouvre donc nettement plus grand, capte plus de choses à la focale la plus large, mais est plus serré au zoom maximal. Avantage à l’ouverture pour cette optique, qui ouvre à f2.8 et laisse donc entrer deux fois plus de lumière à ouverture maximale. Il est beaucoup plus encombrant que le 10-24, comme vous le verrez sur les photos, et pèse le double de son ainé à 805g sur la balance. Il se sent dans un sac photo et à bout de bras, avec 30% de poids en plus, bien qu’il présente d’autres avantages.
Pour faire mes images, j’ai utilisé la manière de faire qui est devenue mon habitude depuis quelques mois: un flash sur perche que je tiens dans ma main gauche, ce qui me permet de l’orienter facilement et de n'éclairer que ce qui m’intéresse dans l’image, ce qui a un grand intérêt dans une image très large, donc pouvant potentiellement comporter beaucoup (trop?) d’informations. Sur le flash, j’installe une grille qui limite la largeur de la zone éclairée, ainsi qu’un filtre 1/4 CTO. Dans la main droite, je tiens l’appareil photo avec un niveau de zoom défini à l’avance (généralement 12mm) pour tout ce qui est photo spontanée, que je fais évoluer quand on m’arrête pour faire une photo plus posée, ce qui arrive quand même fréquemment dans les évènements où je travaille.
Fujifilm X-T3 + XF10-24mm f4 R OIS @10mm - 1/60s, f4.0, ISO 800
S’il subsiste des distorsion à 10mm sur cette photo non recardée, elles sont beaucoup moins agressives que sur le 8-16 à 8mm où elles mangent l’image, alors que sur celle-ci l’action permet d’oublier le grand angle exagéré.
Fujifilm X-T3 + XF10-24mm f4 R OIS @10mm - 1/60s, f4.0, ISO 800
Sur les plans larges, le 10-24 capte beaucoup d’informations avec une distorsion modérée qui est au final rarement gênante.
Le 10-24 a comme atout principal sa légèreté, il est un peu plus lourd que les optiques fixes que j’utilise habituellement mais ça ne se sent pas sur une soirée, même longue. Le pare soleil est amovible, ce qui est une bonne nouvelle vu que c’est la première chose dont je me débarrasse en ouvrant la boite, et on peut mettre des filtres UV pour protéger le verre, ce qui est la première chose que j’ajoute en ouvrant la boite (le gain en encombrement et en rapidité de mise en place vaut largement les petits défauts optiques qu’on peut avoir de temps en temps, dont je me suis mis à jouer et qui sont devenus une de mes marques de fabrique par ailleurs). L’ouverture à F4 a été un des freins dans mes considérations d’achats de cette optique, mais à l’usage je suis rarement en dessous de f5.6 en photo de soirée et c’est donc finalement, dans mon cas du moins, très peu sensible. La qualité optique est bonne, même si en mettant côte à côte une photo prise à 24mm au 10-24 et la même photo prise au 23mm F1.4, il ne peut y avoir aucun doute sur quelle optique a fait quelle photo. Les photos à 10mm sont sensiblement déformées, ce qui m’a semblé être un problème au premier abord, mais j’ai fini par m’y faire et le gérer correctement.
Le 8-16 a comme atout principal son ouverture et sa qualité optique, un cran au dessus de son ainé. Et en paysage ou en architecture, je n’hésiterais pas à vous le recommander même s’il fait le double du prix du 10-24, tellement la qualité optique est incroyable, surtout pour un zoom. Mais pour du dancefloor, en particulier dans mon fonctionnement il a deux gros défauts: Premièrement, il est très lourd, et après quelques minutes à le tenir à bout de bras, même si je fais du sport et je suis capable de porter des poids assez lourds, je me suis régulièrement arrêté pour relaxer mon poignet qui était crispé par l’effort. Le second gros défaut de cette optique, c’est que le verre est bombé, avec un pare soleil inamovible, et l’impossibilité de mettre un filtre pour le protéger, ce qui peut se montrer problématique vers 2h du matin, quand tout le monde commence être bien alcoolisé et que des coups involontaires peuvent arriver sur le matériel. Le 8mm est inutilisable en photo de soirée tellement il déforme l’image et la rend difficile à exploiter, même après correction, n’apporte rien par rapport aux 10mm de son concurrent, et sur un évènement, le 16mm est trop large pour les quelques fois où on doit s’arrêter pour faire une photo posée.
Fujifilm X-T3 + XF8-16mmf2.8 R LM WR @8mm - 1/125, f2.8, ISO 3200
Le 8-16 brille particulièrement quand on veut faire des plans larges incluant beaucoup de decor, où il produit de très belles images aux lignes bien droites.
Fujifilm X-T3 + XF10-24mm f4 R OIS @10mm - 1/60s, f4.0, ISO 1600
Sur des plans plus larges, le 10-24 s’en sort très honorablement, même si je trouve la différence sensible avec son grand frère qui lui est très supérieur sur ce point. De même, l’ouverture maximale permet au 8-16 de gagner haut la main sur ce type d’images en configuration soirée. Mais ma priorité étant à l'évènement plutôt qu’à l’architecture, le 10-24 est largement suffisant pour mon usage.
Fujifilm X-T3 + XF8-16mmf2.8 R LM WR @8.1mm - 1/125s, f2.8, ISO 160
Le gros intérêt du 8-16 est de cadrer large et de recadrer, même fortement, après coup, pour s’assurer de capter toute la scène sans couper une main ou autre, mais le 10-24 s’acquitte aussi très bien de cette tâche
Fujifilm X-T3 + XF8-16mmf2.8 R LM WR @16mm - 1/125s, f3.2, ISO 160
A 16mm, on peut faire des portraits plus posés, mais au prix d’un recadrage conséquent dans le cas de cette photo.
Fujifilm X-T3 + XF8-16mmf2.8 R LM WR @8mm - 1/125s, f3.2, ISO 160
Une image qui illustre bien les fortes distorsion à 8mm, qui ne posent pas problème tant qu’on photographie des lignes mais sont peu flatteuses pour un portrait, même en mouvement.
Fujifilm X-T3 + XF10-24mm f4 R OIS @10mm - 1s, f4.0, ISO 160
Une distorsion nettement plus supportable sur cette version de l’image (non recadrée) avec le 10-24 à 10mm
Fujifilm X-T3 + XF10-24mm f4 R OIS @24mm - 1/125s, f4.0, ISO 1600
Quand on crée sa propre lumière, le 10-24mm fait parfaitement l’affaire sur ce genre de scènes où il pourrait rapidement se retrouver limité sans les flashes placés derrière les danseuses.
Fujifilm X-T3 + XF10-24mm f4 R OIS @10mm - 1/125s, f4.0, ISO 1600
Avec un flash derrière et un flash cobra sur l’appareil, on obtient des résultats tout à fait probants malgré l’ouverture maximale à f4 du 10-24mm
Ne nous méprenons pas, je détourne des optiques de l’usage pour lequel elles ont été conçues en les emmenant sur le dancefloor, le 8-16mm f2.8 est une optique superbe et si je faisais du paysage ou de l’architecture, je ne me poserais pas une seconde la question malgré son prix deux fois plus élevé que celui du 10-24. Mais dans mon contexte d’utilisation, j’ai besoin d’une optique légère, fiable, capable de prendre des coups, et l’ouverture à f4 qui m’a fait tant hésiter ne me gène au final pas du tout dans mon quotidien. Bonus que j’ai découvert après avoir acheté mon exemplaire du 10-24, il a été mis à jour récemment avec la résistance à l’humidité (que j’ai inauguré en shootant un évènement sous la pluie, donc ça sert) et des marquages sur la bague d’ouverture qui manquaient à la version précédente. La bague est un peu plus dure à tourner également, ce qui n’est pas un luxe quand on tient l’appareil d’une seule main.
En résumé, si vous cherchez une optique grand angle pour faire du dancefloor et que vous êtes chez Fuji, je vous recommande très largement le 10-24mm F4, il fait parfaitement le job et saura se faire oublier dans votre sac.
Diane Arbus : Lady Bartender at Home with Souvenir Dog, New Orleans, 1964
Cette photographie de Diane Arbus : « Lady Bartender at Home with Souvenir Dog » n’est pas de celles qui sortent en premier dans les résultats de recherche sur internet. Mais il n’en demeure pas moins qu’elle est tout à fait représentative du regard particulier de la photographe dans son travail de portraitiste. Diane Arbus est célèbre pour avoir initié une autre façon de pratiquer le portrait. Il y a toujours eu quelque chose de décalé dans son travail, que ce soit dans sa signature photographique ou dans les choix de ses sujets.
A une époque où l’Amérique toute entière affichait sa réussite, la grande majorité des images produites véhiculaient le modèle de société qui s’y était construit, richesse et abondance, intérieurs fonctionnels à souhait pour le confort de la ménagère moderne... L’esthétisme des habitations de banlieues fraichement sorties de terre, autant que celui des codes vestimentaires, et jusqu’à la musique diffusée en radio, correspondant en tous points à celui d’un modèle de société normalisé, célébrant la famille modèle d’une classe moyenne heureuse, épanouie, ayant réussi. Pour autant tous les américains ne rentraient pas dans ce moule. Artistes, marginaux, excentriques, quelles que soient les étiquettes, nombreux sont ceux dont l’existence ne s’accordait pas à ce modèle, que ce soit par manque de moyens, ou simplement par choix. Et c’est vers ceux-là que Diane Arbus a finalement choisi de diriger plus particulièrement son objectif, quelques années après avoir œuvré avec succès dans la photographie de mode et de publicité en compagnie de son mari Allan Arbus.
Diane Arbus a bâti sa carrière de photographe en sens inverse. En effet nombreux sont les photographes de mode ou de publicité qui ont fait leurs armes en commençant par capturer la rue et ses sujets, les personnes de leur entourage ou croisées dans la rue. Ajustant ce faisant leur technique et aiguisant leur regard. Diane Arbus, quant à elle, a débuté la photographie comme elle a débuté sa vie, issue d’une famille aisée, baignée dans un monde où les codes et conventions socio-esthétiques n’avaient rien en commun avec ce que pouvait vivre la grande majorité des américains ayant survécu à la grande dépression. Une éducation modèle, des études en école privée, faisant d’elle une jeune femme brillante et cultivée. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître c’est de cela dont elle souffrait et dont elle a cherché toute sa vie à se délivrer : « Je suis née en haut de l’échelle sociale, dans la bourgeoisie respectable, mais, depuis, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour dégringoler » disait-elle. Et sa carrière de photographe n’aura pas échappé à cette fuite en avant. C’est en épousant Allan Arbus qu’elle débuta avec lui la photographie de publicité et de mode, avec pour premier client la famille de Diane Arbus elle-même, propriétaire d’un grand magasin de luxe de la 5ème avenue. Ont suivi les plus grands magazines de mode comme le fabuleux Vogue du groupe Conde-Nast par exemple. Nourrie de l’esthétisme des magazines, et des photographes stars qui illustraient leurs pages tels que Richard Avedon, Diane Arbus ne pouvait cependant s’en satisfaire pleinement même si cela a probablement participé à construire son sens du cadrage, du travail de la lumière. Sa culture photographique ne se limitant pas aux images sophistiquées de la publicité et de la presse féminine, Diane Arbus s’inspirera aussi de photographes tels que Dorothea Lange, August Sander, Robert Frank, Brassai, Walker Evans ou encore Weegee avec son travail au flash et bien sûr Lisette Model qui sera sa professeure et amie. Ne lui restait plus qu’à trouver l’objet de sa photographie qui finira d’assoir sa signature.
De la mode à la rue, délivrance et révélation. Alors qu’elle est d’ores et déjà reconnue dans la photo commerciale et la presse féminine, Diane Arbus se voit proposer par Alexey Brodovich, alors directeur artistique du célèbre Harper’s Bazaar, de sortir des studios et d’aller dans la rue. C’est le déclic pour la photographe, elle va y trouver une nouvelle liberté, celle de construire son univers, d’aller à la conquête d’un monde dont elle a toujours eu le sentiment qu’il lui était inconnu, ou inaccessible, et pouvoir combler ce qu’elle ressentait comme un vide la dévorant : « Une des choses dont j'ai souffert en tant qu'enfant, c'est que je n'ai jamais ressenti l'adversité. J'étais confortée dans un sentiment d'irréalité que je ne pouvais ressentir que comme une irréalité. Et le sentiment d'être immunisée était, aussi ridicule que cela puisse paraître, douloureux. C'était comme si, pendant longtemps, je n'avais pas hérité de mon propre royaume. Le monde me semblait appartenir au monde. Je pouvais apprendre des choses, mais elles ne semblaient jamais être ma propre expérience ». Lucide et sensible, Diane Arbus pouvait enfin sortir du cadre, de son enfance et de sa jeunesse dorée qu’elle avait très tôt identifié comme une cage, un mur entre elle et la vie. Elle allait pouvoir exister, commencer à prendre possession d’elle-même, ses envies, ses choix, ses inclinations et sympathies.
Comme des aimants, les opposés s’attirent. Et les sympathies de Diane Arbus sont allées immanquablement vers tous ceux qui se trouvaient au-delà des murs à l’intérieur desquels elle avait évolué, où, comme dans un musée qui ne présenterait qu’une œuvre normée et conventionnelle, son regard n’avait jamais trouvé de quoi satisfaire son besoin d’appréhender la réalité toute entière, celle de tout ce qui échappait à la norme. Une réalité qui était peut-être aussi la sienne, dans les fractures qu’elle ressentait. C’est de New York au New Jersey, et dans tous les recoins de l’Amérique que la photographe va explorer, qu’elle pourra enfin voir jusqu’à toucher l’envers du décor, autant qu’elle aura été touchée par chacun de ses modèles, passants, artistes de cabaret, de cirque, monstres étranges des fêtes foraines, marginaux, aliénés, nudistes... A ce titre, on dit souvent de Diane Arbus qu’elle était la photographe des parias, pourtant à mes yeux il y a là quelque chose de réducteur dans la lecture de son travail, qui pourrait sous-tendre qu’elle aurait cherché à se marginaliser, ou se rebeller contre son milieu, ou pire encore verser dans le sensationnel pour marquer les esprits. Et cela peut en conséquence réduire aussi les pistes d’interprétations possibles de sa quête qui je pense est bien plus subtile, profonde et voir même instinctive que tout cela. Diane Arbus n’a pas photographié que des gens extra-ordinaires. Selon moi, elle a juste photographié ceux qui n’étaient pas du monde auquel elle appartenait, ceux qui n’entraient pas dans les normes d’une certaine société ou classe sociale, je crois qu’elle est tout simplement allée à la rencontre d’autres normalités, à la recherche d’un grand tout où chacun pourrait incarner sa propre norme.
Un chignon qui ressemble à une figurine de caniche à moins que ce ne soit l’inverse. Ou peut-être un chignon comme une couronne, comme une réponse au tableau en fil de fer, représentant la carte du roi de cœur, suspendu au mur. Voilà le portrait d’une serveuse, une barmaid à son domicile. Ni monstre de foire, ni artiste, ni aliénée, juste une jeune femme d’une autre classe sociale que celle dont est originaire Diane Arbus, et dont la plus grande originalité demeure dans l’extravagance de sa coiffure, soulignée ici par la figurine décorative d’un caniche en tissu qui vient lui faire écho. Alors même que les années 60 représentent l’apogée du chignon crêpé à souhait, celui qu’arbore la jeune femme flirte manifestement avec la démesure. Ses cheveux blonds peroxydés sont maîtrisés, structurés, sculptés et portés hauts sur la tête tels une coiffe d’apparat. Et c’est alors dans l’exubérance de sa mise en scène capillaire que la jeune femme « normale » devient un personnage remarquable, hors normes, se jouant des codes établis. Son port de tête est altier, elle pose, assise dans un fauteuil aux allures de trône, tandis que la position de ses jambes va à l’encontre des attendus en termes de convenances, si elle avait été issue de la noblesse ou de la haute société. Elle se veut élégante, en témoigne sa main droite avec son petit doigt levé, et son port de tête, autant qu’elle semble sûre d’elle tant son regard est franc et direct. Tout semble se répondre et s’équilibrer dans cette photographie de Diane Arbus. De la force, comme une affirmation, dégagée par la coiffure et l’attitude de la jeune femme à laquelle vient répondre la figurine kitsch du caniche, dont la présence pourrait toutefois et à contrario suggérer une forme de douceur, de besoin d’affection. L’idée qu’elle porte sa coiffure comme une couronne est appuyée par la présence discrète derrière elle de la décoration en fil de fer représentant la carte du roi de cœur. Dans la forme de l’image aussi, nombreux sont les éléments en correspondance plastique. Les finitions en spirale du meuble métallique, sur lequel trône le caniche, renvoient aux boucles placées de part et d’autre de la coiffure. Le sol en damier, comme un plateau de jeu d’échecs où la jeune femme serait reine, est constitué de grands carreaux de granito à l’aspect tout aussi graphique et rythmé que le gilet imprimé de motifs léopard de sa tenue.
Quand une photographie ne peut exister qu’en noir et blanc. Difficile d’imaginer cette photographie de Diane Arbus en couleur, tant elle tire sa force et son sens de ses contrastes. Les gris, bien que présents s’effaceraient presque devant la profondeur des noirs et la luminosité des blancs. Les lignes qui rythment la photographie, qui affirment sa composition sont parfaitement lisibles précisément grâce au noir et blanc employé ici. Les éléments de lecture sont distribués de part et d’autre de l’image, avec à gauche et à mi-hauteur le caniche sur le meuble et à droite sur toute la hauteur, la jeune femme. L’image est frontale bien qu’elle présente une légère plongée ainsi qu’une perspective horizontale dessinée par la ligne de la plainte partant du premier tiers gauche pour se terminer en bas à droite. Les noirs et blancs s’opposent autant que les éléments graphiques constitués de formes sphériques d’une part avec le chignon, le caniche, une coquille Saint-Jacques, les finitions du meuble en acier chromé et avec, d’autre part, des formes particulièrement anguleuses dessinées par les dalles du sol en damier, la position des bras et des jambes de la barmaid. Dans la lecture de l’image, le regard est dirigé avec force et enfermé dans un triangle formé de puissantes lignes de construction. Une première diagonale se dessine entre la figurine du caniche et le chignon de la jeune femme, puis une autre ligne descend le long de son dos jusqu’à sa bottine de cuir, enfin une troisième diagonale suit son mollet jusqu’à son genou pour ramener le regard sur le caniche.
Une reine d’un jour telle une gravure de mode. Bien que cette photographie de Diane Arbus s’inscrive dans la lignée du travail de portrait qu’on lui connaît et qui a fait sa notoriété, elle prend malgré tout des airs de photographie de magazine. Et c’est précisément pour cette raison que je l’ai choisie, pour mieux illustrer en quoi les images de Diane Arbus se situent à la confluence de la photographie de mode et de la photographie de reportage, une image qui pourrait représenter la transition de la photographe passant des studios à la rue. Diane Arbus nous présente ici une jeune femme qui se met en scène, qui pose, au milieu du décor qu’elle a créé pour son intérieur. Pourtant il n’y a pas un élément, que ce soit dans son style vestimentaire, sa coiffure, ou dans son intérieur qui ne semble ne pas être à sa place. Comme dans une photographie de mode, tout semble organisé, composé, scénographié. Il y a une forme d’élégance et de sophistication qui se dégage de cette image, tant dans ce qu’elle présente que dans la façon dont elle est construite. Ce portrait est une belle démonstration de la photographe quant à sa maîtrise de la composition assurément graphique et de la lumière où elle associe une source naturelle à son flash. Diane Arbus a participé à la reconnaissance, si ce n’est à la création, d’un style de photographie à la croisée de la photographie commerciale et de la photographie de presse, ses images n’étant ni l’une ni l’autre, elles sont pourtant un peu de chaque. Reprenant d’une part les codes de mise en valeur des sujets propre à la mode et la publicité dans la composition ou la lumière, et appliquant cela à la photographie documentaire, il en ressort des portraits ou chaque individu revêt le costume du premier rôle d’un film qui n’est autre que celui de sa vie. Pour autant la photographe n’a jamais eu recours aux artifices de la photographie commerciale pour « mettre en beauté » les femmes et les hommes qu’elle choisissait de photographier, il n’y a jamais eu de complaisance esthétique envers ses modèles dans son travail toujours très direct et absolument frontal. Seuls son regard, son empathie et sa profonde sensibilité envers ceux qu’elle immortalisait suffisaient à retranscrire la force et la beauté qu’elle avait su saisir, comme instinctivement, à leur contact. La présence est ce qui ressort magnifiquement de l’œuvre de la photographe comme une réponse à celle qui s’est toujours questionnée sur la représentation et la juste distance ou la proximité idéale entre elle et son modèle, interrogeant et selon ses propres mots : « l'espace entre qui est quelqu'un et ce qu'il pense être ».
La distance devenue intimité, l’essence de la photographie de Diane Arbus. D’un monde à l’autre, Diane Arbus a passé sa vie à se rapprocher, par la photographie, de ceux qui étaient le plus éloignés de tout ce qu’elle avait pu appréhender et connaître depuis son enfance jusqu’à sa vie avec Allan Arbus dans la photographie commerciale et de mode. Elle n’avait jamais complètement été la jeune fille qu’elle était sensée devenir et elle avait le sentiment profond que quelque chose lui manquait, qu’une partie de la vie et d’elle-même lui échappaient. C’est une porte vers une deuxième vie qu’elle a ouverte lorsqu’elle a décidé de rompre avec sa carrière dans la mode pour se destiner à sa quête « des autres ». Décidée à se consacrer à une autre photographie, tournée cette fois vers ceux que l’on ne regarde pas, et dont elle disait : « je crois vraiment qu’il y a des choses que personne ne verrait si je ne les photographiais pas », c’est par eux qu’elle va trouver la reconnaissance de son art, et, en eux qu’elle va d’une certaine façon se reconnaître. Il existait une réelle proximité entre la photographe et ses modèles, tant physique dans ses prises de vue frontales, des portraits, qu’humaine dans les liens qu’elle créait avec eux. Une proximité telle que la ligne la séparant de l’intimité s’effaçait presque. Ils ont été à eux tous, les failles, les manques et les vides dont très tôt elle a eu le sentiment qu’elle devait les trouver, les identifier et les embrasser pour pouvoir enfin vivre dans le monde réel et peut-être trouver sa plénitude. On dit souvent que rien n’est tout blanc ou tout noir, et Diane Arbus le sentait dans ses entrailles. Elle n’a jamais su être la jeune fille modèle qu’on espérait, parfaite dans un monde parfait, et souffrait d’être privée des zones d’ombres qui font qu’un être puisse prendre toute sa dimension, autant que la vie puisse suivre son cycle fait de hauts et de bas sans linéarité aucune. Car après tout, pourrait-on imaginer une photographie entièrement blanche, sans ombres pour dessiner les reliefs du monde ?
Diane Arbus :
Mary Ellen Mark : Tiny blowing a bubble, Seattle, 1983
En 1983 à Seattle, devant l’objectif de Mary Ellen Mark, se tient Erin Blackwell immortalisée sur le désormais célèbre cliché : « Tiny blowing a bubble ». Ce portrait est je pense l’un des portraits clés d’une longue série de photographies nous révélant une œuvre qui a commencé avec une très jeune fille, à qui le destin n’a pas vraiment souri, comme s’il n’avait jamais voulu lui accorder de ressembler ne serait-ce qu’un tout petit peu à ses rêves.
Tout le monde l’appelait Tiny, certainement parce que du haut de ses 13 ans, elle n’était pas bien grande et encore toute fine, à mi-chemin entre son corps d’enfant et son corps de jeune femme. Son vrai nom, c’était Erin Blackwell, et c’est elle qui a inspiré « Streetwise », le reportage photographique de Mary Ellen Mark qui raconte 30 ans de sa vie, mais aussi le documentaire réalisé par Martin Bell, l’époux de la photographe. La vie de Tiny, c’est une histoire qui ne commence, ni ne finit, comme un conte de fées, mais Mary Ellen Mark a immédiatement su qu’il fallait la raconter. Du moment où elle a aperçu pour la première fois la jeune fille, est née son envie de la photographier, puis de l’accompagner un peu plus, au fil des ans, témoigner d’elle et de sa vie, en images. Il est assez rare pour que ce soit remarquable qu’un photographe élabore une série de clichés à la fois sur un personnage et sur une aussi longue période. Et c’est en cela aussi que le travail de Mary Ellen Mark se distingue dans la photographie contemporaine. Et si le récit de la vie d’Erin fait sens au travers d’une lecture chronologique des clichés de Mary Ellen Mark, pour autant chacune des images réalisée par la photographe, chacun de ces portraits peut être apprécié indépendamment tant ils sont riches d’évocation, d’émotion, de discours, et témoignent tous de la personnalité magnétique de Tiny, une enfant-femme.
Une jeune fille charismatique, singulière, étonnante, comme un petit bout de lumière au milieu du clair-obscur de la rue et de la vie que peuvent y mener des enfants livrés à eux-mêmes. Les trottoirs de Seattle vécus comme un terrain de jeu dont ils préféraient ignorer les dangers, où plus exactement peut-être, comme un espace de liberté qu’ils espéraient pouvoir dompter, maîtriser, et y vivre pleinement leur fureur de vivre. Et puis à cet âge comment se méfier de la liberté et de la ville, comment imaginer que la liberté soit autre qu’inoffensive. Il ne peut en être autrement quand on a 13 ou 14 ans, la liberté c’est beau, c’est la clé, et la ville c’est la vie. Abandonnés à leur sort par des parents absents ou démissionnaires ou dépassés, ces enfants là n’avaient, pour certains, pas de meilleure alternative que la rue, pour d’autres, ils avaient choisi d’être libres, d’y vivre, de vivre intensément, plutôt que d’avoir le sentiment de s’éteindre chez eux, au sein d’une famille qui n’en portait possiblement que le nom. C’est avec eux que Tiny partageait ses journées et parfois ses nuits, eux, et les clients... A ces âges là, arpenter les trottoirs de la ville avec les copains ce sont des jeux, parfois des querelles, c’est exaltant, c’est l’impression d’être libre et tout puissant, d’être déjà un adulte qui fait ses choix, qui contrôle sa vie et fait ce qu’il veut. Pour une enfant, c’est se maquiller un peu plus fort et se donner des airs de jeune femme afin de leurrer le videur, passer la porte de la discothèque et aller faire la fête, danser jusqu’à s’oublier. C’est fardée, devant une boîte de nuit, que Mary Ellen Mark a remarqué Erin la première fois, et a tenté de l’approcher, sans succès. L’adolescente intuitive et farouche, s’est échappée redoutant que la photographe soit une policière. Mary Ellen Mark a été marquée par sa présence en une vision pourtant fugace, elle se distinguait des autres enfants, elle avait quelque chose de si particulier que la photographe ne pouvait l’ignorer, au point de devoir la retrouver pour établir le contact, créer un lien assez fort pour que Tiny l’autorise à la prendre en photo.
Des prostituées, des proxénètes, des dealers, des drogués et des vagabonds, c’est ce qu’on dit des sujets que photographiait Mary Ellen Mark, pourtant tout cela est terriblement réducteur, comme si l’on pouvait résumer l’existence d’un être à sa seule activité, plus encore lorsqu’il s’agit de survie. Mary Ellen Mark a pour sa part vu des enfants désireux certes mais de vie, de sensations, d’émotions. Des enfants avec encore des rêves plein la tête. Et ce sont peut-être les rêves d’Erin qui faisaient son aura, une émanation si lumineuse que la photographe l’a immédiatement perçue. Avec le temps, les échanges et rendez-vous informels entre Mary Ellen Mark et Tiny se sont multipliés, assez pour que l’enfant confirme avec ses mots les sentiments que la photographe avait ressenti au premier regard. Tiny avait des rêves de petite fille, des projets, des envies comme celles de porter diamants et fourrures ou d’avoir son propre élevage de chevaux, sa passion. L’enfant aurait aimé être une dame, et c’est ce que Mary Ellen Mark a commencé à photographier en 1983 puis durant 30 ans, des rêves confrontés à une réalité toute autre incarnée en une jolie et captivante jeune fille, son ambivalence, l’écart qui se creusait chaque jour un peu plus entre ce qu’elle espérait et ce que la vie lui rendait. Mary Ellen Mark a photographié l’existence d’Erin comme autant de contrastes, de passages entre ombre et lumière, témoignant sensiblement de l’esprit d’une enfant qui croyait pouvoir maîtriser ses options alors qu’elle savait que finalement la vie en déciderait autrement. Car tout enfant qu’elle était, la demoiselle avait l’esprit vif et aurait pu, si son passé et ses choix ne l’avaient rattrapée, saisir les opportunités que lui apportèrent le succès du travail de Mary Ellen Mark et Martin Bell avec Streetwise. En effet, peu après la sortie du reportage de Mark dans Life magazine ainsi que du documentaire de Bell, Hollywood a proposé le scenario d’un film à la jeune fille devenue muse, mais celle-ci ayant abandonné l’école avant la fin de la 6ème et sachant à peine lire, les producteurs ont dû renoncer au projet. Le couple a aussi proposé à la jeune fille de l’adopter à condition qu’elle accepte de retourner à l’école. Tiny, a refusé et préféré poursuivre sa route, elle a continué de vivre comme elle l’entendait, déterminée, assumant ses choix, elle a connu la drogue et les centres de désintoxication, alterné ses allées et venues entre la rue et le foyer maternel, et est devenue mère de 10 enfants.
Je viens d’avoir 14 ans et je m’habille comme une dame. Ce portrait de Tiny par Mary Ellen Mark résume avec force la personnalité de la jeune-fille, certains évoqueraient une femme-enfant tandis qu’à mes yeux ce serait plutôt l’inverse, l’idée d’une enfant qui joue à être femme. Un jeu pourtant dangereux à cet âge, que seule une aveuglante défiance autorise. Ce jour là lorsque Mary Ellen Mark est venue rendre visite à sa muse, elle était déjà habillée, apprêtée, elle avait soigneusement choisi une robe noire sobre et élégante, des gants noirs, un bibi dont la voilette vient envelopper le visage jusqu’au bas du nez. Quant à la résille de la voilette, ses mailles sont assez larges pour ne pas voiler le regard. Tout est là, le message qu’envoie Erin de sa personnalité tient dans ce qu’elle a choisi de porter et son attitude. La voilette nous laisse entrevoir son visage tout en nous en fermant l’accès. Elle représente une féminité derrière laquelle pourtant transparait encore l’enfant qui continue d’exister dans ce corps fragile. Comme si Tiny était déterminée à se montrer sous son visage de femme tout en essayant de masquer l’enfant qu’elle est toujours. Son regard est franc et pourtant ses yeux semblent encore plein d’une innocence enfantine. La voilette n’est pas assez longue pour occulter le bas du visage de la jeune fille, et de sa bouche sort une belle bulle de chewing-gum. Curieusement l’effet produit par cette bulle est inverse à celui de la voilette, et peut-être révélateur, du moins il témoigne de tout l’antagonisme sur lequel s’est construite la personnalité d’Erin. Car après tout, faire des bulles de chewing-gum est un jeu d’enfant, une femme quant à elle favoriserait le rouge à lèvres pour se mettre en valeur. Mais en ce qui concerne sa bouche, sur cette image, Tiny semble préférer la préserver et lui rendre les quelques moments récréatifs d’une insouciance et d’une innocence qui lui ont échappé du jour où elle a préféré la rue à un quotidien auprès d’une mère alcoolique. L’histoire raconte que cette image a été prise au moment d’Halloween et que la jeune fille souhaitait se donner des airs de prostituée française en arborant sa petite robe noire ce qui n’a rien d’anodin tant celle-ci symbolise un classique de la garde-robe originaire de l’hexagone.
Mary Ellen Mark connaît la jeune fille et comprend chacune de ses postures, elle sait qu’elle est intelligente, sans faux-semblants, de leurs rencontres est né un véritable respect mutuel. La photographe sait que Tiny a délibérément choisi de se montrer de cette façon, et elle honore sa volonté en la photographiant tout aussi directement que la jeune fille se présente. L’image est donc frontale, c’est un portrait, en plan serré ou plan poitrine, avec Erin en son centre, droite, faisant face à l’appareil. La photo est au format paysage, elle est composée d’un arrière-plan flou de part et d’autre de l’adolescente qui, quant à elle, se dessine très nettement en premier plan. Derrière elle sur sa droite, et s’éloignant vers ce qui pourrait être un mur ou un portail, on distingue une route ou un chemin non entretenu sur lequel se succèdent des flaques d’eau reflétant un ciel gris. Toujours derrière elle mais à sa gauche on aperçoit une maison bordée de quelques arbustes. L’endroit semble déserté, abandonné, triste, et la jeune fille semble s’en éloigner, tant elle se détache dans son attitude de ce paysage presque désolant. La photographie est dans un noir et blanc présentant de très fines nuances de gris autant qu’une belle profondeur dans les noirs, et le noir de la robe d’Erin participe à mieux dégager sa frêle silhouette de cette rue qui semble sans issue. La tenue de la jeune fille contraste aussi par son graphisme, les lignes sont franches, nettes, géométriques, composées de courbes qui se répondent les unes aux autres, concaves au niveau du décolleté et convexes à partir de la voilette, suggérant l’idée d’un cercle invisible qui encadrerait le visage de Tiny. Tout comme le cercle que l’on retrouve au centre de l’image avec la bulle de chewing-gum et qui de ce fait devient le point d’accroche du regard sur la photographie.
Cette buIle de chewing-gum est ce qu’il reste de la part enfantine d’Erin et il est aussi une provocation, comme un pied de nez à la vie, à cette réalité désenchantée qu’est devenu son quotidien. Il est un bouclier et une ultime bravade, le témoignage de sa détermination à vivre comme elle l’entend quoi qu’il en coûte, à croire encore qu’elle seule a décidé de son destin et qu’en rien elle ne serait qu’une victime collatérale de la misère sociale, l’échec scolaire ou l’alcool et la drogue, la prostitution... Et surtout continuer à croire que la rue en laquelle elle pensait avoir trouvé refuge, ne la détruirait jamais.
Mary Ellen Mark : https://www.maryellenmark.com/
Tiny le film : https://www.maryellenmark.com/
Tiny : the life of Erin Blackwell, bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=rWbWUHFbICE
Streetwise, bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=MWhExsCeoqI
Tiny Revisited, Interview Mary Ellen Mark et Martin Bell : https://www.youtube.com/watch?v=9l137gN6KaE
Vivian Maier : Self-Portrait, 1954 - VM1954W02936-11-MC
Au détour d’une rue, d’une vitre, d’un reflet, voici qu’apparaissent deux femmes, ou trois, ou encore et finalement, peut-être une seule femme, Vivian Maier. Avec Self-Portrait, cet autoportrait daté de 1954, la photographe brouille les pistes dans une image construite d’une multitude de reflets, mais dans le fond, ne serait-ce pas un peu les mille et une facettes de son art et un morceau de sa mystérieuse personnalité qu’elle révèle ici.
Vivian Maier est une photographe dont on ne sait que très peu de choses, on sait d’elle qu’une partie de sa vie était consacrée à son métier de gouvernante et l’autre, parallèlement, à la « street photography ». Au-delà, cette femme au caractère secret n’a jamais rien révélé d’elle-même, de sa relation à la photographie, autant qu’elle n’a jamais révélé au monde ses clichés. Et, de sa personnalité on ne sait que ce que les rares personnes qui l’ont côtoyée ont délivré : « Elle était excentrique, forte, opiniâtre, intellectuelle et discrète. Elle portait un chapeau souple, une longue robe, un manteau de laine et marchait avec une foulée puissante. Avec un appareil photo autour du cou chaque fois qu'elle quittait la maison, elle prenait des photos de manière obsessionnelle, mais ne les montrait jamais à personne. »
La photographie de rue suppose généralement de se faire discret, de s’effacer, pour mieux capturer les scènes qui se présentent au gré des pérégrinations du photographe et devant son objectif. Que ce soit par sa personnalité, sa profession ou son allure, dont rien ne témoignait de son extraordinaire talent, Vivian Maier remplissait aisément une partie de ce contrat tacite, celui de l’invisibilité du photographe de rue. Et pourtant une grande partie de sa production photographique la représente elle, se rendant délibérément visible au cœur de ses images. On la voit dans des reflets de vitrines, de miroirs, de chromes, elle dessine aussi sa présence dans l’ombre portée de sa silhouette sur les sujets qu’elle saisit, elle ira jusqu’à utiliser son propre reflet pour révéler à travers lui, ce qu’elle photographie. Et c’est de cela en particulier qu’il s’agit dans ce cliché de Vivian Maier : Self-Portrait, 1954.
C’est avec un Rolleiflex et son format carré que Vivian Maier a d’une certaine façon mis en scène cette vue. Et le choix de cet appareil photo n’est pas anodin. Certes il était l’un des appareils les plus utilisés de l’époque, mais il présentait aussi et dans le cadre de la photographie de rue, d’autres avantages. D’abord celui d’assurer une forme de discrétion au photographe, avec sa visée par le dessus, l’appareil se portait au niveau du buste, et une fois les réglages effectués, il était tout à fait possible d’appuyer sur le déclencheur en faisant mine d’être occupé à autre chose. L’autre avantage était qu’avec ce type d’appareil et de visée, c’était le photographe qui décidait d’avoir un contact visuel, ou non, avec son sujet. Sans contact visuel, là encore le sujet ne réalisait pas nécessairement dans l’instant qu’il était photographié, mais plus encore, le photographe se libérait aussi d’un quelconque lien, d’une interaction personnelle, avec ceux et celles qu’il était en train de fixer sur sa pellicule. Cependant avec le Rolleiflex, lorsque le photographe choisissait d’établir un contact visuel avec la personne qu’il photographiait, alors et à l’inverse des appareils reflex, le contact était direct et réel, les yeux dans les yeux. Vivian Maier a toujours judicieusement tiré profit de ce type de visée par le dessus, son œuvre compte autant de prises de vues « à la dérobée » que de prises de vues où il est clair que son sujet se savait photographié échangeant parfois un regard complice ou amusé avec elle, tant elle avait l’art d’approcher, littéralement, ceux et celles qu’elle souhaitait saisir.
« De toute façon, on se photographie soi-même quand on prend une photo » disait Denis Roche, ou encore et selon Nobuyoshi Araki : « Pour moi, la photographie c’est par définition se révéler à soi-même ». Il est un fait acquis, que quel que soit le sujet du photographe, c’est toujours lui-même qui est au centre de l’image, c’est toujours lui-même qu’il prend en photo, que ce soit en toute conscience ou non. Et le photographe de rue, même s’il est naturellement tourné vers l’autre, curieux de l’autre, révélateur de l’autre, n’échappe pas à cette règle. Vivian Maier en est à mes yeux l’un des plus illustres exemples, comme si, toutes ces autos-représentations qu’elle a réalisé visaient à incarner autant qu’affirmer l’omniprésence du photographe dans chacun des regards qu’il porte sur l’autre. Ainsi cet autoportrait de 1954 se présente réellement comme une fusion, celle de l’artiste et de l’objet de son image en symbiose, où la représentation de l’un autorise celle de l’autre et inversement. Comme si Vivian Maier s’autorisait à exister et se révéler en tant qu’être et photographe au travers de l’autre, tout en rendant l’autre tangible et manifeste, par elle, avec elle.
Être par la photographie, entièrement... C’est ce que pourrait avoir été purement et simplement le choix de vie de Vivian Maier. Car rares sont les photographes qui se sont autant incarnés dans leurs propres clichés, et plus rares encore sont ceux qui se sont uniquement consacrés à l’acte de photographier sans jamais chercher à proposer leur vision au regard des autres. Le regard des autres pour Vivian Maier, celui qui importe, est celui qu’elle photographie, celui qu’elle regarde et au travers duquel elle semble aussi se regarder. Son œuvre pourrait être comparée à un puzzle, celui de sa vie, une représentation d’elle-même et de tout son être, construite par fragments de regards croisés.
Je suis ce que je photographie, j’existe avec l’autre et il existe avec moi. Voilà ce que pourrait être le postulat de la photographie de Vivian Maier. Self-Portrait 1954 est une image que l’on pourrait contempler des heures durant, happé et fasciné par toutes les facettes qui la constitue, comme si l’on regardait dans un kaléidoscope. Il y a de la géométrie et des plans qui se multiplient, se répondent, interagissent les uns avec les autres, et pourtant rien ne bouge, plus encore, l’image par sa frontalité inspire le sentiment d’une indéniable stabilité. Vivian Maier maîtrisait incontestablement l’art du cadrage, ses photographies témoignent toutes de son habileté à déterminer exactement ce qui devait entrer dans le carré de son image et comment. Ici, il est question de symétrie dans la composition et d’équilibre des valeurs, et, la photographe en est l’axe central. Sa silhouette devient l’un des trois plans qui construisent l’image en parts égales. A gauche et derrière elle une voiture sombre dont les lignes se dessinent grâce aux reflets de la lumière sur sa surface lisse et brillante. A droite lui répond une camionnette qui se révèle de la même façon, sombre, lisse et brillante. Et puis, tout à fait au bord du cadre et en amorce on aperçoit une passante qui s’éloigne. Ces deux plans sont parfaitement identiques en ce qui concerne l’espace qu’ils occupent dans l’image et témoignent de la vitalité d’une artère New Yorkaise. Là où cette photographie prend tout son sens c’est par l’organisation complexe de ses plans dans la profondeur. En photographiant des reflets, ce qu’il se passe à l’extérieur et l’intérieur à la fois, ainsi qu’elle-même, Vivian Maier installe un décor qui sert un propos qui va bien au-delà d’une simple représentation de la rue, où d’un portrait à la dérobée, et elle donne une toute autre dimension à la « street photography ». Où se situe le premier plan, quel est le second plan, que voit on en premier ou en second, c’est certainement au cœur de ce questionnement que se trouve la clé de lecture de cette image, c’est peut-être même ce questionnement en soit qui détermine ici le propos de Vivian Maier. Dans Self Portrait 1954, l’œil n’a de cesse de faire des va-et-vient entre la silhouette sombre et graphique de la photographe, et les deux femmes qui se révèlent dans son reflet, en elle. Serait-ce alors une aberration que d’affirmer que le premier plan est ici invisible car il n’est autre que la vitrine qui offre à la fois transparence et réflexion réunissant en sa surface les trois femmes ? Le contraste veut que l’on remarque en premier la jeune femme dont la robe à carreaux noir et blanc se détache vivement à l’intérieur du cadre créé par le manteau noir de Vivian Maier. Puis naturellement, c’est vers la seconde femme, qui l’accompagne et s’adresse à elle que nos yeux se portent. Cependant et parce qu’elle est plus lumineuse dans sa tenue, la jeune fille redevient rapidement le centre d’attention et c’est alors que son regard nous ramène vers la photographe. La silhouette de Vivian Maier impressionne, par sa taille et sa stature. Ses deux pieds sont posés bien à plat sur le sol et ses jambes se confondent parfaitement avec celles des deux femmes. La photographe est coupée en deux dans sa hauteur par un muret agrémenté de plantes surplombant les deux femmes de la scène qu’elle est en train de fixer sur la pellicule. La moitié inférieure de son corps incarnant alors les femmes qu’elle photographie, tandis que la moitié supérieure lui revient, révélant ses mains, son appareil photo et sa tête baissée sur le viseur. Et voilà que cette image prend les airs d’un curieux dialogue où une femme regarde une jeune femme qui regarde une photographe qui, quant à elle, les regarde autant qu’elle se regarde au travers de son viseur et d’une vitrine. Il y a comme une mise en abyme qui se dessine au cœur de cette photographie où se fondent trois femmes en un seul corps et dont deux d’entre elles en sont conscientes. Toutes les trois coexistent alors non seulement dans un même espace temps mais surtout et en particulier sur un même plan, une même dimension, incarnées en une seule représentation.
Voir dans le viseur comme dans un miroir de soi. Ou comment une quête photographique, au-delà d’être le témoignage d’une ville et de ses habitants à une époque, serait aussi une quête personnelle. Le triangle formé par les trois femmes inspire véritablement la dynamique d’un dialogue qui se traduit par des regards, comme un fil d’Ariane, les reliant successivement de l’une à l’autre. Vivian Maier a été arrêtée par la vision de ce qui pourrait être une mère s’adressant à sa fille. Il n’est pas possible de déterminer ce qui a retenu l’attention de la photographe dans cette scène et à ce moment précis. Ce peut-être le graphisme qui se dégageait de l’ensemble, la lumière, le langage corporel des deux femmes, ou le regard de la jeune fille. La mère est un peu penchée en arrière avec les jambes croisées, et bien que l’on distingue à peine l’expression de son visage tourné vers sa fille, on a le sentiment qu’elle la réprimande, du moins c’est ce que révèle la posture de son buste qui semble indiquer un mouvement de recul. La jeune fille fait face à la photographe, ses pieds touchent à peine le sol, ses épaules sont basses et elle a les bras croisés, son visage est légèrement tourné à l’opposé de celui de sa mère, et son regard se perd loin devant elle. Ses yeux ont une expression qui pourrait relever de la tristesse, de l’accablement ou de l’inquiétude. Elle donne l’impression de regarder Vivian Maier, de la prendre à témoin ou de chercher quelque compassion, quelque chose ou quelqu’un à qui pouvoir se rattacher. On ne voit pas l’expression de Vivian Maier dont la tête est penchée sur le viseur de son appareil photo, et l’on sait qu’elle exprimait rarement ses émotions, elle ne les a jamais laissés paraître dans aucun de ses autoportraits. Pourtant ceux qui l’ont connue, les enfants dont elle s’est occupée la décrive comme une femme sachant se montrer chaleureuse, humaine, et pleine d’esprit. Les rares sentiments que l’on parvient à déceler dans ses autoportraits témoignent plutôt d’une forme de curiosité, comme le serait celle d’un anthropologue qui enquête sur ses pairs, à moins qu’elle n’enquêtât sur elle-même.
Vivian Maier a très tôt été indépendante, sans liens profonds avec sa famille, ou quiconque dans une sphère personnelle. Les seuls liens qu’elle entretenait étaient ceux qui se tissaient avec les enfants dont elle avait la charge, qu’elle élevait comme une seconde mère et qui en retour la comparait volontiers à Mary Poppins. Les seuls autre liens qui semblent avoir rythmé sa vie étant alors les brèves interactions qui pouvaient se manifester avec un inconnu et seulement le temps d’appuyer sur le déclencheur. Cette indépendance, cette solitude sociale qui la singularisait quand il s’agissait qu’elle en soit la bénéficiaire explique peut-être une grande partie de son travail. Comme si elle s’était mise entre parenthèses pour mieux se tourner vers les autres, mieux voir. Captivée par l’humanité tout autour d’elle, Vivian Maier se retrouvait alors de cadrage en cadrage, d’expression en expression lui permettant de regarder sa propre humanité et de lui donner chair sur une pellicule. Dans Self-Portrait, 1954, c’est peut-être son propre regard qu’elle a vu dans celui de la jeune fille, c’est peut-être un instant de sa vie qu’elle a reconnu dans son viseur, un moment entre elle et sa mère, et finalement, un moment que toute jeune fille vit un jour ou l’autre avec sa mère.
Vivian Maier :
Trailer du documentaire « A la recherche de Vivian Maier » :
Best of France awards 2020
J’ai reçu quelques grands noms de la photographie de mariage dans le Podcast, et le dernier en date au moment de la rédaction de cet article, Franck Boutonnet, a eu cette belle initiative en fin d’année dernière: regrouper l’ensemble des awards Français dans une vidéo qui mettrait en valeur la “French touch”, qui est l’air de rien reconnue à travers le monde.
Un grand bravo aux 93 photographes qui ont envoyé en tout 1000 images (ramenées à 300 une fois les multi awardées triées). Chacun est mis en valeur avec au moins une image affichée pendant au moins une seconde, sachant que 30% des participants n’ont qu’un award sur l’année, mais n’en sont pas pour autant moins visibles.
Un grand cru donc pour cette année particulièrement difficile, bravo à Franck Boutonnet et Sylvain Gardères d’avoir mené ce projet de main de maître.
Dans mon sac - Romain Bourven
Retrouvez l’épisode de Podcast de Romain à l’adresse suivante.
Voici ce que l’on trouve dans mon sac :
3 boitiers de la marque Sony.
1 A9 et 1 A9II : une référence en matière de vélocité pour la photo sportive. L’accroche de leur autofocus est tenace comme la mâchoire d’un American Staff… Leur mode rafale en font des Kalash de la photographie avec la discrétion en plus. Ils sont à l’aise en basse lumière comme un Lynx en pleine chasse nocturne. 2 must quand je shoote du foot ou de la course à pied.
1 Sony A7R3, qui a déjà un petit frère plus costaud que lui, me sert en back up au cas où mais surtout pour le lifestyle, le portrait, les commandes avec des tirages print nécessitant une réso de 40MP etc… Une poignée grip dans chaque, car mes mains sont bcp trop grandes.
4 optiques Sony viennent s’emboiter dans ces gros joujou.
L’indispensable Sony 24-70 ouverture 2,8… à lui seul il peut abattre un travail considérable. C’est par lui qu’il faut commencer lorsqu’on se constitue un parc photo.
Vient ensuite le 70-200, toujours de chez Sony, ouverture 2,8 gamme G Master. Mon objectif préféré et de loin… Piqué exceptionnel, bokeh doux comme un bisou de maman, léger comme une plume, autofocus incroyable… le best.
le 200-600 toujours chez Sony, G mais pas master… donc ouverture 5,6 / 6,3 max. grosse bête qui nécessite un peu de pratique. Quand on l’a apprivoisé c’est un nouvel univers qui s’ouvre à vous… couplé avec un doubleur on obtient un 400 - 1200 qui ouvre à 11 / 13 au max… de quoi faire des photo de lune assez plaisantes. Il est fantastique pour le sport en lumière du jour et vraiment bien en basse lumière.
le 12-24, Sony G également… celui qui te pousse un peu aux fesses et qui t’oblige à rentrer dans ton cadre, génial pour la photo de skate notamment et la photo de paysage. J’aime travaille au flash avec celui là.
un flash profoto A1 ( parfois 2 ) et sa remote TTL et son diffuseur
un kit de nettoyage Zeiss, vraiment indispensable avec notamment la poire qui chasse les poussières du capteur.
un trepied Manfrotto Carbone, spécial Sony… léger et efficace.
L’indispensable courroie double Breathe de la marque BLACKRAPID qui permet de switcher d’un boitier à un autre, d’une focale à une autre sans s’étrangler ( pratique surtout en ce moment avec le port du masque qui a tendance à déjà faire suffoquer )
une boite à carte waterproof car en cas de pépin c’est tout de même ce qu’elle contient qui peut te sauver.
un cordon PSG afin de pouvoir accrocher mon accred lorsque je peux shooter au parc :)


















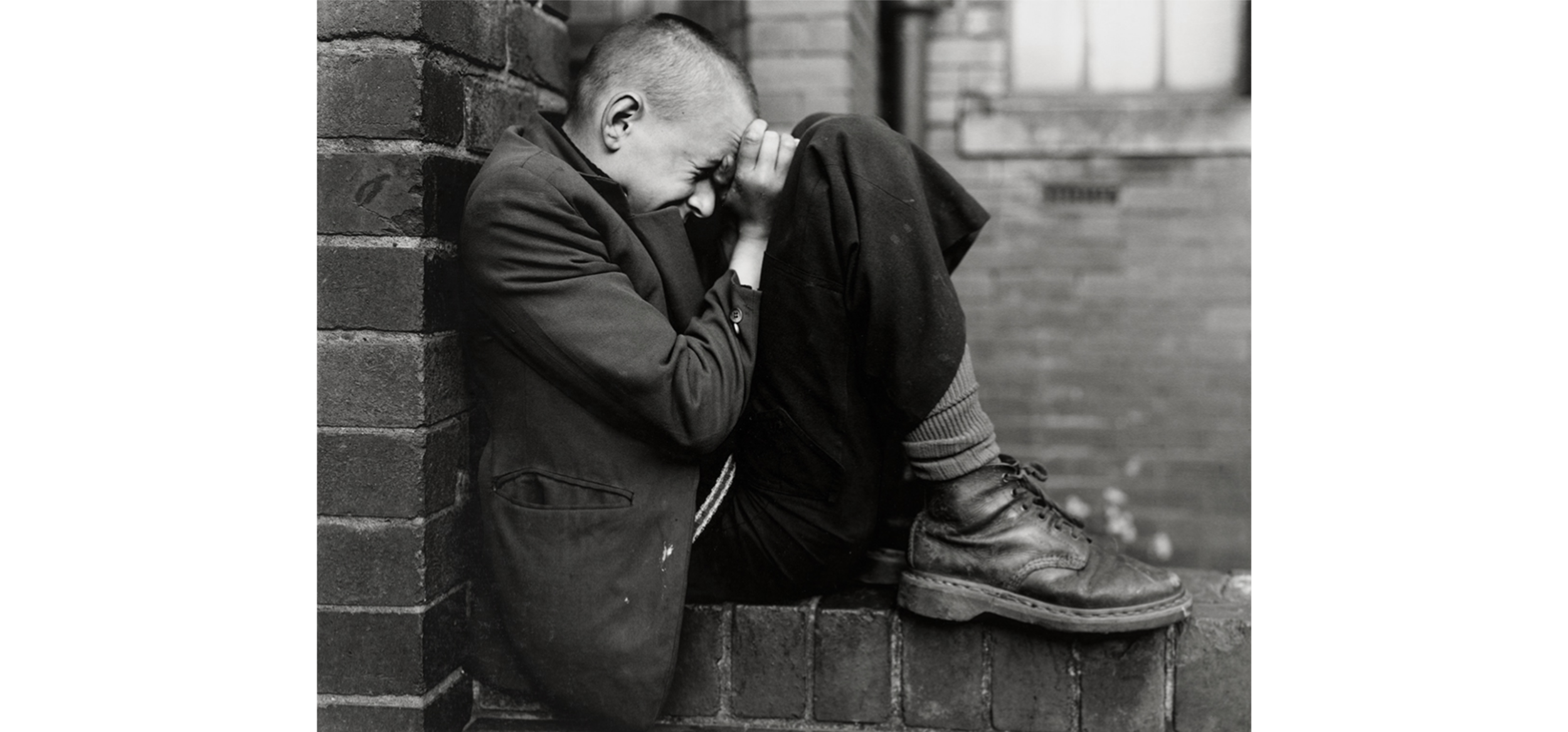





































C’est à 10 ans qu’elle est tombée amoureuse de la photographie, elle lui a promis fidélité, dans le bonheur comme dans les épreuves, ils vivent heureux et font beaucoup de photos !
Photographe d’architecture, de décoration intérieure, d’établissements touristiques, de culinaire et de portraits, ce qui l’anime c’est l’humain et son savoir-faire, ce qu’il fait et lègue. On dit d'elle qu'elle amène poésie et spiritualité autant dans les petits riens graphiques ou colorés qui nous entourent, que dans les personnes ou le monde qui la balade.
Site web - Facebook - Instagram - LinkedIn